
Par les sombres temps qui courent, je l’ai déjà dit ici, il est parfois utile (voire vivement recommandé, selon moi) pour sauver le monde de l’ignorer très momentanément pour aller chercher ailleurs comment retrouver et entretenir la flamme en nous – dans une sorte de « parenthèse enchantée » comme celle que nous ont offert, en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après l’art, c’est au sport et à son pouvoir de transformation individuelle et collective que s’intéresse ce numéro – un sujet qui me passionne depuis longtemps et qui vit aussi dans le quotidien de l’équipe de UTOPIES (5 à 8% de notre chiffre d’affaires est réalisé avec ce secteur) car au-delà du spectacle et de la compétition, il pourrait bien nous aider à cultiver les qualités dont nous avons (et aurons) besoin pour faire face au monde qui nous attend et accélérer la transition écologique.
Retour arrière. En amont des J.O., souvenons-nous, Emmanuel Macron annonçait que «ces Jeux doivent nous permettre de faire de la France une vraie nation sportive. Le sport, c’est un outil d’émancipation, d’apprentissage de la vie. Il ne se réduit pas à un secteur d’activité ni à une pratique reléguée au second plan ; il façonne la jeunesse, mobilise les énergies et offre à chacun une place dans la société.» Pourtant, cette vision semble aujourd’hui déjà lointaine, alors que la France peine encore à ancrer durablement la pratique sportive au cœur de son modèle de société.
En effet, si 30 millions de Français pratiquent régulièrement une activité physique et sportive, l’autre moitié de la population reste largement inactive. La sédentarité progresse, notamment chez les jeunes (2/3 des adolescents s’exposent à un risque élevé pour la santé en pratiquant moins de 60 minutes d’activité physique ou sportive et en passant plus de 2 heures devant un écran chaque jour) – et tout particulièrement dans les quartiers populaires. En parallèle, le taux d’obésité suit une courbe inquiétante (10% des 18-24 ans, avec une part multipliée par 4 en vingt ans), en même temps que les problèmes de santé mentale : en France, 14% des collégiens et 15% des lycéens présenteraient ainsi un risque important de dépression, avec trois symptômes principaux – le manque d’énergie (48% des collégiens et 53% des lycéens), le sentiment de découragement (respectivement 38,7% et 44,6%), et la difficulté à réfléchir (respectivement 38% et 42,3%). L’Organisation mondiale pour la santé classait d’ailleurs en 2020 la France au 119e rang sur 146 en matière d’activité physique des jeunes à l’échelle mondiale.
Et bien que des études démontrant que le sport est un levier essentiel pour la santé physique et mentale, l’insertion sociale et la cohésion des territoires, celui-ci peine encore à être considéré comme un élément central des politiques publiques – comme en témoigne la protestation récente des athlètes français, héros de Paris 2024, autour du projet de loi de finances 2025 prévoyant une baisse d’un tiers du budget du Sport en France… alors qu’il ne pèse déjà que 0,2 % du budget total de l’État, ce qui fait de lui le ministère le moins financé.
Pourtant, les bénéfices du sport sont innombrables : l’activité physique renforce nos organes internes (y compris les muscles, les tendons, les os et les articulations, ce pourquoi le sport est le meilleur remède à l’arthrose), sécrète des substances chimiques qui agissent au niveau cellulaire (immunité, métabolisme – ce pourquoi le sport est prescrit pendant et après les traitements anti-cancer mais aussi après un accident cardiaque) ou régulent notre humeur et notre fonctionnement mental, et enfin elle permet de réparer notre ADN via l’épigénétique (à partir de vingt minutes d’effort physique). Ces bénéfices potentiels sont tels qu’en France, une quarantaine de mutuelles (comme Allianz ou Apivia Macif Mutuelle) proposent déjà des offres de remboursement liées au sport-santé, par une aide au financement d’une activité physique ou sportive ou par la prise en charge d’un bilan personnalisé pour reprendre une activité physique adaptée. Le sport est aussi un facteur d’inclusion, de développement personnel et de vivre-ensemble ; il renforce la cohésion sociale, soutient la réinsertion de populations fragiles, contribue au développement de compétences sociales ; il est enfin un formidable levier d’attractivité économique et territoriale. De nombreux événements ont prouvé que l’implantation d’infrastructures sportives ou l’organisation de compétitions d’envergure pouvaient revitaliser des territoires en difficulté, redonner fierté et dynamisme aux habitants.
Alors certes, le sport est ambivalent – car il reflète aussi notre modèle de société et une course à la performance où l’on se bat pour des centièmes de seconde, où l’on veut toujours repousser les limites et conquérir plus de sommets (donc se déplacer toujours plus loin), où l’on s’équipe avec du matériel toujours plus performant (le plus souvent fabriqué à l’autre bout du monde dans des conditions méconnues… et parfois par des Ouighours dans les conditions que l’on connaît) ou où l’on se crée de nouveaux besoins (et donc de l’obsolescence). Résultat : comme d’autres activités humaines ou comme d’autres secteurs d’activité, les activités sportives n’ont pas toujours un bilan « positif net » sur la société et la planète. Ce, alors même qu’une grande partie des sports (sports nature, outdoor, de glisse ou d’aventure) ont pour but de permettre une expérience d’immersion dans la nature intacte, que ces activités menacent par leur existence même. Comme l’a montré le récent rapport du The Shift Project « #Décarbonons le sport », qu’il s’agisse du sport professionnel ou amateur, de grands événements internationaux ou de petits événements locaux, ce sont malgré tout encore les déplacements (avion ou voiture) des sportifs et du public, qui pèsent entre 60 et 80% du bilan carbone du sport, même si le covoiturage se développe.
Mais à l’encontre du masculinisme en vogue outre-Atlantique qui instrumentalise le MMA et les sports de combat comme une métaphore de la domination et de l’affrontement (plutôt que comme une éthique de la relation, du contrôle de soi et du respect des règles), il est temps de (re)considérer le sport, au-delà de sa dimension récréative, comme un levier essentiel de transformation sociale et écologique, un outil puissant de renaissance, d’adaptabilité et d’engagement collectif. Et de faire plus que de célébrer nos athlètes tous les quatre ans, en construisant au quotidien cette fameuse nation sportive, localement, au cœur des associations, des clubs, des territoires et des entreprises.
Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia et grand sportif devant l’Eternel (il est un alpiniste réputé, qui a ouvert des voies en haute montagne avant de le faire dans le business, et aussi un surfeur émérite), aime à dire qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre un optimiste qui ne fait rien car il pense que tout va s’arranger et un pessimiste qui ne fait rien car il pense que tout est fichu ! Car dans les deux cas rien n’est fait… Lui dit qu’il est au contraire un pessimiste qui agit, et que ce sont les sports d’action qu’il pratique depuis toujours qui l’ont aidé à cultiver cette qualité.
Et c’est un fait que l’activité physique, par le mouvement et la concentration qu’elle exige tout autant que par le plaisir qu’elle suscite, favorise un état de pleine conscience où l’esprit se libère des ruminations sur le passé et des angoisses liées aux incertitudes du monde qui nous entoure. Comme Montaigne recommandait la pratique du jardinage ou de la musique pour s’ancrer dans le présent, le sport permet de retrouver ce même équilibre en mobilisant le corps et l’esprit sur l’ »ici et maintenant ».
Dans un contexte où les problèmes de santé mentale et l’écoanxiété touchent de plus en plus d’individus, ceci renvoie à une vertu concrète de la pratique sportive – qui canalise l’énergie vers l’action positive. Ainsi le très bon rapport « Faire de la France une vraie nation sportive » de la sénatrice (et désormais Ministre… mais pas des Sports hélas) Françoise Gatel rappelle que l’activité physique régulière est associée à une réduction significative (jusqu’à 30 %) du risque de développer des troubles dépressifs. L’activité sportive agit selon le rapport comme un « rééquilibrant mental », grâce à la libération d’endorphines et au cadre structurant qu’elle offre.
Par ailleurs, de manière assez évidente, les personnes pratiquant régulièrement un sport ont une endurance psychologique accrue et une meilleure capacité d’adaptation aux difficultés. La pratique sportive développe des qualités essentielles comme la ténacité, la discipline, la persévérance et la capacité à gérer le stress. Des programmes comme « Paris, bouge ton esprit », menés depuis les J.O. par la marque ASICS en partenariat avec la Ville de Paris , ciblent d’ailleurs explicitement la santé mentale et physique des Parisiens à travers des activités sportives accessibles et inclusives valorisant, le « sportif du dimanche » – ce que Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, appelle « le sport de petit niveau », à l’encontre de la quête effrénée de performance. Il est vrai qu’on a vu, ces dernières années, que cette dernière peut à l’inverse créer une pression psychologique intenable pour les athlètes et leur santé mentale – de Marie-José Pérec fuyant l’Australie en amont des J.O. de Sidney 2000 à Simone Biles abandonnant les épreuves par équipe aux JO de Tokyo 2020, sans oublier les jeunes héros du documentaire « Futurs champions : le prix de la gloire » qui dénonce les séquelles traumatisantes de l’entraînement des sportifs professionnels.
Cet effet qui lie étroitement santé physique et santé mentale est constaté à tout âge. Depuis sa création en 1997 par des professeurs de sport, la formidable Association Siel B. se positionne comme actrice à part entière de la prévention santé et intervient depuis longtemps en ehpad pour promouvoir et organiser une activité physique adaptée visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Des évaluations de tels programmes (dits HAPPIER – Healthy Activity and Physical Program Innovations in Elderly Residences) ont montré qu’une heure d’activité physique adaptée par semaine réduisait de 35 % le taux de chutes et améliorait de 87 % les capacités de déplacement, diminuant aussi de 15% le sentiment que « la vie n’a pas de sens ».
Pour aller dans cette direction qui valorise la robustesse et l’endurance sur la performance, dans l’esprit de ce que prône Olivier Hamant face au monde contemporain, Malek A. BOUKERCHI, ultramarathonien (cette discipline extrême où les 42 km s’envolent vers des distances à peine croyables de 1000 ou 1500 km), éducateur de quartier et anthropo(do)logue comme il se décrit en souriant, ne tarit pas d’inspiration et d’histoire sur ce que le sport (et ce sport, en particulier) peut apporter aux individus et aux collectifs, notamment sur des qualités dont la transition écologique a grand besoin : adaptation, persévérance, confiance, abnégation, discipline, capacité à dépasser le découragement et à garder le cap… Pour lui, l’ultra-marathon est aussi une métaphore de la vie où ce qui prime n’est pas la vitesse et la performance, mais la lenteur et la continuité (car ce qui compte c’est d’arriver au bout et non de battre le chrono). Une pratique sportive qui nous invite aussi à habiter davantage notre corps, lequel ne ment jamais… ce qui en fait selon lui une meilleure façon d’appréhender le monde. Un sport enfin qui parle de renaissance, plus que de résilience – car chacun peut y renaître à chaque instant, malgré l’épuisement, grâce à la force du mental. Pour le prouver, Boukerchi a d’ailleurs monté l’association LES 42 qui entraîne et emmène désormais chaque année 42 jeunes décrocheurs entre 18 et 28 ans, qui ne font pas de sport, faire leur premier marathon : celui qui va tout changer dans leur vie, à commencer par leur confiance dans leurs capacités (ce qu’on appelle aussi « le sentiment de compétence ») et le regard que les autres portent sur ce dont ils sont capables.
L’exemple de l’ultramarathon le montre : le sport enseigne la capacité à s’adapter aux imprévus et à développer une agilité mentale et physique, des compétences essentielles face aux incertitudes du monde actuel et à la crise environnementale. Seuls ou en groupe, les sportifs semblent en effet plus actifs et volontaires : une étude de l’INJEP montre que 80% se déclarent en bonne santé, contre 64% des non-pratiquants, et que 59% des sportifs se sentent épanouis contre 46% des non-sportifs… Ce n’est pas Fabrice Bonnifet , le tonique directeur RSE du Groupe Bouygues (Président du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) et récent fondateur de GenAct), qui compte à son actif 37 marathons (dont une place de 36ème à New-York en 1990 avec 2h24 ;-), qui dira le contraire… lui qui explique qu’il trouve dans sa pratique sportive des qualités dont il a besoin au quotidien de son métier : la persévérance, la sincérité (car on ne triche pas avec son corps) et la connexion à la nature.
Enfin, le sport renforce la capacité à collaborer et à s’adapter en équipe dans des contextes incertains. Selon le baromètre du lien social publié par Ipsos x Sopra-Steria x Ebra (2024), 84% des Français considèrent que le sport joue un rôle significatif dans la cohésion sociale, ce qui en fait l’un des piliers principaux identifiés pour rassembler les individus. 23% des Français estiment aussi que les associations sportives jouent un rôle notable dans le maintien du lien social au niveau local, juste derrière les lieux de vie comme les cafés et restaurants (38 %) et les associations généralistes (37 %). Autrement dit, le sport développe l’envie et la capacité à être actif dans la société, de manière positive, pour soi, pour les autres et plus largement pour le bien commun : en France, le sport est d’ailleurs le secteur regroupant le plus de bénévoles, essentiels au fonctionnement des associations sportives – avec plus de 3,5 millions le nombre de bénévoles et un quart du travail bénévole de l’ensemble du secteur associatif. Autant dire que le sport agit comme un catalyseur d’engagement civique et de solidarité, en même temps qu’il aide à forger des relations interpersonnelles et un réseau de soutien – toutes qualités dont on sait aussi, désormais, qu’elles sont des facteurs de résilience supplémentaires face aux crises.
D’ailleurs les entreprises engagées ne se trompent pas sur les compétences personnelles et sociales que développe le sport, au point qu’elles encouragent et facilitent désormais l’activité physique de leurs salariés, parmi d’autres mesures visant à améliorer les conditions de travail (il existe même depuis 2004 une Fédération Française du Sport d’Entreprise). Selon une enquête menée par Malakoff Humanis en 2023, 73 % des salariés affirment ainsi que la possibilité de pratiquer une activité sportive au travail influencerait positivement leur choix d’entreprise. D’ailleurs les avantages du sport en entreprise sont étudiés et prouvés : meilleure santé des employés, réduction de l’absentéisme pouvant atteindre près de 60%, et augmentation de la productivité de 1 à 14%, selon une étude conjointe du CNOSF et du Medef. Des réunions en marchant (auxquelles nous avons consacré un petit guide des walkingmeetings publié avec la FFRandonnée – Fédération Française de la Randonnée Pédestre), aux sessions de sport entre collègues ou entreprises voisines à l’heure du déjeuner (voir par exemple ce que propose la plateforme All Sessions choisie par nos équipes), en passant par des teambuildings sportifs ou la participation en équipe à des événements sportifs et solidaires comme l’Oxfam Trailwalker cher au cœur des Utopiens (une marche de 100 km sans arrêt et en équipe), les pratiques varient et UTOPIES peut historiquement témoigner de leurs bienfaits…
Dernier point important (voir le numéro de cette newsletter sur la sensibilisation à la nature comme levier d’action environnementale) : dans une société de plus en plus numérisée qui nous fait oublier que nous faisons partie de la nature, le sport nous offre une opportunité de renouer avec elle et de promouvoir une vie plus sobre. C’est tout particulièrement le cas des sports dits « nature », comme le trail, le surf ou l’escalade, qui offrent une immersion directe dans des environnements sensibles et soumis à des pressions qui modifient l’expérience du sportif, ce qui favorise plus encore la prise de conscience des enjeux écologiques.
Un exemple emblématique est fourni par la The Surfrider Foundation , une association environnementale née il y a 40 ans de la communauté des surfeurs en Californie, d’abord soucieux de protéger leur « spot » de surf de l’urbanisation galopante de la côte puis inquiets des conséquences de la pollution sur leur santé : Surfrider Foundation milite aujourd’hui partout dans le monde pour la protection des océans, des plages et des cours d’eau. Présente aujourd’hui dans de nombreux pays, dont la France, elle mène des actions de sensibilisation, de nettoyage des plages et de plaidoyer contre la pollution plastique et les marées noires. Grâce à son ancrage dans une pratique sportive directement liée aux écosystèmes marins, le développement de Surfrider Foundation, devenue une ONG environnementale de plan mondial, illustre comment le sport peut être un moteur d’engagement environnemental et un levier de mobilisation citoyenne, avec un réseau de bénévoles militants dédié à sa mission de protéger et de profiter des océans, des vagues et des plages du monde. Forte d’un modèle de défense du littoral, l’ONG n’hésite pas à lancer des actions en justice souvent couronnées de succès… et a également lancé le label « Ocean Friendly Restaurant » à l’attention des restaurants plutôt situés sur le littoral (le label impose l’interdiction des plastiques jetables, l’absence d’espèces menacées, au menu le tri des biodéchets et la présence d’un plat végétarien équilibré).
Dans cette même dynamique, d’autres associations inspirées de Surfrider Foundation ont vu le jour, comme « Protect Our Winters » créée en 2007 aux Etats-Unis par le snowboarder Jeremy Jones qui a réalisé combien la neige commençait à manquer sur les pentes qu’il fréquentait et sa responsabilité en tant qu’athlète. Son objectif (mobiliser la communauté des sports d’hiver pour lutter contre le changement climatique et pour la transition écologique en montagne) est aussi celui de Mountain Riders, association d’éducation (née en 2001 en France autour du ramassage des déchets au printemps, après la fonte des neiges), qui sensibilise les pratiquants des sports de montagne à la préservation de leur environnement et accompagne les stations de montagne dans leur transition (l’association est notamment à l’origine du label Flocon vert). Ces structures apportent la preuve que des communautés sportives peuvent devenir des acteurs majeurs de la transition écologique, par le biais de leur pratique et au-delà…
En complément, des initiatives plus ponctuelles, comme le mouvement Plogga en Scandinavie allient jogging et ramassage des détritus, popularisant une approche citoyenne et ludique de la protection de l’environnement. Surfrider Gironde propose aussi tous les mercredis, sur les quais de Bordeaux, un plogging dont le concept est identique : courir avec un sac poubelle, afin de ramasser les déchets croisés en chemin.
Dans cette dynamique toujours, l’enseigne coopérative américaine REI, spécialiste des fameux sports « nature », a été pionnière dans le boycott du Black Friday avec sa campagne #OptOutside. Plutôt que d’encourager la surconsommation, REI invite ses clients et employés à passer cette journée en plein air, en partenariat avec les Parcs Nationaux. Depuis son lancement en 2015, cette initiative a rassemblé des millions de participants et contribué à renforcer la connexion entre la pratique sportive et le respect de l’environnement.
Plus quotidiennement, en renforçant la santé physique et mentale, le sport facilite également la transition vers des modes de vie durables : ainsi la pratique du vélo ou de la marche, motivée d’abord par la volonté d’échapper au stress des bouchons, de circuler de manière plus fluide tout en prenant soin de sa santé, contribue directement à la transition vers une mobilité douce, qui réduit les émissions de CO₂ tout en améliorant la qualité de vie. Le vélo a ainsi explosé en France depuis le Covid, puisqu’entre 2019 et 2023, les passages de vélos ont augmenté de 37 % au niveau national, avec une augmentation de +40 % en milieu urbain et une progression fulgurante de 44 % pour la pratique mixte (utilitaire-loisirs) selon l’association Vélo & Territoires.
Pas étonnant dans ce contexte que les événements sportifs s’engagent eux aussi vers plus de sobriété et d’écoresponsabilité. Les compétitions au positionnement « vert » comme l’Eco-Trail De Paris, né en 2007 dans l’hexagone et depuis développé dans plus d’une dizaine de pays, intègrent des principes de durabilité, minimisant leur impact environnemental. A Paris, cet événement attire chaque année plus de 13 000 participants, avec un objectif : « utiliser les sentiers naturels qui composent encore les zones urbaines pour offrir aux coureurs différentes distances et leur faire prendre conscience de la présence d’un milieu naturel préservé et de les sensibiliser à la fragilité de l’environnement ». Naturellement, la charte écoresponsable de la course est stricte : incitation aux transports durables (les tickets de transports en commun sont compris dans l’inscription), mise en avant du patrimoine local et naturel dans le parcours, réduction et collecte et/ou tri des déchets, ravitaillements équilibrés à base de produits locaux et de saison, redistribution des surplus à des associations locales, éducation à l’éco-responsabilité dans la pratique du trail (pochettes déchets individuelles, charte éthique, etc.).
Progressivement, cette approche gagne les Grands Evénements Sportifs Internationaux (GESI) – du tournoi de tennis de Roland-Garros (premier événement sportif français de dimension internationale à être certifié ISO 20121, un système de management responsable appliqué à l’activité événementielle, en 2014 avec une attention portée à la mobilité, à l’énergie renouvelable, à l’alimentation durable, à la gestion des déchets et à la solidarité) aux Jeux Olympiques de Paris 2024 – dont le bilan carbone révélé fin 2024 (voir la synthèse et le rapport Durabilité & Héritage de Paris 2024 ainsi que le communiqué de presse associé) a tenu sa promesse de réduction de moitié par rapport à la moyenne des éditions de Londres 2012 et Rio 2016 : infrastructures existantes ou temporaires, techniques de construction bas carbone (ossature en bois, béton bas carbone et matériaux recyclés notamment) au Village des athlètes, énergie intégralement produite en France et certifiée d’origine renouvelable (solaire et éolienne), 40% de repas végétariens pour le grand public, priorité aux transports en commun sur place, programme ambitieux de séquestration carbone pour les émissions résiduelles (notamment liées au transport des athlètes et des visiteurs extra-européens), travail inédit pour assurer la seconde vie via le don ou la revente de 90% des 6 millions d’actifs nécessaires pour les Jeux (équipements sportifs, uniformes, objets symboliques, etc.) – via la plateforme « Seconde Vie Paris 2024 » ouverte après les Jeux au mouvement sportif français (fédérations, clubs, associations…), réduction du plastique à usage unique via le modèle de distribution de boissons mis en place par Paris 2024 et Coca-Cola, réduction de l’impact environnemental sur les sites (par ex. protections d’arbres, bouées auto-positionnables sans ancrage dans les fonds marins à Marseille pour préserver les herbiers de posidonie, soutien à la Ligue pour la protection des oiseaux…)… et de nombreux outils laissés « en héritage » à la disposition des organisateurs d’événements comme le Coach Climat évènements, un outil gratuit et accessible à tous les organisateurs pour des événements plus responsables.
Autre point, et pas des moindres, puisque l’on parle d’héritage et de patrimoine : le sport joue un rôle central dans le dynamisme économique et la cohésion sociale des territoires.
D’abord et à l’évidence, les événements sportifs bien organisés stimulent l’économie locale en attirant des visiteurs et en créant des emplois. Par exemple, la première étape du Tour de France à Brest a généré en 2021 environ 4,35 millions d’euros de retombées économiques pour le territoire finistérien, soit 3 euros de retombées par euro investi.
Autre exemple : l’étude menée par Utopies sur la Coupe du Monde de Foot féminin en 2019 a montré que le retour sur investissement par euro dépensé dans les villes-hôtes était de 2 à 20 euros, avec une plus-value nette pour l’économie française de 108 M€. La plupart des grands événements mesurent ainsi désormais leur impact sur l’économie locale, comme l’UTMB® Group Mont-Blanc (plus de 10.000 inscrits, 23 millions d’euros de dépenses sur le territoire en 2022) ou La Diagonale des Fous à La Réunion (10 millions d’euros de retombées économiques estimées).
Plus fondamentalement, l’existence d’un club ou d’un événement sportif nourrit la cohésion sociale et le récit territorial : c’est cette dynamique que décrit par exemple si bien l’excellente pièce Stadium de Mohamed El Khatib, personnalité phare du « théâtre documentaire », qui met en lumière comment le club emblématique du RC Lens, dont l’impact dépasse largement le cadre du football, incarne une forme de résilience collective, offrant aux habitants un récit collectif local, un vecteur de lien social, une source de fierté et un moteur d’espoir collectif dans un territoire marqué par les difficultés économiques.
Car le sport est aussi un levier stratégique pour réduire les inégalités sociales dans les quartiers populaires et les territoires défavorisés : au-delà des qualités qu’elle développe, la pratique sportive encourage la mixité sociale, créant des espaces d’échanges et de cohésion, tout en pacifiant les tensions intergroupes. De plus, le sport agit comme un point d’ancrage pour réengager les jeunes éloignés des institutions, facilitant un dialogue durable en vue d’une réinsertion professionnelle. Sur le plan sanitaire, il promeut un mode de vie actif, réduisant les impacts de la sédentarité et des problématiques de santé publique dans ces zones. Enfin, pour les plus talentueux, le sport peut représenter un vecteur d’ascension sociale, offrant des opportunités exceptionnelles et inspirant des trajectoires exemplaires.
Pariant sur ce pouvoir du sport, l’association Sport dans la Ville qui œuvre concrètement pour l’ insertion professionnelle et sociale des jeunes issus de quartiers prioritaires, utilise ainsi le sport comme passerelle vers le monde de l’entreprise. Elle valorise les compétences acquises par la pratique sportive auprès des employeurs et organise des actions pour rapprocher les jeunes du monde professionnel. Depuis sa création, plus de 7 000 jeunes ont bénéficié de ses programmes, avec un taux d’insertion professionnelle de 70 %. A l’appui de ce point, le rapport annuel de l’association Sport dans la ville comprend des éléments d’impact probants sur la façon dont le sport peut re-mobiliser et développer des compétences transversales : 78% des jeunes déclarent ainsi avoir une meilleure image d’eux-mêmes et 81% des jeunes disent avoir renforcé leur motivation à réussir dans leur parcours scolaire et professionnel.
Le sport représente donc une formidable source d’économies pour la société, au-delà de la seule dimension sanitaire. Selon le récent rapport sur l’impact social, sociétal et économique du sport (réalisé par Pluricité, le CDES et la CPNEF Sport), la pratique sportive régulière génèrerait en France entre 194 et 254 milliards d’euros de coûts évités chaque année, soit entre 7,3 % et 9,6 % du PIB national. Ces économies se répartissent principalement dans la santé (140 milliards d’euros), mais aussi dans la lutte contre la délinquance (jusqu’à 31 milliards d’euros évités), la lutte contre les discriminations (jusqu’à 17,9 milliards d’euros évités), la réduction du mal-être au travail (jusqu’à 36 milliards d’euros), ou encore la prévention de l’absentéisme (jusqu’à 9,5 milliards d’euros) et du chômage (jusqu’à 8,7 milliards d’euros). Le sport apparaît ainsi non seulement comme un levier majeur de cohésion sociale et de santé collective, mais également comme un véritable investissement bénéfique pour la santé de la société tout entière.
Les sportifs, suivis par des millions de personnes, ont dans le monde contemporain un pouvoir d’influence considérable sur les comportements sociaux et environnementaux. Depuis quelques décennies en effet, ils figurent (avec leurs clubs) parmi les personnalités les plus influentes au monde, surpassant souvent les artistes, les marques et les personnalités politiques sur les réseaux sociaux. En 2025, selon We Are Social , les sportifs comme Cristiano Ronaldo (près de 650 millions d’abonnés), suivi par Lionel Messi (500 millions) ne sont battus sur Instagram que par Instagram soi-même. Et sur Facebook, dans les dix influenceurs les plus suivis, Ronaldo bat Samsung et Facebook, cependant que le Real Madrid occupe la 6e place, Lionel Messi la 8e et le FC Barcelone la 10e. Cette portée exceptionnelle permet aux athlètes (et à leurs clubs) de devenir des ambassadeurs puissants, capables de mobiliser massivement leurs communautés … y compris sur les enjeux sociétaux et environnementaux.
Ce pouvoir d’influence, pas encore complètement maîtrisé ni utilisé à bon escient (on se souvient du fou-rire malheureux de Kylian MBappé et de l’entraîneur du PSG Christophe Galtier en conférence de presse au sujet des modes de déplacement de l’équipe, en 2022), n’en est pas moins naissant : en commençant par le surf ou l’ultra-trail, certains sportifs prennent désormais la mesure de l’impact écologique de leur discipline et s’engagent pour une pratique plus responsable. Ainsi Kilian Jornet, alpiniste et ultra-trailer de renommée mondiale au palmarès impressionnant, dit qu’il « veut être une voix et un exemple pour montrer le besoin urgent que l’on a de protéger la nature et notre environnement » : au fil des dernières années, il a pris position contre le partenariat de l’UTMB avec Dacia (accusé de fabriquer surtout des SUV) et a créé la Kilian Jornet Foundation, une organisation dédiée à la protection de l’environnement en montagne. De son côté, Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’UTMB, a décidé dès 2019 de renoncer totalement à l’avion pour se rendre à ses compétitions, préférant sacrifier quelques courses plutôt que la planète. Dans la même logique, la jeune surfeuse Ainhoa Leiceaga limite drastiquement ses voyages aériens, privilégiant des déplacements en train ou en bus malgré les contraintes pratiques. Ces engagements individuels témoignent d’une prise de conscience forte : pour préserver les terrains de jeu qu’ils aiment tant, ces athlètes sont prêts à repenser en profondeur leur mode de vie et à encourager toute leur communauté à suivre leur exemple. Enfin, Nikola Karabatic, handballeur professionnel au Paris Saint-Germain , a pris des engagements similaires et soutient le label Fair Play For Planet , créé en 2021 par l’ancien joueur international de rugby Julien Pierre (avec le soutien de l’ADEME ) à l’attention des clubs, évènements sportifs, etc. Ces engagements vont croissants et sont importants, comme le disait la climatologue du GIEC, Valérie Masson-Delmotte en parlant du footballeur Kylian Mbappé, car « les propos qu’il peut avoir, les gestes qu’il fera, auront une influence très largement supérieure à ce que les scientifiques peuvent dire ou faire. Il inspire de nombreuses personnes. »
Certains clubs ont d’ailleurs mis les bouchées doubles sur l’engagement social et environnemental. Le plus connu est sans doute les FOREST GREEN ROVERS FOOTBALL CLUB LIMITED au Royaume-Uni : ce club de football, ambitionne d’être le « club le plus écologique du monde » depuis sa reprise en 2010 par Dale Vince, fondateur d’Ecotricity, qui a initié une politique radicale de durabilité – retrait de la vente de produits carnés dans l’enceinte du stade et de la viande rouge du régime des joueurs, zéro plastique à usage unique, engrais bio sur le terrain, panneaux solaires sur le toit du stade, système de récupération de l’eau de pluie, maillots fabriqués à base de bambou ou de marc de café, certification ISO 14000 pour le fonctionnement du club, suivi et réduction du bilan carbone du club, nouveau stade écoresponsable en bois de 5 000 places devant à terme accueillir plusieurs terrains, un gymnase et une clinique au service de la communauté locale…
Plus près de nous l’Aviron Bayonnais Rugby Pro, en France, est devenu en 2021 le premier club sportif professionnel français ayant le statut officiel d’ »Entreprise à Mission », et place la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de ses actions. Grâce à son fonds de dotation créé en 2018, l’Aviron Bayonnais soutient activement plus d’une centaine d’initiatives locales dans les domaines du sport, de l’éducation et de l’environnement, totalisant déjà 300 000 euros investis. Sa raison d’être, « Engagé pour demain », se traduit par différentes actions : signature du Pacte Mondial des Nations-Unies, charte avec SUEZ sur la gestion de la ressource en eau et la réduction de l’empreinte carbone, politique de mobilité moins polluante avec une flotte de véhicules hybrides, vélos et trottinettes à assistance électrique pour les collaborateurs, projet de sport santé avec des acteurs locaux de santé, charte Emploi Durable pour accompagner, former, réorienter et recruter des acteurs du territoire en quête d’emploi…
Le sport est un miroir puissant de nos sociétés : il révèle nos espoirs, nos contradictions et nos débats, comme l’ont montré ces derniers jours les discussions passionnées autour du port du voile lors des compétitions sportives.
Mais il offre bien plus qu’un reflet. Fédérateur universel, contributeur majeur au développement humain, c’est un puissant facteur de cohésion sociale et de rapprochement des peuples qui rassemble des millions – voire des milliards – d’individus autour d’émotions communes, de joies ou de déceptions partagées. Du football professionnel, suivi en France par 23 millions de personnes, au sport amateur qui compte plusieurs millions de licenciés (plus de 2,5 millions de licenciés pour les seuls football et rugby), le sport offre une formidable caisse de résonance pour porter de grands messages structurants comme la décarbonation mais aussi pour renforcer la vie familiale, la santé, l’économie locale et le lien social.
Par sa capacité unique à fortifier tout à la fois nos corps, nos esprits, nos liens et notre capacité d’action, mais aussi à mobiliser, inspirer et éduquer, le sport ne se contente pas de refléter le monde : il a le pouvoir, à son échelle, d’en transformer durablement les contours. Ce, à condition qu’on en libère tout le potentiel – de la politique aux grands événements, en passant par les athlètes superstars et les clubs : pour l’essentiel, ce défi est encore devant nous…
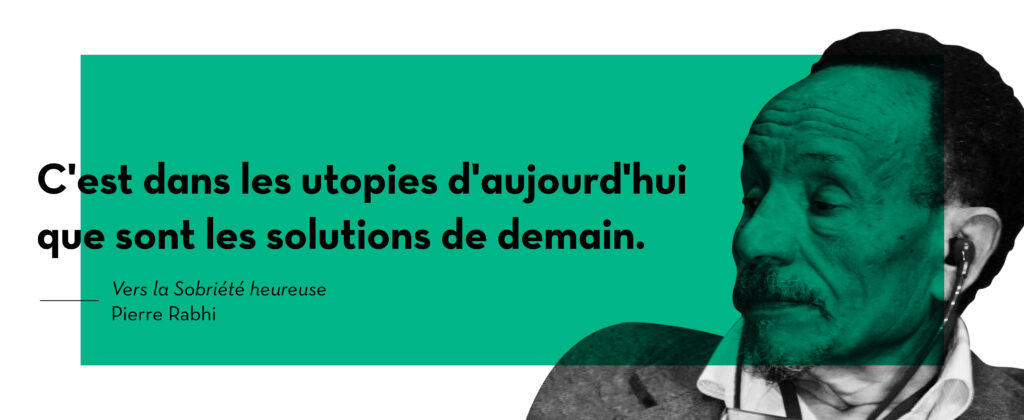
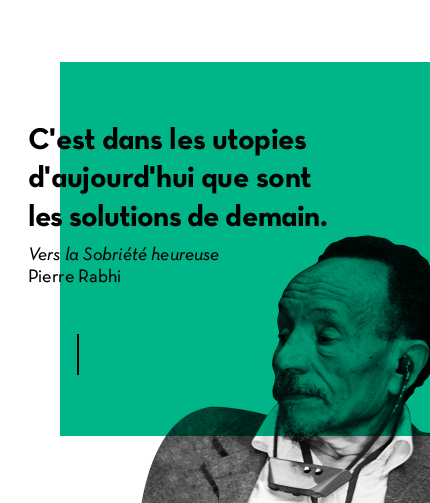
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire