
Alors que les écrans n’en finissent plus d’envahir nos vies, un phénomène inattendu bouscule les tendances. Inoxtag, influenceur et YouTuber, a conquis des millions de spectateurs en mettant de côté sa vie principalement digitale pour partir à l’aventure en pleine nature, en montagne, en se lançant à corps perdu dans l’alpinisme… avec l’objectif fou d’atteindre le sommet de l’Everest, une aventure que raconte son film Kaizen, dont les images époustouflantes ont été vues sur Youtube par un Français sur trois en 4 jours à peine ! Ce retour aux sources a non seulement captivé ses followers, mais a également ouvert la discussion sur les bienfaits du contact direct avec la nature, notamment sur le cerveau humain. Mais pourquoi cette immersion dans la nature nous fait-elle tant de bien ? De nombreuses études, allant des neurosciences aux philosophies, confirment que se reconnecter avec les éléments naturels est bien plus qu’un simple effet de mode… et que les entreprises de tous secteurs peuvent ici apporter une contribution majeure à l’intérêt général.
Avec 36 millions de vues désormais accumulées sur Youtube en seulement trois semaines, Kaizen, le dernier film de #Inoxtag, a surpris ses fans. Connu pour ses contenus digitaux divertissants, le jeune influenceur de 23 ans (qui a lancé sa chaîne YouTube à 13 ans) a décidé de tout plaquer pendant un an pour partir à l’aventure en haute montagne, loin des écrans. Dans ce documentaire, il partage son expérience (sans oublier de mentionner les ravages de la sur-fréquentation touristique en haute montagne) : « en me déconnectant des réseaux et en me rapprochant de la nature, j’ai découvert des choses que je ne vivais et voyais pas – parce que j’étais tout le temps dans ce vide des vidéos, des écrans… La montagne c’est aussi la randonnée dans la nature, se lever tôt, voir le lever du soleil… j’ai découvert une vraie passion. La montagne m’a recentré, m’a aidé à clarifier mes pensées et à me reconnecter à l’essentiel, j’ai ressenti un calme que je n’avais jamais éprouvé auparavant. »
Selon l’institut CSA, 38% des 16-40 ans (et 59% des 16-24 ans) ont donc déjà vu ce documentaire qui pourrait bien changer leur perception du voyage : parmi les trois messages principaux qu’ils en retiennent, la reconnexion à la nature figure effectivement en bonne place pour 61% des spectateurs (avec le besoin de déconnecter des écrans et la notion de dépassement de soi) et résonne encore plus particulièrement auprès des moins de 25 ans.
Un retour à la nature et au grand air qui reflète un mouvement plus large, où de plus en plus de personnes reprennent conscience des bienfaits (pour notre santé, notre santé mentale, notre cerveau… et pour l’écologie) du contact avec les éléments naturels. Plusieurs études scientifiques, notamment celles de chercheurs en neurosciences, viennent appuyer ce sentiment.
Dans une fascinante étude sur « La sensibilité à la nature, levier de transformation écologique et sociale », tout juste publiée par La Fabrique Ecologique , le concept d’éco-sensibilité est mis en avant pour décrire notre lien sensoriel et émotionnel à la nature, un lien qui s’est étiolé au fil des générations.
Le rapport montre que plus nous perdons ce lien, plus notre santé mentale en pâtit. En effet, la psychologie moderne souligne que la « déconnexion » de la nature est une des raisons principales de l’augmentation des troubles mentaux et du stress. À l’inverse, se reconnecter avec la nature favorise le bien-être psychique, améliore la stabilité émotionnelle et renforce les liens sociaux. Mieux encore : « un lien plus étroit à la nature aurait une répercussion globale dans notre approche des enjeux écologiques, y compris lorsqu’ils touchent aux sujets climatiques, a priori sans liens directs ».
Autrement dit, s’arrimer plus fermement à la nature revient en effet à sanctuariser une posture écologique, à créer les dispositions d’un imaginaire soucieux de la planète. En plus évidemment de pouvoir fonder un projet politique plus large – car développer un lien sensible à la nature contribue à l’accroissement de notre stabilité et de notre bien-être individuel, tout en accroissant la cohésion et la solidarité du groupe quand ce lien est entretenu par un collectif.
Le problème, que décrit notamment le psychologue et universitaire américain Peter H. Khan avec sa théorie de l’Amnésie environnementale générationnelle, est que nous vivons dans un monde au sein duquel la référence à la nature s’appauvrit, du fait de la disparition massive du vivant, de l’artificialisation brutale des espaces sauvages et des dérèglements climatiques. Plus simplement dit : “lorsque on ressent moins la nature, on a moins envie de la protéger” – et le phénomène s’accroît au fil des générations.
Les études montrent ainsi qu’au fur et à mesure que la biodiversité décline dans le monde réel (la population de vertébrés a chuté de 68% depuis 1970 selonWWF , les batraciens et les poissons désertent les mangroves restantes, le ciel se vide de ses oiseaux et la terre de ses insectes), la nature et les paysages sont aussi de moins en moins présents dans nos imaginaires… ce qui diminue en retour notre demande de conservation et notre engagement à les protéger. Ainsi chez Disney, on recense 22 espèces animales dans les décors de Blanche Neige (en 1937), contre 7 dans Lilo et Stitch (en 2002) et aucune dans le film Chicken little (en 2005). Et en France, selon l’Enquête nationale nutrition santé, 39 % des enfants de 3 à 10 ans déclarent ne jamais jouer dehors pendant les jours d’école, ce qui va évidemment de pair avec l’augmentation du temps passé devant les écrans et la diminution du temps d’activité physique quotidienne.
Les travaux d’Anne-Caroline Prévot, chercheuse au CNRS, enfoncent le clou, en démontrant que le développement de la sensibilité à la nature ne peut se faire qu’à travers la fréquentation de celle-ci, y compris le contact avec les autres êtres vivants. Elle constitue donc un axe majeur pour la prise de conscience et le changement de représentation.
L’excellente journaliste spécialisée sur l’écologie Pascale d’Erm-Gasselin, de son côté, a démontré dans son documentaire #Natura, sorti en 2018, qu’une simple immersion dans la nature, même en ville, a un effet sur nous. Cela s’est clairement vu pendant la pandémie de Covid-19 : notre besoin de contact avec la nature est fondamental. Souvenons-nous du troisième confinement : les parcs sont restés ouverts, car les fermer aurait accentué le mal-être des gens, en rompant leur lien avec la nature. On a essayé de nous faire croire que nous pouvions vivre sans elle, dans un environnement purement minéral, mais le lien à la nature nous aide. Par exemple, lorsque nous sommes fatigués mentalement ou moralement, admirer une fleur ou un cerisier en pleine floraison, ou prendre un « bain de forêt, » procure une sensation de bien-être psychique, améliore l’humeur et nous fait sourire intérieurement. Ce rapport à la nature nous rend heureux sans qu’il soit question de consommation. Pascale D’Erm a également montré l’impact positif de la nature en milieu hospitalier, soulignant au passage que beaucoup de nos maladies proviennent de notre mode de vie consumériste.
Michel Le Van Quyen, chercheur en neurosciences à l’Inserm, approfondit dans son ouvrage Cerveau et Nature – Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde (publié en 2022) ce lien entre la nature et notre cerveau. Il explique comment la vue de paysages naturels, le son des vagues ou même les odeurs des arbres stimulent directement certaines zones cérébrales, en particulier l’amygdale, responsable de nos émotions. Les forêts, en particulier, jouent un rôle clé dans cette régulation émotionnelle : « le simple fait de passer un week-end en forêt peut avoir un effet positif prolongé sur notre système immunitaire et réduire le stress pendant plusieurs semaines », en plus d’améliorer la créativité, la concentration et l’humeur. D’où, en particulier, la vogue du shinrin-yoku (ce fameux bain de forêt) décrite dans le documentaire de Pascale d’Erm et qui se pratique depuis les années 80 dans tout l’archipel nippon : cette activité consiste à se connecter aux arbres via nos sens pour récupérer de nos efforts quotidiens, tempérer le stress ou la fatigue, renforcer le système immunitaire. Les médecins partisans de la sylvothérapie se déclarent même « persuadés que dans quelques années les médecins feront des ordonnances de bains de forêt plutôt que de médicaments ».
#JacquesTassin, chercheur en écologie végétale, en parle également dans Penser comme un arbre (2018) et évoque des recherches fascinantes sur l’impact direct des forêts sur la santé humaine. Il rappelle que « se promener en forêt active notre système parasympathique, responsable du repos et de la récupération du corps. » Il mentionne les études sur la façon dont les arbres stimulent notre immunité, via des substances volatiles (les phytoncides) qui permettent au bois de se préserver des infections microbiennes et qui activeraient nos lymphocytes : selon lui, une journée ou deux en forêt augmente pendant plus d’un mois l’activité des lymphocytes NK impliqués dans la régulation des cellules cancéreuses. Il mentionne aussi que les personnes âgées ayant accès à des espaces plantés d’arbres pour leurs promenades vivent au moins 5 ans de plus que dans une grande cité aux voies de circulation bruyantes et polluées (rappelons qu’en France, nous sommes près de 80% à vivre en milieu urbain). Il cite aussi des études américaines montrant une réduction des taux de criminalité dans les villes où la végétation est plus présente. Ces conclusions mettent en évidence le rôle crucial que jouent les espaces verts dans la régulation de notre humeur et de notre comportement social… Pour Tassin, cette relation entre l’humain et la nature ne date pas d’hier. « Nous avons été façonnés par les arbres », écrit-il, rappelant que pendant des millions d’années, l’humanité a vécu en interaction avec les forêts. Aujourd’hui, retrouver ce lien permet de réactiver des mécanismes ancestraux de bien-être et de calme intérieur.
Pour le philosophe Alexandre Lacroix, auteur de Devant la beauté de la nature (2018), ce retour à la nature ne doit pas être perçu uniquement sous l’angle du bien-être physique : il y a aussi une dimension esthétique et émotionnelle profonde. Lacroix explore l’idée que l’émerveillement devant un coucher de soleil ou un paysage sauvage peut être un moteur pour une réconciliation avec notre environnement. Il propose une « esthétique environnementale », où l’expérience de la beauté naturelle devient un levier pour une prise de conscience écologique – dans notre époque, saturée par les technologies, qui crée une atrophie sensorielle.
Pour confirmer et objectiver ces propos, La Fabrique Spinoza a publié en 2021 « Nature, Santé et Engagement : vers une nouvelle approche de la transformation écologique » qui a chiffré ces effets bénéfiques multiples de la nature sur la santé humaine et son rôle-clé dans l’engagement écologique :
· D’abord, la fréquentation de la nature aurait des effets bénéfiques sur la santé physique (réduction des risques de mortalité de 8 à 12 %, gain d’espérance de vie de 7 ans), ainsi que sur la santé émotionnelle, cognitive, et sociale. Par exemple, il est prouvé qu’une promenade de 90 minutes en milieu naturel réduit significativement les ruminations et états dépressifs.
· Ensuite, les personnes ayant un contact régulier avec la nature sont 23 % plus susceptibles de ressentir des émotions positives et d’adopter des comportements pro-environnementaux. La proximité avec un espace vert (à moins de 300 m) est particulièrement importante.
· Le concept de #biophilie, ou l’hypothèse que les humains ont un besoin inné de se connecter à la nature, est mis en avant. Même des éléments artificiels imitant la nature (comme des fractales dans le design) peuvent avoir des effets bénéfiques sur le bien-être. Et le seul fait de regarder un documentaire sur la nature atténue les émotions négatives, améliore l’humeur et stimule le bien-être. De même en entreprise, la présence de nature dans les bureaux augmente l’engagement, tandis que la présence de nature extérieure au bureau favorise une réduction du stress, une restauration de l’attention et une meilleure capacité à faire face au stress.
· Enfin, la proximité ou la fréquentation de la nature réduit les erreurs de 17 à 32 % dans les tâches répétitives, et une vue sur la nature en milieu hospitalier permet de réduire, comme déjà évoqué, l’usage d’antidouleurs et d’accélérer la guérison.
Au-delà de l’expérience personnelle, ces recherches montrent l’importance d’une reconnexion collective à la nature. Cela implique que les acteurs privés et les entreprises, en particulier, prennent davantage l’initiative d’intégrer plus d’espaces verts dans nos environnements de travail et de vie… ou de nous pousser à prendre l’air. Des marques de l’outdoor ou du sport en passant par les aménageurs et bâtisseurs des villes de demain, de la mobilité douce aux agences de voyage, des acteurs de l’éducation aux prestataires de loisirs, tous ont un rôle crucial à jouer pour promouvoir cette approche – et leur leadership dans cette transformation écologique peut non seulement contribuer à la santé mentale de leurs clients et employés, mais également accélérer les efforts de transition écologique de tous, tant il semble évident désormais que la reconnexion avec la nature est l’une des clés pour un engagement plus fort sur l’écologie, la biodiversité, le climat.. Quelques exemples ci-dessous pour vous en convaincre.
Aux États-Unis, l’enseigne de plein air REI (Recreational Equipment Inc.) est un exemple d’entreprise qui a pris à cœur cet appel à la nature. Depuis 2015, REI s’est rendue célèbre en devenant la pionnière du mouvement anti #BlackFriday : concrètement, elle ferme ses 190 magasins ce jour-là, encourageant ses employés et ses clients à « opter pour l’extérieur » (avec le hashtag #OptOutside devenu viral) et à passer la journée dans la nature (elle a passé un partenariat avec les Parcs Naturels américains qui sont gratuitement ouverts au public) plutôt que dans les centres commerciaux. Cette initiative, loin de nuire à ses performances économiques, a renforcé son image de marque « outdoor » et sa relation avec ses clients, tout en soulignant l’importance de la nature pour notre bien-être.
La campagne REI met en lumière un constat frappant : nous passons 95 % de notre temps à l’intérieur, une statistique qui reflète la déconnexion croissante entre les individus et la nature. REI, spécialiste des vêtements et équipements #outdoor, entend donc inverser cette tendance en encourageant les gens à sortir et à redécouvrir les bienfaits du plein air. En soulignant les effets positifs de la nature sur la santé mentale, physique et émotionnelle, REI cherche à inspirer un mode de vie plus actif et en harmonie avec l’environnement. Son message est clair : sortir, c’est non seulement un retour aux sources, mais aussi un geste de bien-être et de rééquilibre dans une époque dominée par les écrans et les espaces fermés.
REI fournit également une plateforme en ligne dédiée à la campagne, où les participants peuvent trouver des idées d’activités en plein air, des événements communautaires et des ressources pour profiter au mieux de la nature.
Mais l’influence de la nature ne se limite pas aux escapades en montagne ou en forêt. De son côté, le leader mondial des dalles de moquette Interface est un pionnier de l’écologie industrielle et du biomimétisme depuis le début des années 90 (dont j’ai bien connu le visionnaire fondateur Ray Anderson, hélas parti prématurément en 2011 – voir ma tribune écrite à sa disparition) et est devenu dans la foulée un chantre du design biophilique, qui vise à intégrer des éléments naturels dans les espaces de travail pour améliorer le bien-être des employés. Son rapport Human Spaces – the global impact of biophilic design in the workplace montre que ces environnements inspirés de la nature peuvent réduire le stress et augmenter la productivité des travailleurs : « nous avons découvert que même de petites modifications visant à intégrer la nature dans les bureaux pouvaient avoir un impact énorme sur la productivité et le bien-être des employés ». Sir Cary Cooper, psychologue et co-auteur avec Bill Browningdu rapport, affirme que des bureaux bien conçus, avec des environnements qui imitent la nature, des plantes, de la lumière naturelle et des matériaux organiques, augmentent de 15 % la créativité, de 6 % la productivité et réduisent de 15 % les taux d’absentéisme.
Cette approche ne s’arrête pas à la décoration : il s’agit de réintégrer des systèmes naturels dans nos espaces bâtis, bureaux ou maisons, pour booster la santé mentale et la satisfaction des occupants à une époque où l’épuisement professionnel est un problème de plus en plus pressant. Des entreprises comme LinkedIn ou Google ont déjà intégré ces principes dans leurs bureaux, avec des résultats impressionnants.
De ce côté-ci de l’Atlantique, Nature et Découvertes est un autre exemple d’entreprise ayant mis ces réflexions sur l’écosensibilité et la nature au cœur de son modèle économique et de sa mission. Fondée par Françoise et #FrançoisLemarchand en 1990, la chaîne de magasins (qui fut l’un des premiers clients d’UTOPIES et dont j’ai siégé au conseil d’administration pendant près de 12 ans) s’est donné pour mission de reconnecter les urbains avec la nature pour leur donner envie de la protéger. Inspirée par des modèles comme The Nature Company aux États-Unis, l’enseigne proposait dès le départ des produits incitant à l’exploration de la nature, tels que des livres, des outils pédagogiques, des lunettes astronomiques, des accessoires de plein air mais aussi des activités « dématérialisées », organisées avec des associations locales et visant à emmener ses clients et leurs enfants en pleine nature pour observer les oiseaux ou les étoiles, cueillir des champignons, etc.
Pionnière en matière de commerce responsable, Nature & Découvertes s’est aussi engagée, cohérence oblige, pour une consommation plus respectueuse de l’environnement. Ses magasins très biophiliques offrent ainsi une immersion sensorielle grâce à l’utilisation de matériaux naturels, d’éclairages doux et d’ambiances sonores inspirées de la nature….
L’enseigne (qui fut la seconde entreprise certifiée #BCorp en France, juste après Utopies… et quelques années avant son rachat par le groupe Fnac Darty ) a également créé la Fondation Nature & Découvertes, qui soutient des projets écologiques et de sensibilisation à la biodiversité. Chaque année, une partie des bénéfices est reversée à des initiatives liées à la conservation de la nature et à l’éducation environnementale, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise pour une société reconnectée à la nature.
Parmi les expériences d’immersion dans la nature qui ont le vent en poupe jusque dans les entreprises, on trouve notamment la Deep Time Walk, qui a vu le jour en Grande-Bretagne, au sein du Schumacher College de #SatishKumar. Cette marche immersive (à faire en pleine nature, idéalement, par cohérence avec le propos) qui retrace les 4,6 milliards d’années d’histoire de la Terre, en comprimant cette chronologie dans une promenade d’environ 4,6 kilomètres, rappelle à quel point nous, êtres humains, ne sommes qu’une infime partie de cette vaste histoire naturelle. Et nous invite à reprendre contact tout à la fois avec notre histoire la plus profonde et avec notre lien intime à la Terre. Elle permet non seulement de mieux comprendre l’urgence des enjeux écologiques auxquels nous faisons face, mais aussi de reconnecter nos actions quotidiennes avec la longue histoire de la Terre et de la nature, en retrouvant un sentiment d’humilité et d’appartenance à un tout beaucoup plus grand que nous. C’est ce dont témoignent les participants à ces marches, y compris Emmanuel Faber (ex-PDG du Groupe Danone et désormais à la tête de l’International Sustainability Standards Board (ISSB)), en parlant d’une prise de conscience profonde et d’un regain de respect pour la nature et la planète, rejoignant ainsi les bienfaits du contact avec la nature décrits par des neuroscientifiques. De Michelin au Groupe SNCF , en passant par Danone , Yves Rocher, Kering ou Groupe L’OCCITANE , les entreprises sont de plus en plus nombreuses à y convier leurs salariés (en #teambuilding) voire leurs partenaires…
Enfin, l’initiative The Edible Schoolyard, fondée en 1995 par la chef engagée #AliceWaters (également formée comme enseignante #montessori) et le physicien #FritjofCapra à Berkeley, Californie, introduit une approche novatrice de l’éducation à l’écologie, en liant l’alimentation et la nature. Les élèves de l’école Martin Luther King y apprennent à cultiver un potager biologique (à Berkeley c’est un ancien parking de l’école qui fut initialement converti en potager), à cuisiner leurs récoltes, à rencontrer les producteurs locaux (qui fournissent les produits complémentaires pour la cantine) et à comprendre les cycles naturels via l’histoire de ce qu’ils mangent, ce qui renforce leur écosensibilité. Comme le dit très bien #FritjofCapra, cette « classe au jardin ou en cuisine » peut servir tour à tour de support pédagogique aux mathématiques, à la physique-chimie, à la biologie évidemment ou à la géographie. Le concept permet de reconnecter les jeunes à la nature, en leur offrant une expérience sensorielle et pratique, tout en leur inculquant le respect du vivant et des écosystèmes. Comme le rappelle l’éditorialiste de The New York Times #MichaelPollan dans son livre « The Omnivore’s dilemma »(2006), l’ #alimentation est, fondamentalement, ce qui relie les Humains à la nature, à la fertilité de la terre et à l’énergie du soleil – parce que l’agriculture transforme les paysages, parce que nos aliments nous relient aux autres espèces, et surtout parce que la chaîne alimentaire n’est, depuis la nuit des temps, qu’une façon pour les espèces de se transmettre l’énergie solaire que seuls les végétaux ont la capacité de synthétiser – et que nous récupérons, sous forme de calories, quand nous mangeons ces plantes ou des animaux qui s’en nourrissent.
En valorisant l’alimentation comme vecteur d’apprentissage, l’initiative montre que l’éducation à l’écologie doit passer par l’expérience directe, et non par la simple théorie. Ce projet a depuis évolué en une ONG, The Edible Schoolyard Project qui s’est répandue dans plus de 5 000 écoles à travers des dizaines de pays, touchant des milliers d’élèves. En France, sous la houlette de Camille Labro et de son association L’école comestible, plusieurs écoles de six régions déploient des programmes inspirés par ce modèle, souvent en partenariat avec des associations locales. En intégrant le jardinage et la cuisine dans l’enseignement, ces écoles renforcent la relation des élèves avec leur environnement naturel, tout en favorisant une alimentation durable. Un mouvement à la fois mondial et multi-local qui témoigne du pouvoir de l’expérience pratique pour sensibiliser les jeunes à la nature via les enjeux d’une alimentation responsable.
Comme le souligne Gaspard Koenig dans sa récente chronique pour Le Figaro, « plutôt que de s’acharner à convaincre par la raison, à contraindre par les lois ou à inciter par la fiscalité, il faut réhabiliter l’expérience du vivant » et cette « sensibilité à la nature » sans lesquelles aucune transformation ne sera possible. Car l’écologie sensible ne se résume pas au calcul comptable des émissions de GES ou de l’empreinte biodiversité, ou aux analyses de vulnérabilité des entreprises, aussi indispensables soient-ils. Le philosophe fait écho au combat d’Elisée Reclus, pionnier de la science géographique du 19e siècle et anarchiste militant, pour introduire « le sentiment de nature dans les sociétés modernes » – un sentiment à la fois instinctif et lointain, « qui suppose d’accepter sans ricaner l’émerveillement quotidien d’un rayon de soleil ou d’un chant d’oiseau, et d’en faire une arme politique ».
De l’éducation qui doit sortir des salles closes jusqu’aux « villes-jardins » de demain (prêtes pour l’adaptation climatique), en passant par l’intégration de davantage d’espaces naturels dans nos vies quotidiennes et par un accès radicalement facilité à la nature sur un territoire « aujourd’hui quadrillé par l’enchevêtrement des normes et cadenassé par les droits de propriété », l’écosensibilité pourrait et devrait ainsi devenir une priorité éducative, sanitaire, économique et politique.
Car au fil de ces lectures, un fait s’impose : plus qu’un simple échappatoire, la nature est un remède essentiel pour nos esprits sursollicités, un espace de ressourcement physique et psychique, et peut-être même une solution pour repenser nos modes de vie et les aligner enfin sur les limites planétaires.
Une prochaine étape importante à cet égard est la #COP16, qui s’ouvre dans quelques jours, le 21 octobre, en Colombie, et représente une étape clé pour inverser la perte de #biodiversité. Selon toute vraisemblance, l’écosensibilité restera un angle mort des politiques publiques qui y seront discutées. Or si la biodiversité est essentielle, il est tout aussi crucial de renforcer notre lien avec la nature, afin de stimuler la volonté collective de la protéger. Un cercle vertueux reste à enclencher : en protégeant la biodiversité, nous créons plus d’interactions avec la nature, ce qui à son tour augmente notre sensibilité écologique et notre désir de préserver ces écosystèmes. Il est d’autant plus impératif que cette dimension soit davantage intégrée à l’avenir aux discussions et aux décisions internationales… tout comme à l’action des acteurs privés.
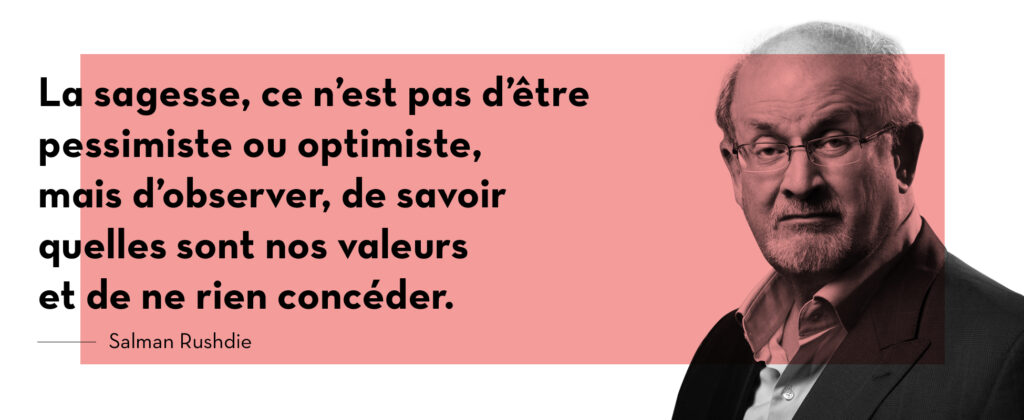
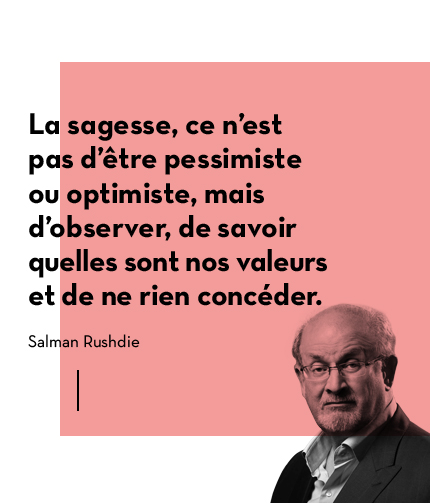
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire