
Et si les clés de la transition écologique et solidaire étaient en réalité moins techniques et économiques qu’humaines et sociales ? En entreprise, les acteurs de la transition semblent focalisés sur les nouvelles approches de comptabilité ou de reporting (qui, certes, comptent) et sur les solutions technologiques (évidemment nécessaires). Il faut dire qu’à l’extérieur, les activistes redoublent de chiffres et de faits scientifiques sur la catastrophe climatique et l’effondrement de la biodiversité pour convaincre les sceptiques… mais sans grand succès, car d’une part cela aggrave l’inaction et l’éco-anxiété, et d’autre part le déni et le backlash repartent à la hausse. Pour ne rien arranger, comme le dit le philosophe Gaspard Koenig, nos sociétés, et en particulier nos élites économiques et politiques, composées d’ingénieurs, d’administrateurs et de financiers, ont tendance à « rationnaliser, normer et quantifier le monde ». Cette approche a ses vertus, mais, lorsqu’elle devient exclusive, elle peut nous rendre aveugles à d’autres dimensions essentielles : on s’enflamme ainsi pour l’IA avec « une obsession de l’intelligence et une passion de la data »… sans remarquer que « cela nous empêche de voir le vivant, nous détache de la sensibilité, nous déconnecte de notre environnement et va à l’encontre de la prise en compte des limites planétaires » autrement que sous forme de tableaux Excel. Cette dynamique est bien illustrée, à mon sens, par le chaos qui entoure les débats autour de la CSRD. Ce texte, à l’origine utile et bien intentionné, a d’abord été alourdi par l’ambition réglementaire de Bruxelles (une boîte à outils déjà dense avec 12 thématiques ESRS, une myriade de sous-enjeux et plus de 1000 data-points – dont 220 pour le seul climat, intégrant des indicateurs qui sont dits « narratifs » et même « semi-narratifs » pour désigner les simples et nécessaires explications qualitatives). Puis, son interprétation exhaustive et maximaliste par les grands cabinets d’audit a contribué à en faire un exercice technique, rébarbatif et coûteux, où l’exigence de conformité a fini par éclipser la réflexion stratégique et la finalité même du reporting. L’économiste Charles Goodhart le résumait déjà en 1975 : lorsqu’un indicateur devient la cible, on rate l’objectif. Autrement dit encore : trop de reporting tue le reporting, aboutissant à l’inverse du résultat escompté – plus d’opacité, de lourdeur et de résistance que de clarté et d’action.
Dans ce contexte, et face à l’ampleur des changements à mener, loin de moi l’idée de ne pas nous appuyer sur la science, le reporting et les chiffres mais quand même : la philosophie, la sociologie, la psychologie, l’anthropologie ou l’histoire pourraient bien être les grands absents qui nous manquent pour réussir la transition. Car négocier avec soi-même et avec les autres, lever les résistances au changement, imaginer des solutions nouvelles à des problèmes inédits, construire les récits qui donnent du sens à nos choix et rendent désirable un monde plus durable, s’assurer que la mise en œuvre de la transition n’aille pas à l’encontre de la justice sociale… sont autant de compétences humaines essentielles à la redirection écologique que les humanités maîtrisent mieux que d’autres. De sorte qu’on gagnerait à maints égards à les réintégrer rapidement, au-delà des RH ou de la communication, dans tous les métiers et à tous les niveaux dans les entreprises (et dans les instances qui s’occupent de transition).
Le leader mondial du diabète Novo Nordisk , pionnier dans la prise en compte de la RSE dans ses pratiques, l’avait compris et pointé du doigt assez vite, dès son premier rapport sur le sujet paru en 2001, sous le titre éloquent de « Dealing with dilemmas » : la transition écologique amène avant tout celui qui s’y engage, individu ou organisation, à affronter des dilemmes complexes qui demandent une bonne dose de soft skills, le courage de reconnaître les difficultés et (j’y reviendrai dans un numéro ultérieur) un art subtil de la négociation.
Sur le (long) chemin de la transition, le premier pas commence d’ailleurs par la négociation… avec soi-même : à titre individuel, elle nous appelle en effet à changer nos habitudes et notre façon de prendre des décisions, à accepter de remettre en question nos priorités personnelles et professionnelles, et à aligner nos choix ou nos actes avec nos valeurs profondes. Comme si cela ne suffisait pas, une fois ce premier combat mené, vient ensuite la négociation en interne dans l’entreprise, pour mobiliser les équipes et aligner des fonctions dont les perspectives (et les échelles de temps) sont souvent divergentes. Enfin, la négociation externe est nécessaire pour trouver de nouveaux terrains d’entente et de collaboration avec les fournisseurs, les clients, les ONG et les investisseurs. À chaque étape, c’est la même histoire : il faut résoudre des tensions entre ambition radicale et pragmatisme incrémental, entre intérêts à court et à long terme, entre les valeurs et la valeur, entre réduction de l’empreinte carbone et protection des emplois, entre la fin du monde et la fin du mois…
Littéralement d’ailleurs, la transition écologique renvoie bien au besoin, pour l’humanité ou pour les entreprises, de « négocier » un virage, et cette redirection ne sera évidemment pas facile. Or « négocier », selon le dictionnaire, c’est aussi, de manière plus métaphorique, « manœuvrer habilement pour surmonter un obstacle ». Autrement dit : la transition est une négociation parce qu’il y a obstacle, antagonisme, divergence des intérêts. Cette négociation n’est pas de tout repos – mais c’est la difficulté même de la chose qui justifie qu’on l’entreprenne.
Pour mener à bien cette tâche, les sciences humaines et sociales apportent des outils précieux et les qualités particulières des négociateurs, que rappelle André Comte-Sponville : savoir se mettre à la place de l’autre ; chercher à concilier toujours son intérêt propre avec l’intérêt général, sans renoncer pour autant au premier, ni l’identifier au second ; savoir écouter, expliquer, proposer, comprendre, attendre… ; éviter de donner des leçons de morale ; faire preuve de lucidité plutôt que d’orgueil, de respect plutôt que de condescendance, de courage plutôt que d’agressivité ; ne pas compter sur les bons sentiments, et ne pas sous-estimer les mauvais ; chercher à convaincre plutôt qu’à séduire ; enfin, et surtout, être prêt à transiger quand il le faut, chercher le compromis plutôt que la victoire, la convergence des intérêts plutôt que celles des idées ou des affects.
Pourtant, dans Le Capital Lettres (paru en 2001), le regretté Alain Etchegoyen (qui fut mon inspirant professeur de philosophie en classe préparatoire à Louis-le-Grand) formulait déjà le constat que les entreprises ont trop souvent délaissé les sciences humaines et sociales au profit d’approches purement techniques ou gestionnaires. Et je ne suis pas sûre que cela ait beaucoup changé. Pourtant, insistait-il, c’est bien la culture générale, la philosophie, la psychologie ou encore la sociologie qui permettent d’aborder les situations complexes avec la profondeur et l’empathie nécessaires. Et de faire écho à l’éthique de l’altérité d’Emmanuel Levinas, qui souligne que placer l’autre au centre de nos préoccupations est la condition sine qua non pour faire avancer les choses. C’est particulièrement vrai dans un monde en quête de transitions écologiques et sociales durables – car cette éthique de l’altérité s’applique tout autant à notre relation avec la nature et les autres vivants… qu’à l’entreprise, où elle suppose d’écouter les besoins et les attentes des parties prenantes, dans une posture d’humilité et d’ouverture.
Une autre dimension-clef de la transition est liée au changement de comportements et de pratiques, dans nos modes de consommation autant que dans nos modes de production. Regardons les choses en face : changer est difficile, pour les individus comme pour les collectifs. Et comprendre les freins au changement—qu’ils soient psychologiques, culturels ou structurels—est un préalable indispensable à toute transition réussie.
Ici aussi, les apports des sciences humaines sont éclairants, par exemple quand ils inversent la perception courante que « quand on veut, on peut » (souvent utilisée pour renvoyer les consommateurs ou les citoyens à leur responsabilité, et au fait qu’ils ne changent pas, ou pas assez) pour affirmer que « quand on peut, on veut » (voir la note de l’IDDRI, parue en juillet 2024 ). Le message des auteurs (une équipe interdisciplinaire composée de sociologues, d’une philosophe, d’un ingénieur…) est simple et déterminant : c’est par la pratique, les gestes quotidiens, les environnements dans lesquels on évolue et les moyens concrets dont on dispose que nos préférences et nos modes de vie se fixent et se modifient. Il ne faut donc pas que les politiques et les entreprises cherchent uniquement à promouvoir une prise de conscience environnementale auprès de leurs salariés et clients – sous peine de voir celle-ci échouer ensuite à se traduire dans les faits… mais il convient avant tout de s’attacher à rendre possibles, faciles, attractives, et désirables les pratiques vertueuses dans le cadre d’un partage équitable des changements.
Les psychologues cognitifs comme Daniel Kahneman ont en effet montré que nos décisions sont souvent biaisées par des automatismes mentaux. Ces biais peuvent ralentir la mise en œuvre de changements nécessaires, mais les comprendre aide à les contourner. De ce point de vue, la sociologie et l’anthropologie, en particulier, offrent des clés pour analyser les dynamiques de groupe et les résistances culturelles.
Certaines entreprises l’ont bien compris. Et font appel à des anthropologues pour comprendre les freins culturels et psychologiques à l’adoption de certaines pratiques durables. Ainsi, Unilever, pour promouvoir l’utilisation de son savon #Lifebuoy comme moyen de prévention des maladies en Inde (renouant avec la vocation initiale de ce savon inventé à la fin du 19e siècle par William Lever pour combattre l’épidémie de choléra qui ravageait alors l’Angleterre), avait mené il y a une dizaine d’années des études anthropologiques qui ont révélé que des croyances locales et des habitudes bien ancrées en limitaient l’adoption. En réponse, le groupe a conçu une campagne de sensibilisation axée sur des récits adaptés aux contextes culturels et impliquant les leaders des communautés locales – une approche qui a permis de lever les résistances, de changer les comportements, et d’obtenir des résultats mesurables en termes de santé publique.
Mélusine Boon-Falleur, doctorante à l’ENS, confirme que les sciences cognitives gagnent à être mobilisées davantage pour travailler le changement de pratiques (par les nudges notamment) : « d’abord, il faut simplifier l’information et beaucoup de choses peuvent être faites sur la façon de visualiser l’impact de nos actes, d’aider les gens à comparer et à faire leur choix, … Ensuite, sur le climat par exemple, comme il s’agit d’un enjeu diffus, distant dans l’espace et le temps, il faut ramener l’action à des bénéfices à court-terme, plus parlants et impliquants, comme la santé : c’est possible sur la fast-fashion (en parlant des nombreux produits chimiques que l’on trouve dans les vêtements) mais on peut aussi parler du bruit ou de la pollution en centre-ville, plutôt que de climat, pour promouvoir les voitures électriques (comme cela s’est passé à New-York pour les taxis il y a quelques années). Ce sont des sujets plus directs et concrets mais aussi plus locaux et plus motivants. Il y a aussi le levier de la validation sociale : on ne fait jamais les choix seul.e, donc c’est utile de montrer que d’autres les font aussi – cela marche sur les consommateurs mais aussi sur les collaborateurs en interne ou les fournisseurs en externe, en parlant d’autres entreprises qui ont mis des programmes similaires. Enfin, on peut aussi impliquer les consommateurs, les salariés et les fournisseurs. Et leur dire : « on aimerait changer et aller dans cette direction, voici pourquoi, peut-être que cela va vous coûter plus cher ou vous demander des efforts, mais voici les options qu’on explore : êtes-vous pour ou contre ? Est-ce que vous nous soutenez ? »
De manière croissante, d’ailleurs, les scientifiques du GIEC comme François Gemenne, soucieux de « réduire l’écart entre la cause qui nous inquiète et les intérêts qui nous gouvernent », osent affirmer haut et fort, parfois à l’encontre de leurs collègues, qu’il faut cesser de vouloir convaincre avec des chiffres ou en déployant une rhétorique de l’effort et du renoncement (qui montre aujourd’hui ses limites avec le rejet des élites et le concept d’écologie « punitive ») : Gemenne rejoint ainsi la philosophe et sociologue Dominique Méda (voir son dernier livre « Une société désirable – Comment prendre soin du monde » paru chez Flammarion) en appelant à se concentrer au contraire sur ce qui peut rendre l’action désirable à court-terme (par exemple la santé pour le vélo, les économies pour l’isolation de sa maison ou le flexitarisme, le lien social et les rencontres pour le covoiturage) – en valorisant l’intérêt individuel à agir, en s’appuyant sur des solutions concrètes et facilement accessibles. C’est ainsi que les vélos en libre-service ont, depuis leur apparition pionnière à La Rochelle en 1976 sous l’impulsion du maire écologiste Michel Crépeau, démontré de manière tangible pourquoi une ville décarbonée est aussi dans l’intérêt à court terme des citoyens, en permettant un gain de temps, une amélioration de la forme physique, et une simplification des déplacements.
IMAGINER DES SOLUTIONS NOUVELLES GRACE AU DESIGN-THINKING QUI CROISE LES POINTS DE VUE
La transition ne peut donc se réduire à des chiffres et des indicateurs abstraits ou alarmants. Les limites intrinsèques de ces données et celles de notre cerveau face à elles (la sidération, le déni, l’éco-anxiété, l’inaction) sont désormais connues. Comprendre ces réactions permet d’enrichir les approches en y intégrant davantage, by design et en amont, d’émotions et de récits engageants.
D’où la nécessité cruciale d’avoir demain dans les entreprises des designers « complets », dont la créativité aura été nourrie tout autant des sciences humaines et sociales que des arts ou des sciences de l’ingénieur : pour Dominique Sciamma, directeur de CY École de Design créée en 2020 avec l’ESSEC, c’est à ce prix que l’on formera demain « des designers à la hauteur des défis de l’anthropocène, capables d’embrasser tous les enjeux des vies humaines, et plus encore du vivant, pour prendre soin des autres et du monde ».
En mobilisant des approches comme le design thinking et l’intelligence collective, ces designers d’un nouveau genre aident à co-créer, souvent avec les usagers futurs, des solutions adaptées aux contraintes humaines et organisationnelles… Une référence-clé dans ce domaine est l’agence IDEO, pionnière depuis 1991 des équipes pluridisciplinaires qui rassemblent créatifs, designers, sociologues, psychologues et ingénieurs pour co-créer des prototypes de services et produits répondant à des défis complexes. Par exemple, IDEO a conçu la souris d’Apple tout autant que travaillé sur des solutions innovantes pour l’accès à l’eau potable dans les pays en développement, combinant empathie, créativité et viabilité pratique. A Stanford University, la d.school (Hasso Plattner Institute of Design) fondée en 2005 par le même David Kelley, cofondateur d’IDEO, incarne cette approche qui croise les sciences et les humanités pour faire émerger des innovations concrètes et impactantes. La Stanford d.school a ainsi réuni des étudiants en ingénierie, biologie, et sciences humaines pour développer des prototypes d’équipements médicaux à bas coût, comme un incubateur néonatal portable et à faible coût, conçu pour les bébés prématurés dans les pays en développement.
J’ai déjà écrit ici sur le pouvoir et la nécessité des récits. Dans un monde en pleine mutation, les récits ne sont plus de simples divertissements ou exercices de communication, mais bien des leviers de transformation, qui donnent du sens à nos actes, ouvrent le champ des possibles, nous engagent un peu plus dans le monde, et façonnent la société en profondeur. L’imaginaire collectif, alimenté par ces récits, influence profondément nos valeurs, nos comportements et nos aspirations. Alors que les défis environnementaux et sociétaux atteignent un point critique, la durabilité devenant un enjeu de pérennité, voire de survie pour l’humanité et les entreprises, le rôle des récits dans l’orientation de notre avenir est plus crucial que jamais. Dans un monde où les entreprises doivent capter l’attention en quelques secondes, l’art du #storytelling est donc devenu une compétence stratégique pour engager non seulement les clients, mais aussi les collaborateurs dans des projets de transformation durable. Le récit, bien maîtrisé, est un moyen de rendre les transitions concrètes et mobilisatrices – dans l’entreprise mais aussi sur les territoires. C’est aussi l’objectif du « content marketing », par lequel les marques deviennent des médias, produisant des messages sur le monde et des contenus culturels qui doivent être à la fois intéressants, engageants et porteurs de sens.
Sans aucun doute, les littéraires, avec leur culture générale, leur maîtrise des mots et leur sens de la nuance, ont ici un rôle crucial à jouer. Et sont mieux armés, sans doute, pour éviter tout à la fois le jargon abstrait, les grandes déclarations générales et les mots-valises qui ne veulent plus rien dire à force d’être employés par tout le monde, puisque « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » (Boileau). Maîtriser de manière précise la langue écrite et orale n’est pas seulement un atout, mais une nécessité pour réussir dans l’environnement numérique où chaque mot compte, où le greenwashing fait des ravages, qu’il s’agisse d’un post ou d’une vidéo. Sur les réseaux sociaux, où la durée d’attention est réduite à quelques secondes, un récit puissant, des mots précis et une transparence assumée permet aux marques de se différencier et d’établir une connexion émotionnelle avec leur audience.
De nombreuses entreprises conçoivent donc désormais leurs contenus off-line ou en ligne comme des programmes culturels : ainsi Prada avait lancé un « théâtre de conversation » à New-York en 2012, en s’inspirant des salons littéraires – lequel fut relancé en ligne sous le titre #possibleconversations durant le COVID, en 2020. L’objectif : cultiver des échanges entre artistes, intellectuels et figures de la mode pour renforcer son positionnement haut de gamme. Un autre cas historique marquant est celui de #COLORS, le magazine fondé en 1991 par le regretté photographe Oliviero Toscani Studio et le designer #TiborKalman avec un financement de United Colors of Benetton (il était produit dans la Fabrica, le centre de R&D de la marque) : au fil de ses 90 numéros jusqu’en 2014, il a couvert des thèmes globaux comme le SIDA ou le consumérisme à travers des photos percutantes et des récits centrés sur « le reste du monde », alliant un journalisme engagé aux valeurs de la marque (diversité, égalité, fraternité, solidarité) en captant l’attention d’un public international sophistiqué. Elu parmi les 50 magazines les plus influents de leur temps par le quotidien espagnol La Vanguardia, COLORS reste à date un exemple unique de la façon dont un récit visuel et une approche éditoriale engagée peuvent positionner une marque comme un acteur culturel autant qu’économique.
De telles initiatives innovantes, témoignant de l’hybridation croissante entre contenu culturel et commerce, se multiplient ces dernières années, tout particulièrement dans le luxe : Miu Miu, par exemple, a exposé fin 2024 une double initiative artistique au Palais d’Iéna, dans le cadre d’Art Basel Paris. Elle y a présenté sa prestigieuse commission cinématographique semestrielle Women’s Tales, qui, depuis 2011, invite des réalisatrices telles que Zoe Cassavetes, Mati Diop, Miranda July ou Alice Rohrwacher à livrer leur vision de la féminité à travers des courts-métrages uniques, avec aussi des installations et œuvres multimédia d’artistes comme Sophia Al-Maria, Cécile B. Evans et Jeong Geum-hyung, précédemment dévoilées lors des défilés de la maison depuis 2021.
De son côté, Monocle, magazine fondé en 2007 (dont le dernier numéro, daté de février 2025, comprend justement un plaidoyer pour les vertus de l’écrit, rappelant études à l’appui qu’écrire à la main favorise la réflexion, la mémoire et la créativité bien plus que le fait de taper sur un clavier), a rapidement étendu son influence en ouvrant dès 2008 une première boutique à Londres, suivie de points de vente à Hong Kong, Tokyo, New York, Singapour et désormais à Paris, où il propose des produits mêlant artisanat, luxe et culture, en phase avec son univers éditorial. De même, J.M.Weston, pour célébrer les 120 ans de sa Manufacture, a publié en 2024 un beau livre en collaboration avec Le Cherche Midi Éditeur, où l’écrivain Didier van Cauwelaert raconte avec émotion les liens qu’il a tissés avec les célèbres chaussures françaises, ajoutant ainsi une touche littéraire à son approche consistant à inviter des artistes et intellectuels à exprimer leur vision de la chaussure. Plus récemment, Saint Laurent s’est aventuré, sous la houlette de son directeur artistique Anthony Vaccarello, dans le domaine du cinéma avec Saint Laurent Productions, qui a co-produit et présenté en 2024 trois films au Festival de Cannes, dont Emilia Pérez de Jacques Audiard, avec Zoe Saldana et Selena Gomez. Ces initiatives illustrent la capacité des marques à transcender leur secteur d’origine pour devenir des acteurs culturels majeurs… et pas juste via leur fondation ou leur mécénat. Ce qui appelle, forcément, en interne, de nouveaux profils plus créatifs au bagage culturel solide, même si naturellement, cette hybridation s’inscrit dans une tradition historique pour des maisons comme #SaintLaurent, qui habillait déjà des figures emblématiques comme Maria Callas, créant des ponts durables entre mode, art et culture.
CES COMPETENCES A INTEGRER PARTOUT DANS L’ENTREPRISE, PAS SEULEMENT AUX RH OU A LA COMMUNICATION
En plus d’être encore rares dans les entreprises, les sciences humaines et les humanités sont aussi souvent confinées au champ des ressources humaines ou à des équipes spécialisées (à la communication notamment). Alors que leur apport devrait s’étendre à tous les métiers : le marketing (qui utilise beaucoup historiquement la sociologie ou la psychologie), la R&D, la finance, la communication, et même la production. Les sociologues peuvent aider à concevoir des produits plus inclusifs, les philosophes peuvent réfléchir à des modèles économiques éthiques, et les historiens peuvent nourrir les solutions de rétro-innovation, cependant que les designers aux profils hybrides peuvent proposer des solutions nouvelles et concrètes face aux défis inédits.
Ainsi l’enseigne suédoise IKEA a-t-elle collaboré avec des sociologues et anthropologues en Chine et au Japon dans les années 2010 pour comprendre les contraintes des petits espaces. Ces recherches ont conduit à concevoir des solutions de rangement verticales, des meubles modulaires comme des lits escamotables, et des cuisines compactes. Des adaptations qui ont rencontré un grand succès local et renforcé l’image d’IKEA comme marque attentive aux besoins régionaux.
Autre exemple : chez Veuve Clicquot, maison champenoise à l’héritage riche depuis sa création par Madame Clicquot en 1772, une historienne est employée pour préserver et valoriser le patrimoine de la marque, tout en faisant vivre ce riche passé dans des engagements contemporains qui renforcent son positionnement premium.
De même, l’Opération Phénix, créé en 2007 par l’Université Paris-Sorbonne avec #PWC et quelques grands groupes, est un dispositif qui œuvre à l’insertion professionnelle des diplômées et diplômés littéraires à des postes de cadre dans les grandes entreprises. Il propose notamment à des titulaires d’un master 2 en sciences humaines, art ou littérature d’élargir leurs perspectives de carrière en se formant au management en un an, en alternance dans une entreprise.
Enfin, à la tête des entreprises, les littéraires ne sont pas si fréquents. Citons quand même #SusanWojcicki, ex-PDG de Youtube, qui avait commencé par étudier l’histoire et la littérature à Harvard, et qui reste un exemple emblématique de littéraire à la tête d’une grande entreprise technologique.
Ces exemples montrent comment des entreprises de secteurs variés mobilisent des compétences littéraires et sociales pour apporter un regard neuf, résoudre des problèmes complexes et créer de la valeur. On assiste aussi, ces derniers temps, au retour des géographes dans les entreprises, où ils contribuent à repenser notre rapport au territoire. Qu’il s’agisse d’optimiser les implantations logistiques, de renforcer l’ancrage local ou de travailler sur les enjeux de résilience territoriale et de culture régionale, les géographes apportent une expertise précieuse pour mieux comprendre les dynamiques locales et globales – avec une sensibilité culturelle qui enrichit les stratégies d’entreprise.
Les humanités ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour la transition écologique. Elles permettent de remettre l’humain et le vivant au centre, de comprendre les complexités du monde, d’imaginer des solutions innovantes et d’éclairer des futurs désirables.
Et si nous osions les réintégrer au cœur de nos entreprises – non pas comme un « nice to have » à la communication ou aux RH, mais comme un élément structurant pour penser et agir différemment dans toutes les fonctions-clefs que sont le marketing, la finance, les achats, la production et évidemment la direction générale… ? Et ce, même dans des entreprises à forte intensité technologique ?
C’est particulièrement nécessaire au regard de la place prise par l’#intelligenceartificielle, l’automatisation ou les robots – qui va selon toute vraisemblance rendre les qualités humaines encore plus importantes pour les entreprises dans le futur. Des qualités que les profils littéraires sont amenés à développer durant leurs études de lettres ou de sciences humaines ou sociales, en aiguisant leurs capacités d’analyse et d’argumentation, leurs qualités rédactionnelles, leur esprit critique (une autre compétence de plus en plus précieuse dans le monde qui nous entoure), leur réflexion stratégique et leur culture générale vaste qui les rend capables de croiser les disciplines et de penser les ponts entre les spécialités.
Par ailleurs, dans un monde volatile et incertain, ces profils sont aussi mieux outillés, souvent, pour capter et analyser des tendances émergentes, un atout crucial dans un monde marqué par des transformations rapides.
Enfin, une autre dimension importante, qui est sans doute plus présente et mieux reconnue historiquement dans le monde anglo-saxons, est celle qui valorise la #diversité des profils et des parcours, notamment aux postes stratégiques, avec l’idée que c’est un atout majeur pour s’assurer d’avoir à bord la diversité des points de vue nécessaire à la résolution de défis complexes et inédits. Au même titre que la diversité de genre, d’origine sociale ou géographique, etc.
Il est vrai qu’en France, les élites restent largement formatées par des parcours techniciens et gestionnaires dans un système valorisant les grandes écoles, quand les formations littéraires et en sciences sociales ont longtemps été associées aux universités. Cette séparation les a marginalisées et a renforcé des préjugés sur l’inadéquation des littéraires avec le monde de l’entreprise, perçus comme trop théoriques ou éloignés des enjeux économiques. Cependant, une évolution notable s’opère aujourd’hui, avec des parcours de plus en plus hybrides, et des initiatives comme l’Opération Phénix citée plus haut, ou des doubles diplômes (universités et grandes écoles) qui forment des littéraires au management et des managers à la philosophie…. Cette hybridation réconcilie pensée critique et pragmatisme, théorie et action, compétences techniques et soft skills, offrant aux entreprises des profils aptes à poser les bonnes questions, à contextualiser les données, à anticiper les freins individuels ou collectifs, et à réintroduire du sens dans l’action. Bref, à relever les défis complexes et inédits de la transition écologique et sociale. Plus que jamais, comme l’écrivait #AlainEtchegoyen, il est urgent « d’aborder les lettres comme un capital et (de) montrer leur efficacité dans l’entreprise. »
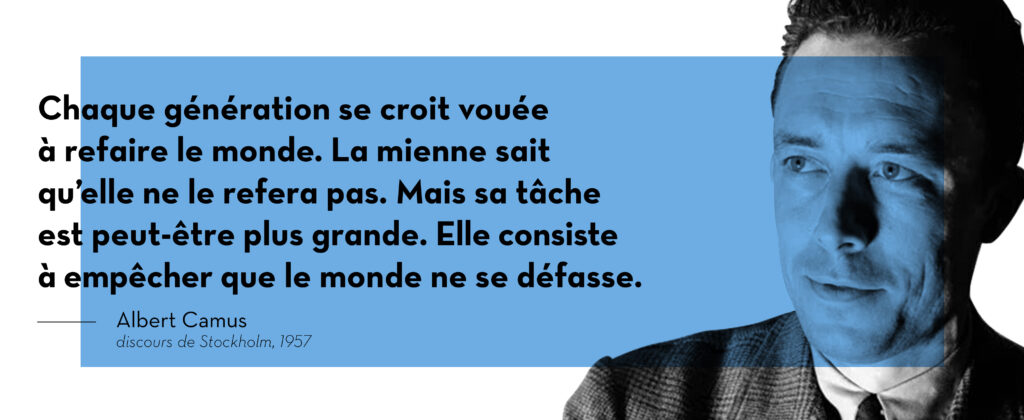
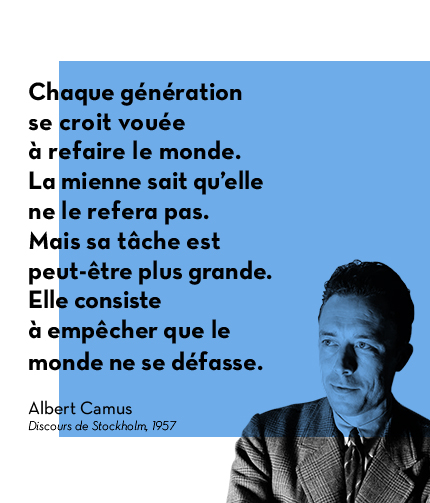
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire