
Dans le labyrinthe de la polycrise, la filière, comme l’indique son étymologie (le mot filière vient du latin filum, le fil – celui qu’on tisse, qu’on suit, qu’on relie) est un fil d’Ariane, celui qui permet de ne pas se perdre dans le mirage de la surproduction et de la surconsommation. Un fil d’éthique, de sens et d’intégrité – le fil qu’on tisse, qu’on suit, qu’on relie. À l’origine, ce filum désignait l’action de filer, de transformer la matière brute en un fil continu (petit clin d’œil aux filières textile). Par extension, il a fini par nommer la combinaison des mains, des savoirs et des gestes qui font naître un objet : la chaîne invisible qui mène de la terre à l’artisan puis à l’usage.
Ainsi comprise, la filière est un mot non pas technique mais profondément humain. Elle raconte l’histoire d’une matière, d’un atelier, d’un visage ; la mémoire d’un geste répété mille fois, avec soin. Elle relie l’éthique au concret, la pensée à la main, aux antipodes du système anonyme et mondialisé : ici, chaque étape, chaque nom, chaque lieu compte. Refaire filière dans l’économie globalisée, c’est ainsi ni plus ni moins que retisser du sens. En revenant à la proximité, à la traçabilité, à la confiance. En faisant en sorte que chaque produit raconte non seulement une fonction, mais une relation – entre celle ou celui qui le crée, celle ou celui qui l’utilise, et la Terre qu’ils partagent.
A l’heure de la décarbonation et de l’impératif d’une transition juste, les filières et les circuits courts réactivent cette intuition ancienne, en s’imposant comme des leviers essentiels pour la transition écologique, économique et sociale. Originellement très présents dans l’alimentation, ils racontent la proximité entre producteurs et consommateurs, réduisent les intermédiaires et les distances, recréent du lien entre l’humain et la matière, redonnent de l’épaisseur au geste artisanal, au terroir, au patrimoine et au sens.
Mais leur vertu la plus profonde tient à la proximité, au sens que lui donnait Bruno Latour qui n’y voyait pas une question de kilomètres : être proche, c’est être en relation. C’est voir les conséquences de ses actes, prêter attention à ce qui nous relie. Dans un monde d’éloignement, de virtualité et d’abstraction, la filière réintroduit du concret, de l’altérité, de la responsabilité, du soin et de la réciprocité.
Dans le très bon petit livre éponyme du collectif Osons les Territoires (Éditions Le Pommier) les auteurs (dont Pierre Calame et Jean-François Caron) posent d’ailleurs de manière très pertinente que les crises que nous connaissons sont d’abord des crises de la relation — entre l’humanité et le vivant, entre l’économie et la société, entre les humains eux-mêmes. Pour eux, la solution doit reposer sur des acteurs pivots capables d’organiser les relations et les coopérations entre différents types d’acteurs autour d’un projet commun, qui relie économie, société et environnement. Ils citent deux acteurs : les territoires, et les filières (souvent associées aux territoires, qu’ils soient proches ou lointains). Car celles-ci, a fortiori quand elles sont écologiquement et socialement durables, reposent par définition sur un lien au terroir et à un patrimoine local (qu’il soit naturel, culturel ou industriel), sur une répartition équitable de la valeur entre les acteurs, sur une traçabilité des pratiques et des impacts tout au long du cycle de vie des produits, sur des normes écologiques et sociales exigeantes à chaque étape. Autant de sujets clés dans la transition qu’il nous faut faire advenir.

Par filière, on entend ici une chaîne de valeur organisée et traçable, reliant dans une coordination volontaire et une gouvernance commune tous les acteurs qui transforment une ressource (naturelle, énergétique, agricole ou industrielle) depuis son origine jusqu’à son usage final. Plus qu’une succession d’étapes, les filières sont des écosystèmes relationnels où l’économie devient collective, territoriale et durable. Et ces logiques de coopération, qui ont fait la preuve de leurs vertus dans l’alimentation, inspirent et irriguent désormais bien d’autres domaines : la construction, la santé, l’énergie, les médias, la banque, la cosmétique ou la mode. Elles redonnent aux territoires une autonomie perdue, replacent la valeur au plus près de ceux qui la créent, et incarnent une économie où la relation prime sur la transaction.
Jamais réductibles à un repli sur soi qui prendrait pour prétexte le localisme (c’est utile de le préciser au moment où ce sujet est hacké par les partis extrêmes), les filières représentent à mon sens un horizon très désirable : celui du redéploiement dans un monde où l’attention, la coopération et la répartition équitable de la valeur deviennent les principes structurants d’une prospérité partagée – le tout ancré dans une proximité qui n’est pas seulement géographique, mais d’abord humaine.
LES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES : UN NOUVEAU RECIT COLLECTIF
Cette redécouverte de la proximité n’est pas qu’un concept : elle s’incarne déjà dans le domaine alimentaire, où les circuits courts ont démontré qu’ils pouvaient concilier souveraineté, efficacité et lien social.
Le sujet est idéal car l’alimentation représente, fondamentalement, ce qui relie les êtres vivants que nous sommes, comme tous les animaux, à la nature, à la fertilité de la terre qui nous entoure et à l’énergie du soleil. Parce que l’agriculture transforme les paysages et les espèces, parce que nos aliments nous relient aux autres espèces, notre alimentation est révélatrice de notre relation à la nature et au local. Cela peut être difficile à percevoir aujourd’hui, mais même une barre chocolatée ou le contenu d’une boîte de conserve nous relie, dans une certaine mesure, à la nature et au local, de manière certes distanciée (et c’est une partie du problème). Car la chaîne alimentaire n’est finalement, selon Michael Pollan (dans l’excellent « The Omnivore’s dilemma » paru en 2006) et depuis la nuit des temps, qu’une façon pour les espèces de se transmettre l’énergie solaire que seuls les végétaux ont la capacité de synthétiser, et que nous récupérons, sous forme de calories, quand nous mangeons des plantes ou des animaux qui se nourrissent de ces plantes.

Avec l’avènement de la nourriture industrielle, les règles du jeu ont changé, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité : d’une alimentation dépendante à 100% de l’énergie solaire nous sommes passés à une chaîne alimentaire qui puise l’essentiel de l’énergie qu’elle consomme dans les carburants fossiles (une énergie qui vient aussi, initialement, du soleil mais qui est finie et non-renouvelable, contrairement à l’énergie solaire). Aujourd’hui, les trois quarts de l’énergie nécessaire pour notre alimentation sont en effet consommés après la production agricole, pour les phases de transport, transformation, emballage, conservation et distribution… qui ne se font plus en proximité. Ainsi nous exportons désormais la majorité de ce que nous produisons alors que, dans le même temps, nous importons la majorité de ce que nous consommons : les Etats-Unis exportent 1,4 millions de tonnes de bœuf et importent exactement la même quantité du même produit chaque année, l’Angleterre exporte 270 millions de litres de lait par an et en importe 170 millions, et en 2007 la Grande-Bretagne et l’Australie ont échangé 20 tonnes d’eau en bouteille (voir à ce sujet le film « Local food can change the world », produit par le think-tank Local Futures) ! Notre alimentation voyage plus que nous, de manière à nouveau irrationnelle : la moitié des fruits de mer pêchés en Alaska sont transformés en Chine… mais la plupart reviennent ensuite dans les supermarchés américains, où ils retrouvent des poires argentines emballées en Thaïlande et autres aliments d’absurdie ! Car ces pratiques de transport longues distances réclament aussi plus de traitements chimiques, d’emballages et de logistique carbonée pour que les produits restent « frais » à l’arrivée. A l’échelle locale c’est la même chose comme l’ont notamment montré les travaux d’UTOPIES sur l’autonomie et la résilience alimentaires : en France, l’autonomie alimentaire des aires urbaines est de 2% (2% seulement de ce qui finit dans nos assiettes, qu’il s’agisse de produits frais ou de produits transportés, a été produit sur le territoire) cependant que 3% seulement de ce qui est produit sur le territoire est consommé localement. A l’échelle nationale : dans l’agriculture, nous exportons 30 % de ce que nous produisons et importons 38 % de ce que nous consommons. Autrement dit, nos territoires sont en passe de devenir des plates-formes logistiques où transitent à longueur de journée, dans un sens et dans l’autre, des camions transportant peu ou prou la même chose ! Et ces pratiques ont des conséquences évidemment majeures – tant écologiques, sociales et culturelles.

Ainsi, l’alimentation industrielle est devenue une chaîne tellement longue et complexe que nous avons perdu le lien aux saisons ou au terroir : nous ne savons plus ce qui est cultivé dans notre région, ni à quelle saison sont cultivés les produits dont nous avons envie, nous voulons consommer tout, tout de suite, tout le temps, nous estimons normal de manger n’importe quel fruit ou légume quelle que soit la saison et en tout lieu. Peu importe, dans ces conditions, qu’une fraise importée par avion et achetée en France en mars consomme 24 fois plus d’énergie que le même fruit cultivé localement et acheté en saison, au mois de juin. Comment le saurions-nous d’ailleurs ? Nous ne nous demandons plus, ou trop rarement, d’où viennent les produits que nous consommons, nous ne nous interrogeons plus sur leur histoire et les conséquences de leur production sur les Hommes et les écosystèmes, près de chez nous ou à l’autre bout de la planète. Trop souvent, notre ignorance fait de nous des consommateurs peu exigeants et facilement satisfaits, attachés à quelques critères de choix simplistes (la marque, la qualité perçue, le prix, la disponibilité, l’envie d’acheter, etc.). Quand bien même nous nous intéresserions à cette information, il reste difficile, la plupart du temps, de savoir exactement l’histoire des produits que nous achetons. Les étiquettes et les publicités ne la racontent pas, ou alors de façon mensongère (voir par exemple la plupart des « herbes de Provence » ou des « escargots de Bourgogne » qui sont en réalité produits dans les pays de l’Est). Et cette opacité n’est pas un hasard, car la véritable histoire est encore trop souvent affligeante. « Manger industriel, c’est manger dans l’ignorance, sans conscience » affirme le journaliste et auteur américain déjà cité Michael Pollan. Une façon de rappeler qu’il n’y a pas de saveur sans savoir, que notre alimentation est fondamentalement une transformation de la nature en culture, et que le plaisir gustatif est renforcé, toujours, par la connaissance de ce que nous mangeons, par la proximité du terroir et des traditions qui ont amené l’aliment jusqu’à nous.
Si notre économie mondialisée est pour partie cette économie de l’absurde, l’alimentation est emblématique de ce qui pose problème… mais aussi des solutions qui sont à portée de main – notamment dans une relocalisation partielle, qui assure la sécurité alimentaire et la souveraineté des communautés et des agriculteurs… tout en stimulant la création d’emplois dans la transformation notamment (80 % de ce que nous mangeons est transformé). En écho à la déclaration du Président Emmanuel Macron pendant la Covid-19 (« Déléguer notre alimentation à d’autres est une folie ») et aux attentes des Français après la pandémie (93 % attendaient d’abord du gouvernement qu’il garantisse l’autonomie agricole de la France), il est urgent de revenir à une alimentation plus locale, qui seule est capable de sauver la planète… C’est notamment le combat historique de Helena Norberg-Hodge, fondatrice de Local Futures : « Les petites exploitations abritent 95 % de la biodiversité agricole mondiale ; les systèmes agricoles locaux restaurent le sol, les écosystèmes et la biodiversité ; Ils produisent aussi plus de nourriture par hectare ; ils créent plus de travail épanouissant et retissent les liens dans les communautés ; ils traitent les animaux de manière plus éthique ; ils fournissent de la nourriture durable et saine ; et les agriculteurs empochent 80 % du prix de vente sur les marchés fermiers locaux. » Ce mouvement pour une alimentation plus locale (et souvent biologique) est entamé : il a été boosté par la pandémie – d’autant plus que la défiance croît simultanément en matière de traçabilité et d’empreinte carbone (import-export, culture sous serre chauffée, production intensive), et que les produits locaux sont souvent plus abordables que certains produits bio importés, en cette période de tension sur le pouvoir d’achat.

Les consommateurs en sont conscients : Kantar montrait ainsi dès 2017 que les marques locales devancent, partout dans le monde, leurs concurrentes internationales ; ces dernières ne représentaient alors plus que 35,4 % des dépenses, tandis que les marques locales croissaient deux fois plus vite. En France, La Ruche qui dit Oui !, entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS et certifiée B Corp) créée en 2011 et qui compte désormais plus de 700 ruches sur le territoire, a triplé pendant la pandémie son nombre de commandes. 57,5% des clients s’y engagent pour soutenir les producteurs locaux, 38,3 % pour consommer plus sainement et 34,3 % pour découvrir de nouvelles saveurs.
Un autre exemple marquant est celui des bières artisanales. La France ne comptait plus que 200 brasseries en 2009 contre 3.500 à la fin du XIXe siècle. En 2022, elles étaient déjà 2.400, et aux États-Unis, marché pionnier, les bières artisanales représentaient la même année 13 % des volumes et 25 % du chiffre d’affaires. Ce modèle de proximité inspire : les circuits courts alimentaires racontent une autre histoire de l’économie, faite de lien, de traçabilité, de valeur partagée et de plaisir retrouvé.
De son côté, le mouvement Slow Food, né en Italie à la fin des années 1980 autour de Carlo Petrini, a été le pionnier de cette logique en reliant plaisir gustatif, diversité biologique et justice sociale. Son réseau international fédère aujourd’hui plus de 160 pays autour d’un principe simple : défendre une alimentation « bonne, propre et juste ». Le programme des #ProduitsSentinelles recense et protège ainsi plus de 600 produits agricoles ou artisanaux menacés de disparition – du pois carré du Berry au jambon noir de Bigorre, du fromage de chèvre du Mont Idiazabal au poivre sauvage de Madagascar. Chaque Sentinelle s’accompagne d’une filière organisée : producteurs, transformateurs, chefs et consommateurs coopèrent pour préserver un savoir-faire, assurer un revenu décent et maintenir un équilibre écologique local. Cette approche fait de l’alimentation non seulement un acte de subsistance, mais un projet culturel et politique, où chaque produit et chaque filière racontent la relation d’un territoire à son vivant.
En France, l’entreprise de commerce équitable SCOP ETHIQUABLE, créée en 2003, a également fait de longue date des filières équitables un levier de reconstruction pour des territoires fragilisés par les conflits. En Colombie, la coopérative COSURCA a soutenu la réinsertion d’anciens déplacés du Cauca après la démobilisation des FARC, en stabilisant les revenus et en structurant une filière café de qualité. En RDC, sur l’île d’Idjwi au milieu du Lac Kivu, la coopérative CPNCK a permis à 2 500 paysans de retrouver un débouché durable et un pouvoir de négociation collectif après trente ans de chaos économique et de guerre civile.

Dans le même esprit, Nestlé Nespresso SA (certifié B Corp) développe depuis 2011 le programme Reviving Origins, formalisé quelques années plus tard et destiné à réhabiliter des bassins caféiers menacés par la guerre ou les chocs climatiques– au Zimbabwe, en Colombie ou au Soudan du Sud. En partenariat avec des fédérations agricoles et des ONG, la marque forme les producteurs, restaure les savoir-faire et commercialise ces cafés en éditions spécifiques comme Suluja Ti du Sud Soudan ou Cafecito de Puerto Rico (qui soutient localement la réactivation de la filière café après les ouragans Irma et Maria). Nespresso ne publie pas de ventilation chiffrée des ventes issues de ce programme, mais celui-ci s’est étendu à sept filières différentes et fait désormais partie de sa feuille de route ESG.

Partout, ces projets prouvent qu’une filière bien conçue peut être un outil de sortie de crise : elle stabilise les revenus, reconstitue les organisations paysannes et redonne de la valeur au terroir. Là où les chaînes longues fragmentent, fragilisent et anonymisent, la filière raccourcit, relie et surtout elle répare.
La bonne nouvelle est que ce modèle des circuits courts alimentaires et d’échanges locaux, boosté par la Covid-19, marqué par une décentralisation et une réappropriation citoyenne, pourrait bien à terme inspirer d’autres secteurs variés, comme illustré ci-dessous pour les médias, l’énergie ou la banque. Sur le papier, les filières locales répondent en effet à la fois à la demande de traçabilité des consommateurs, au besoin de lien social entre ceux qui consomment et ceux qui produisent, aux enjeux de réduction du coût économique et écologique de la distribution, à la demande d’une meilleure qualité des produits et à la volonté de soutenir l’économie locale. Elles constituent ainsi un nouveau #récit collectif convaincant qui parle à tous, contribue à faire atterrir et à rendre désirable la #transition qu’il nous faut effectuer dans presque toutes les dimensions de la vie moderne, en donnant du sens à l’aventure et en motivant le plus grand nombre à faire l’effort de changer, ensemble.
LE DEVELOPPEMENT DES FILIERES DANS LA PHARMACIE ET LA COSMETIQUE : UN PARFUM D’AUTHENTICITE
Le secteur de la cosmétique et de la pharmacie illustre lui aussi la montée en puissance des filières locales et responsables. Ici, la traçabilité et la qualité des ingrédients se doublent d’une exigence de durabilité et de juste répartition de la valeur. Certaines marques ont été pionnières dans cette logique, bien avant qu’elle ne devienne un critère de marché.
Dès les années 1980, The body shop fondée par l’une de mes idoles et marraine d’Utopies à nos débuts, Anita Roddick (que j’ai eu la chance de rencontrer – voir son formidable livre « Corps & Ame » que j’aime tellement que je l’ai traduit avec Marie Balmain), a été la première marque à structurer de véritables filières équitables d’ingrédients naturels. Son programme Community Trade a relié, dès 1987, des coopératives agricoles et artisanales du Sud aux laboratoires de formulation britanniques. C’est ainsi que sont nées les filières historiques du beurre de karité au Ghana, de l’huile de noix du Brésil récoltée dans la forêt amazonienne, de l’huile de sésame du Nicaragua ou encore de l’aloe vera du Guatemala. Ces partenariats ont assuré à des milliers de femmes (notamment) un revenu régulier, la certification de leur savoir-faire et un accompagnement social dans des zones rurales souvent fragilisées. Aujourd’hui encore, malgré les difficultés récentes de l’enseigne, plus de 20 filières de commerce équitable font vivre quelque 12 000 producteurs dans 21 pays.
Conscient que l’un des écueils des filières cosmétiques reste souvent leur focalisation sur un ingrédient “symbolique” – beurre de karité, immortelle ou aloé – qui est mis en avant dans la communication ou sur l’étiquette mais qui ne représente souvent que quelques pourcents du produit final, The Body Shop a également développé historiquement une filière pionnière d’alcool bio et équitable pour ses parfums, en partenariat avec des producteurs certifiés au Brésil, garantissant traçabilité et juste rémunération sur un ingrédient qui constitue la majorité de la formule. Sur cette lancée, The Body Shop a lancé en 2019 une filière équitable de plastique recyclé, en partenariat avec l’organisation indienne Plastics for Change. Le projet garantit un prix juste et des conditions dignes à plus de 8 000 collecteurs de déchets (les waste pickers) à Bengaluru, dont le plastique est ensuite recyclé et intégré dans les flacons de la marque. Une approche qui montre que cette logique de filière peut s’appliquer même à un matériau industriel – en reliant production, transformation et consommation dans une même boucle vertueuse.

L’esprit pionnier de The Body Shop trouve aujourd’hui un écho en Amérique du Sud avec Natura (qui avait d’ailleurs racheté la marque britannique à L’Oréal en 2017 avant de s’en défaire en 2023). Depuis plus de vingt ans, la marque brésilienne a bâti un modèle fondé sur la valorisation des ressources amazoniennes à travers une cinquantaine de filières d’ingrédients issus de la forêt — açaï, andiroba, murumuru, cupuaçu, ou encore castanha. Ces matières premières proviennent de coopératives locales, encadrées par des programmes de gestion durable des forêts. En 2023, plus de 7 500 familles en Amazonie travaillaient directement avec Natura, qui s’engage à ne prélever que la ressource renouvelable tout en réinvestissant une part de ses bénéfices dans la régénération des écosystèmes. Ce modèle de “bioéconomie forestière” fait de la préservation du vivant une condition même de la prospérité économique.
Plus près de nous, le Groupe L’OCCITANE (certifié B Corp) a également été un précurseur dans la structuration de filières végétales locales. Ma préférée et la plus iconique est celle de l’immortelle de Corse (voir le rapport de filière ici), créée en 2004 avec une dizaine de producteurs locaux autour d’un contrat d’approvisionnement durable, élargi aujourd’hui à plus de 50 exploitants bio sur 50 hectares. Au total, le groupe a développé 71 filières (sur l’amande de Provence, la lavande, la verveine, le karité au Burkina Faso…) garantissant à quelque 10.000 producteurs et cueilleurs partenaires un prix juste et un appui technique pour la conversion au bio.

Enfin, les Laboratoires Expanscience (pionnier B Corp en France dans son secteur et dont la marque la plus connue est Mustela) incarnent une autre déclinaison de cette logique, en structurant des filières traçables et certifiées à chaque étape (y compris dans leur activité de fournitures d’actifs à leurs collègues de l’industrie cosmétique). La plus emblématique est celle de l’avocat (utilisée initialement dans les produits pharmaceutiques de l’entreprise, et désormais aussi en cosmétique) : l’entreprise a acquis en 2016 une usine au Pérou afin de maîtriser la transformation locale du fruit en huile vierge bio, réduisant les intermédiaires et l’empreinte carbone. Aujourd’hui, 19 filières végétales propres à Expanscience (maca, acacia, tournesol, karité…) sont ainsi engagées dans une démarche de commerce juste et de respect de la biodiversité, et 45% de ses filières d’actifs cosmétiques sont évaluées selon des référentiels reconnus favorisant des pratiques respectant et/ou régénérant l’environnement (via l’UEBT, Bio, ACS, FairWild, Fair For Life, ROC etc.).

Enfin, certains pionniers n’hésitent pas là aussi à utiliser la construction de filières pour apporter de l’aide durable à une communauté vulnérable : un exemple très significatif est apporté par l’entreprise de produits cosmétiques Dr. Bronner’s qui, après le tsunami au Sri Lanka en 2004, décida d’y bâtir une filière durable et lança en 2007 sa filiale Serendipol (Pvt) Ltd : une usine d’huile de coco vierge issue de l’agriculture biologique et équitable, travaillant avec plus de 1 200 agriculteurs locaux et traitant jusqu’à 30 millions de noix de coco par an. La filière intègre non seulement la collecte et la transformation, mais aussi la valorisation des co-produits (coques, fibres, eau de coco), l’agroforesterie régénératrice (Dr Bronner’s a créé avec Patagonia l’exigent organisme de certification bio-régénératrice Regenerative Organic Alliance) et un programme d’appui communautaire financé par les primes du commerce équitable.
Ces différentes approches montrent que les filières cosmétiques et pharmaceutiques sont devenues des laboratoires de transformation silencieuse : elles lient économie et écologie, science et solidarité, ancrage territorial et commerce international. Elles prouvent qu’il est possible de bâtir des modèles d’affaires qui régénèrent les ressources et les communautés plutôt qu’ils ne les épuisent.
LES FILIERES DANS LA MODE ET LE DESIGN CIRCULAIRE : RETISSER LE FIL DONT EST FAIT LE TEXTILE
Parmi les secteurs en quête de transformation, la mode et le design textile sont sans doute ceux où la notion de filière prend aujourd’hui le plus de sens… jusque dans ses excès puisque, par exemple, le secteur a été le premier à s’emparer du concept de régénératif à la suite des géants de l’alimentation… sans s’embarrasser de la certification ROC qui en faisait initialement la promotion (voir à ce sujet ma tribune co-signée avec quelques camarades dans Le Monde il y a quelques années). Ici comme ailleurs, le concept de filière interroge la traçabilité des matières premières, la relocalisation industrielle, la juste rémunération des producteurs, mais aussi la redéfinition du style et de la fonction à travers une éthique de la sobriété et de la responsabilité.
Le constat de départ est brutal : selon le Fashion Transparency Index 2024, seulement 52% des grandes marques de mode publient des informations sur leurs fournisseurs de rang 1 (confection), 37 % sur leurs fournisseurs de rang 2 (matières)… et à peine 11 % sur l’origine réelle des matières premières. Autrement dit, dans près de neuf cas sur dix, les grandes enseignes ignorent où et comment sont cultivés le coton, le lin ou le cuir qu’elles utilisent. Cette opacité alimente les scandales sociaux et environnementaux et démontre, en creux, la pertinence des modèles fondés sur des filières traçables et solidaires.
C’est précisément le pari initial des fondateurs VEJA, marque pionnière qui, depuis 2005, a bâti un modèle de production fondé sur la transparence et l’engagement – avec la volonté affichée de déconstruire la basket traditionnelle pour la reconstruire à coups de filières responsables, en y investissant les quelque 70% du prix qui finissent généralement dans le marketing. Privilégiant donc l’histoire vraie au story-telling bien troussé, ses baskets sont issues de deux filières emblématiques : celle du coton biologique brésilien, cultivé par des coopératives certifiées Fair Trade dans le Nordeste, et celle du caoutchouc sauvage collecté dans la forêt amazonienne par les seringueiros (la marque est devenue le premier acheteur de latex naturel, prélevé sans abattre les arbres, qu’elle achète cinq fois plus cher que le prix du marché). Certifiée B Corp, l’entreprise travaille depuis toujours sans publicité ni sous-traitance cachée (voir le récent épisode du podcast Génération Do it Yourself avec Sébastien Kopp, l’un de ses deux fondateurs) et fait acte de transparence totale, via son site web, sur ses coûts, ses marges et ses partenaires – une rareté dans le secteur. Cette exigence de traçabilité absolue est devenue sa signature et en a fait une référence mondiale en matière de mode responsable.

La dynamique de filière s’incarne aussi en France, avec le projet L’inpossible, mené par Thomas Huriez de 1083 et Guillaume Gibault chez Le Slip Français. L’objectif : reconstituer en France une filière complète du lin – du champ à la filature, du tissage à la confection – après des décennies de délocalisation. Alors que France (premier producteur mondial) produit les 3/4 du lin planétaire, et alors que toutes les étapes de la transformation du lin sont réalisables en France à l’exception de la filature (depuis la fermeture de la dernière filature hexagonale Safilin en 2005), l’essentiel est désormais filé en Chine ou en Europe de l’Est. D’où le projet du collectif L’inpossible de réinstaller une capacité industrielle locale pour réduire drastiquement l’empreinte carbone d’une fibre pourtant écologique. C’est un geste à la fois économique, culturel et politique : redonner vie à une filière oubliée, à ses savoir-faire et à l’idée d’un textile « né, filé et tissé ici ».

Cette logique s’étend à d’autres matières et fonctionne aussi très bien pour ce qui concerne l’économie circulaire. Plusieurs marques – dont Les Récupérables ou HOPAAL – travaillent ainsi avec 1083 et Le Slip Français à la structuration de filières de coton recyclé (projet mon coton), de laine revalorisée ou de textiles upcyclés, souvent en partenariat avec des ateliers d’insertion ou des entreprises locales de tri textile. Malgré les difficultés rencontrées par l’usine Renaissance Textile, ouverte en novembre 2022 en Mayenne pour recycler les vieux vêtements et « mise en sommeil » début 2025 par ses actionnaires TDV Industries et Les Tissages de Charlieu (faute de débouchés suffisants et dans un contexte d’invasion de l’ultra-fast-fashion), ces initiatives dessinent une nouvelle géographie du vêtement : plus courte, plus lisible, plus incarnée.
Dans cette même lignée, des pionniers du textile outdoor et du design industriel ont ouvert la voie à des filières circulaires globales. Dès 1993, Patagonia été la première marque de vêtements à concevoir des polaires en bouteilles plastiques recyclées : plus d’un milliard et demi de bouteilles PET ont depuis été transformées en vêtements, à travers une filière maîtrisée reliant les centres de collecte américains à ses usines partenaires. L’entreprise a également mis en place des programmes de reprise (Worn Wear) et de refabrication, prolongeant la durée de vie des produits tout en bouclant la boucle de la matière.

De son côté, Interface, leader mondial de la moquette, a lancé en 2014 le projet Net-Works, conçu en partenariat avec la Zoological Society of London (ZSL) et son fournisseur de fibres Aquafil Group. L’initiative consiste à racheter aux pêcheurs pauvres des Philippines, du Cameroun et de la Thaïlande leurs filets de pêche usagés, souvent abandonnés sur les plages ou au fond des océans, avec des conséquences écologiques désastreuses. Ces filets sont collectés, nettoyés et revendus à Aquafil (seul fournisseur d’Interface qui ait accepté de se lancer dans le projet) qui les transforme en fil de nylon régénéré ECONYL® brand, ensuite racheté par Interface pour produire ses dalles de moquette 100 % recyclées. En dix ans, le programme a permis de recycler plus de 300 tonnes de filets et d’améliorer durablement les revenus et les conditions de vie de plusieurs milliers de familles de pêcheurs.

Ces deux modèles – Patagonia et Interface – démontrent que les filières circulaires peuvent s’étendre à l’échelle mondiale tout en gardant un ancrage humain et environnemental fort : relier des déchets à des ressources, des communautés locales à des chaînes de valeur globales, des enjeux de survie économique à des logiques de préservation du vivant.
Et surtout, la mode et le design, à travers ces filières pionnières, cessent d’être les symboles d’une économie du jetable pour devenir les laboratoires d’une économie du fil et du lien : une économie où chaque fibre et même dans les exemples données chaque bouteille ou chaque filet de pêche retrouve une histoire, une valeur et une responsabilité.
CONSTRUIRE AUTREMENT : LES FILIERES LOCALES DE LA TRANSITION
Le secteur de la construction, responsable d’une part majeure des émissions de CO₂ et des déchets en France, explore lui aussi de nouvelles voies fondées sur les filières locales et les circuits courts. Trois approches illustrent cette mutation : la terre crue, la paille et le réemploi.
La filière terre crue retrouve aujourd’hui un intérêt croissant, loin de l’image de la maison traditionnelle et rudimentaire africaine dont la formidable Association la Voûte Nubienne essaie de promouvoir à nouveau les vertus (économies, confort et écologie) et de re-développer les savoir-faire associés localement, depuis des années. Mais les bâtiments récents en terre crue allient les vertus d’un sourcing local au design d’architecte contemporain et à une capacité de déploiement sur plusieurs étages et sous toutes latitudes – comme l’a montré l’excellente et récente exposition de l’architecte et journaliste Dominique Gauzin-Müller au Pavillon de l’Arsenal.
Ainsi le promoteur REDMAN a-t-il récemment livré les bâtiments de l’Université de Dakar (Sénégal) avec une construction bioclimatique à base de briques de terre cuite locale (produite par une briqueterie développée spécialement pour le projet), tandis que l’architecte Maud CAUBET a de son côté sur le projet Vianova réhabilité un bâtiment à Lyon à base de briques de terre crue prélevée à une trentaine de kilomètres et qu’à Châtenay-Malabry, l’architecte Samuel Delmas a utilisé ce même matériau pour l’école primaire Voltaire récemment livrée sur l’ancien site de l’Ecole Centrale (les murs sont en ossature bois avec remplissage en terre-chanvre, et enduit en terre, et les terres utilisées ont été approvisionnées à partir d’anciens stocks présents en Île-de-France).


En Nouvelle-Aquitaine, le collectif Odéys a d’ailleurs publié un livret de référencepour promouvoir l’usage et le potentiel de ce matériau ancestral et bas carbone – via la mise en avant de différents projets locaux dont plusieurs sur la ZAC de Biganos.
La filière paille connaît de la même façon un renouveau récent, notamment porté par le réseau français de la construction paille. Elle offre une performance thermique remarquable à faible coût, avec des projets emblématiques comme le lycée de Montbrison (Loire), inauguré en 2018 et construit avec 1 600 bottes de paille locales. Ces bâtiments démontrent que la paille, ressource agricole abondante et locale, peut être valorisée à grande échelle dans d’autres secteurs que l’agriculture : c’est tout le sujet de la bioéconomie territoriale.
Enfin, la filière réemploi illustre la mutation circulaire du BTP. Chaque année, le secteur génère près de 46 millions de tonnes de déchets, soit 70 % du total national, mais seuls 1 % sont aujourd’hui réemployés – un chiffre que les pouvoirs publics voudraient porter à 2 % en 2024 et 4 % en 2027. Trois projets récents montrent l’ampleur des possibles : à Vannes, la déconstruction d’un bâtiment de 5 500 m² a permis de valoriser 95% des 750 tonnes de matériaux déposés sur le chantier, dont 33% ont pu être réemployés dans de nouveaux projets locaux ; à Paris, le chantier Avant Seine mené par VINCI Construction avec Ecomaison et Ecominéro a intégré systématiquement le réemploi ce qui a permis concrètement de réemployer 744 tonnes de matériaux, parmi lesquels 22680 m2 de dalles de faux-plancher, 9821 m2 de dalles de faux-plafond, 206 cuvettes de WC, 196 sièges d’auditorium, 156 m2 de pierres agrafées, 100 m2 de carreaux de verre… ; enfin en 2025, HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH a déposé près de 100 tonnes de matériaux de façade, sanitaires et dalles sur la déconstruction de la Résidence pour Personnes Agées Pasteur de Nanterre, les rendant disponibles pour d’autres projets locaux de Hauts-de-Seine Habitat ou d’autres entreprises de la construction.

Ces trois matériaux – terre crue, paille et réemploi – incarnent la promesse de construire autrement, en structurant les filières bâties sur des ressources locales, renouvelables ou circulaires, pour inventer un habitat bas carbone et résilient.
LES FILIERES ET LES CIRCUITS COURTS DANS LES MEDIAS : UN REMPART CONTRE LES FAKE-NEWS
Comme pour l’alimentation, où les circuits courts répondent à un besoin de proximité, de confiance et de traçabilité, les médias vivent une crise de confiance qui appelle des solutions similaires. Les Français sont aujourd’hui très divisés sur la crédibilité des médias traditionnels : seuls 52 % déclarent avoir confiance dans la presse écrite et 48 % dans la télévision, tandis qu’un Français sur quatre seulement juge crédibles les informations trouvées sur Internet (à juste titre puisque 67% des informations qu’on y trouve ne sont que du « copier-coller » de base, sans aucun travail de construction ni de vérification, rapporte Julia Cagé – un phénomène qui devrait s’aggraver avec le développement des IA génératives qui finiront par produire de l’information générée à partir de textes déjà produits avec de l’intelligence artificielle). Ce déficit de confiance est accentué par l’industrialisation de l’information, la course au clic et la prolifération des fake-news, dans un contexte de « surabondance » qui conduit à ce que certains chercheurs appellent « l’infobésité ».
L’analogie avec l’alimentation est éclairante. Comme le souligne Jodie Jackson dans son livre « You are what you read », consommer de l’information revient à adopter un régime alimentaire : certains choix nuisent à la santé mentale, d’autres la renforcent. Le journalisme de solutions, qui s’intéresse aux initiatives et non seulement aux problèmes, agit comme une alimentation plus équilibrée : il donne envie d’agir, renforce la confiance en soi et en l’avenir. À l’inverse, l’information anxiogène et standardisée, souvent répétée sans vérification, entretient la défiance et l’impuissance.

Face à cela, les « filières courtes de l’information » se développent. La presse régionale joue un rôle crucial : près de 70 % des quotidiens vendus en France sont régionaux ou départementaux, ancrés dans les territoires. Des médias comme La Voix du Nord ont même fait de leur raison d’être un levier de transformation locale : en 2018, le journal a adopté la mission « Ensemble, écrire la nouvelle histoire du Nord », traduite par une charte éditoriale sur le journalisme de solutions, une plateforme participative et des événements annuels consacrés à l’innovation et aux produits locaux. D’autres expérimentations, comme les radios communautaires ou les newsletters locales indépendantes, réinventent la relation directe entre producteurs et consommateurs d’information.
À l’heure où l’IA génère de plus en plus de contenus standardisés et décontextualisés, ces filières locales de l’information apparaissent comme une réponse démocratique. Elles offrent une traçabilité (qui écrit quoi, d’où vient l’information), une relation directe voire une possibilité de dialogue entre journaliste et lecteur, et surtout un rôle de lien social et de fabrique de récits communs au sein des territoires. En cela, le parallèle avec les circuits courts alimentaires prend tout son sens : il s’agit d’un choix de qualité, de proximité et de transparence.
L’ARRIVEE DES FILIERES DANS L’ENERGIE – REMONTER LE COURANT DERRIERE LA PRISE…
Le secteur de l’énergie illustre de façon spectaculaire l’intérêt des filières en circuits courts. Longtemps, l’énergie a été perçue en France comme un sujet centralisé et régalien, dominé par le nucléaire, les grands réseaux nationaux et les approvisionnements mondiaux. Mais les crises récentes – flambée des prix en 2022, tensions d’approvisionnement, incertitudes liées aux pics de consommation – ont mis en lumière la fragilité de ce modèle et suscité une aspiration croissante à la réappropriation locale.

L’autoconsommation en est le symbole : selon une étude EDF ENR , plus de 70 % des ménages français estiment que produire et consommer leur propre énergie est la meilleure façon de maîtriser leur budget, et le nombre d’installations photovoltaïques en autoconsommation a doublé en quelques mois. Enedis confirme cette tendance, tandis que des coopératives citoyennes d’énergie se développent partout en France, associant directement habitants et collectivités à la gouvernance et au financement des projets renouvelables. Ces modèles favorisent l’acceptabilité sociale, la transparence et l’ancrage territorial.
Des exemples concrets montrent la viabilité économique du modèle. En particulier le pionnier Enercoop illustre depuis vingt ans une autre manière de produire et de distribuer l’électricité : une filière 100 % coopérative et renouvelable, qui relie directement producteurs, consommateurs et collectivités. Créée en 2005 à l’initiative de Greenpeace, du CLER et de Coopérative Biocoop, la coopérative Enercoop regroupe aujourd’hui plus de 100 000 sociétaires et plus de 400 producteurs d’électricité verte, essentiellement issus du solaire, de l’éolien et de l’hydroélectricité. produits en France. Chaque euro dépensé alimente une économie locale : Enercoop signe des contrats à long terme avec ses producteurs, garantit la traçabilité de l’électricité jusqu’à son origine, et réinvestit les bénéfices dans de nouveaux projets citoyens. Au-delà du modèle économique, Enercoop propose une filière énergétique territorialisée, où la gouvernance est partagée, la valeur mieux répartie et la transparence réelle – à rebours des marchés anonymes de l’électricité. Ce modèle de coopération ancre l’énergie dans les territoires et réintroduit une dimension de proximité démocratique dans un secteur longtemps centralisé.

Plus récent et plus local encore, le fournisseur Energie d’ici, créé en 2016 dans le Sud-Ouest, regroupe des producteurs locaux d’électricité 100% renouvelable et vend directement leur production aux consommateurs. En 2022, l’entreprise a réalisé 62 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 23 % malgré un contexte énergétique tendu. Du côté BtoB, en Autriche, AustroCel Hallein GmbH, un producteur de pâte à papier, est devenu pendant le Covid l’un des plus grands producteurs d’électricité verte du pays en valorisant les résidus de bois locaux et en développant une bioraffinerie qui fournit 100.000 MWh d’électricité verte et 110.000 MWh de chauffage urbain chaque année.
Ces exemples confirment que l’énergie peut, elle aussi, être structurée en filières courtes : produire localement, consommer à proximité, limiter les pertes, renforcer la résilience. Les territoires à énergie positive (TEPOS), qui produisent autant ou plus d’énergie qu’ils n’en consomment, montrent la voie. L’enjeu est désormais d’accélérer ce mouvement : en 2020, la France était en retard sur son objectif européen de 23 % d’énergies renouvelables, n’atteignant que 19,1 %. Et ce retard nous a coûté entre 6 et 9 milliards d’euros d’importations de gaz supplémentaires en un hiver, selon l’Iddri. Massifier les projets territoriaux d’énergie renouvelable est donc non seulement une réponse écologique, mais aussi une stratégie économique et géopolitique.
LES FILIERES COURTES DANS LA BANQUE : SAVEZ-VOUS VRAIMENT CE QUE FINANCE VOTRE ARGENT ?
Dernier secteur à explorer : la #finance. La crise des subprimes en 2008 a révélé la dangerosité d’une finance déconnectée de l’économie réelle, alimentant des bulles spéculatives sans lien avec les besoins des territoires. Le parallèle avec l’alimentaire est frappant : un produit toxique dans l’assiette ou dans un portefeuille financier détruit la confiance et met en péril le système.

À l’inverse, des banques alternatives comme Banque Triodos aux Pays-Bas ou La Nef, pour la banque éthique en France ont démontré qu’une approche fondée sur la transparence et le financement local est possible et durable. Triodos ne finance que des projets à impact positif – énergies renouvelables, bâtiments passifs, PME sociales – et publie la liste complète de ses prêts par région. La Nef, pour la banque éthique offre la même transparence à ses sociétaires en France, et Crédit Coopératif aussi pour les titulaires de son compte Agir. Ces banques revendiquent d’avoir mieux résisté aux crises car elles restent connectées aux besoins réels de la société.
Cette logique inspire aussi les grandes banques coopératives. Le Groupe Crédit Agricole , le Crédit Mutuel ou la Fédération nationale des Caisses d’Epargne (FNCE) valorisent dans leurs communications leur ancrage local, en expliquant que « votre banque est ici » et que « les projets qu’elle finance sont là, là ou là », visibles sur une seule et même carte du territoire. Ces messages traduisent une demande croissante de traçabilité financière, similaire à celle qui s’exprime dans l’alimentaire.
Certaines expériences vont encore plus loin en structurant de véritables filières locales. Le Crédit Agricole du Finistère, par exemple, a créé dès 2014 une offre dédiée à la filière mer du département : nautisme, énergies marines, pêche, algues, infrastructures portuaires. Au total, l’économie bleue représentait, en 2019, près de 15 % du PIB et 820 000 emplois dans le Finistère, contre seulement 4 % du PIB pour le secteur automobile, qui disposait pourtant de produits et de services dédiés au sein de la banque : en soutenant ces secteurs à forte identité territoriale, la Caisse locale du Crédit Agricole contribue directement au développement local, au-delà de son marché agricole historique, et a doublé sa part de marché dans le secteur de l’économie bleue, ainsi que le volume financier correspondant, dans les 4 premières années de l’initiative.

Enfin, les monnaies locales comme le Sol Violette à Toulouse ou l’Eusko au Pays basque témoignent d’une volonté citoyenne de reprendre en main la circulation monétaire. Elles favorisent les échanges entre acteurs locaux, soutiennent les filières ou les commerçants de proximité, et renforcent la résilience des territoires.
Ainsi, appliquer le modèle des circuits courts à la banque, c’est rétablir la traçabilité, redonner du sens à l’épargne et reconnecter les flux financiers aux besoins réels de la société. Dans un monde où l’argent circule massivement dans des transactions spéculatives parfois soixante fois supérieures à la valeur de l’économie réelle, ce récit offre une alternative : replacer la finance dans le champ du concret, du local et de l’utile.
CONCLUSION : LES FILIERES, UN MODELE MIEUX-DISANT ET INSPIRANT POUR LA TRANSITION
Dans un monde fragmenté où les chaînes de valeur se sont allongées jusqu’à devenir invisibles, les filières apparaissent a contrario comme des architectures de lien. Elles reconnectent les acteurs entre eux, rendent visible ce qui est opaque ailleurs et réinventent les échanges économiques à force de sens et de conscience. Elles démontrent, dans tous les secteurs précités, qu’il existe déjà une autre manière de produire, d’échanger et de coopérer.
Ce qui distingue les filières, c’est d’abord l’attention : l’attention portée à la ressource, à la matière, au vivant, mais aussi aux personnes, à la façon dont la valeur se crée et se répartit, et à l’histoire des produits. Là où la logique industrielle accumule les angles morts qui sont souvent les maillons faibles, la logique de filière exige au contraire de les connaître, de les explorer, de les renforcer. Elle est une économie de la vigilance, fondée sur la reconnaissance mutuelle.
De cette attention découle une seconde composante fondamentale des filières : la coopération, qui rompt avec la culture de la compétition abrupte. Une filière ne fonctionne que si ses acteurs se parlent, partagent des objectifs, innovent ensemble. Cette coopération n’est pas naïve : elle s’organise, se structure, se professionnalise… et remplace la guerre des marges par une alliance d’intérêts.
On l’a dit, cette alliance ne saurait tenir sans une répartition équitable de la valeur. Les filières durables rétablissent une justice économique souvent perdue dans les chaînes mondialisées : elles permettent à chacun, qu’il soit producteur, transformateur ou distributeur, de vivre dignement de son travail, de contribuer à la résilience collective et de renforcer le tissu économique local. En cela, les filières sont à la fois un instrument d’équilibre et un ferment de solidarité.
Enfin, la proximité redonne du sens à l’action. Être proche, ce n’est pas seulement être voisin : c’est voir les conséquences de ses choix, entendre les besoins de ses partenaires, adapater ses pratiques à ce qui est juste. Cette approche de proximité peut aussi fonctionner à distance dès lors qu’il y a dialogue, transparence et respect mutuel : comme le dit Latour, la vraie proximité est celle des relations, non des kilomètres – et c’est aussi ce que retissent les filières.
Autrement dit, les filières sont mieux-disantes à tous égards : écologiquement, parce qu’elles réduisent les impacts et valorisent les ressources ; socialement, parce qu’elles recréent du lien et de la dignité ; économiquement, parce qu’elles sécurisent les approvisionnements et répartissent équitablement la valeur ; culturellement, enfin, parce qu’elles réapprennent aux acteurs économiques à faire ensemble. Elles ouvrent le champ des possibles vers une autre économie, fondée sur la relation plutôt que sur la transaction, sur la qualité du lien et la confiance au long cours plutôt que la vitesse et le volume.
Et pourquoi ne pas imaginer, demain, un nouveau métier pour accompagner cette mutation et la généralisation des filières dans tous secteurs ? Un métier transversal, capable de concevoir une filière (en identifiant les ressources, les acteurs, les flux, les verrous et les leviers), d’orchestrer les relations (par des coopérations, des accords, et de la gouvernance partagée), d’animer la dynamique collective dans la durée (via des projets, chartes, indicateurs et récits communs) et enfin de raconter la filière pour la rendre visible et désirable. Un rôle à la fois stratégique et poétique, qui demande une culture du développement territorial, une compréhension fine des écosystèmes économiques et des logiques de coopération, mais aussi une sensibilité narrative : savoir donner une identité, une “âme” à une filière.
Rêvons un peu : un tel designer de filières – qui serait aussi, plus symboliquement, le gardien des liens – pourrait bien devenir l’une des chevilles ouvrières de la transition. Celle ou celui qui tisse, patiemment, les relations entre économie, société et nature, et rend à l’économie son visage humain.
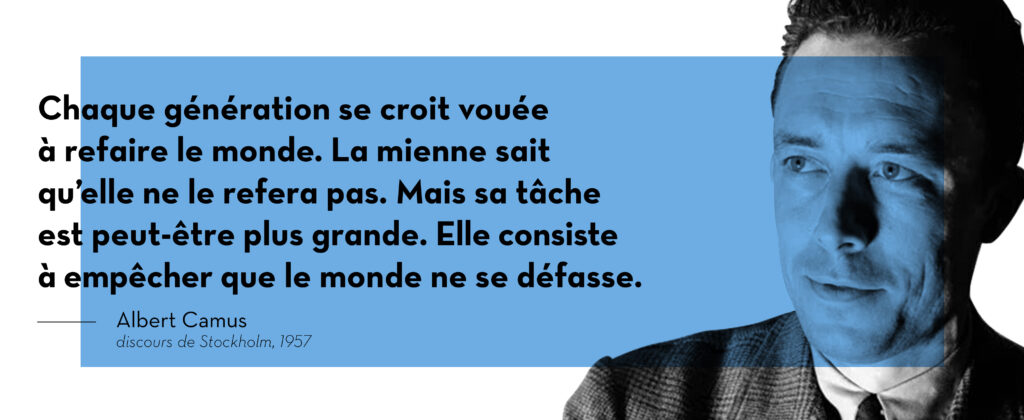
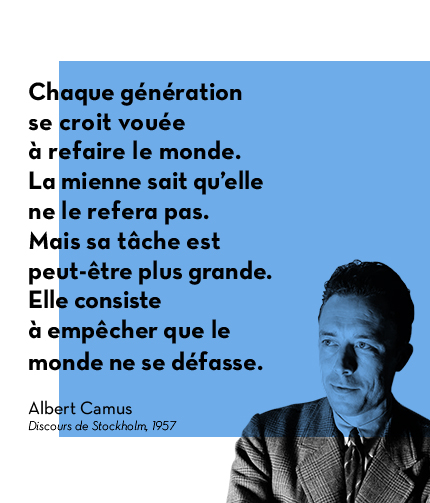
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire