
Un dîner récent entre experts passionnés du vin, et un autre aux côtés d’officiers militaires – et les deux fois, cette sensation curieuse de faire une incursion hors de ma « bulle ». Moi qui évolue depuis trois décennies dans l’écosystème de l’impact et du développement durable (un monde où chacun est convaincu que les enjeux écologiques et sociaux sont les plus cruciaux pour l’avenir), je me retrouvais plongée dans deux univers où d’autres préoccupations occupent toute la place.
Pour les uns, le vin est une affaire sérieuse, passionnée, quasi-spirituelle – “la preuve que Dieu nous aime”, disait Benjamin Franklin. Pour les autres, la sécurité nationale doit primer sur tout – au point de voir dans la transition écologique et l’investissement responsable des freins déraisonnables à la souveraineté ou à la défense. Et moi, à l’une et l’autre table, je mesurais combien j’étais loin de mes repères, de mes évidences, de mes idées. Une sensation aussi inconfortable… que stimulante.
Ces écarts m’ont fait réfléchir. Et si, en cette rentrée, on prenait le risque de sortir un peu de nos bulles ? Non pas pour les renier, mais pour cultiver « l’esprit d’ouverture » (comme le dit si judicieusement France Culture) et l’art de fréquenter ceux qui ne pensent pas comme nous et se passionnent pour des sujets qui nous laissent de marbre.

Ce n’est pas forcément facile car dans un monde où l’information n’a jamais été aussi abondante mais où nos cercles de pensée se referment, la tentation du confort intellectuel est forte : lire toujours les mêmes journaux, suivre toujours les mêmes comptes, fréquenter toujours les mêmes milieux – bref se nourrir de gens qui pensent, comme nous, que nos sujets de prédilection sont les plus importants au monde. Mais cette homogénéité est un piège, évidemment. Une étude réalisée en 2024 par le CEVIPOF – Sciences Po est édifiante à cet égard : 73 % des Français estiment que « les gens ne partagent plus les mêmes valeurs », 62 % qu’ »il n’y a plus de projet collectif » et 81 % qu’ »il y a trop de divisions » dans la société. Ce constat chiffré illustre un sentiment largement partagé : celui d’une société éclatée en univers ou « bulles » parallèles, entre lesquels le dialogue devient difficile.

Le phénomène dont je voudrais parler ici n’est pas seulement celui de la fragmentation. C’est celui, plus insidieux, de la polarisation : une logique de camps et de “nous contre eux” – les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes, les “vrais gens” contre les élites… Ces bulles structurant nos existences qui se rigidifient, se ferment et finissent par s’opposer. On les observe bien sûr dans la vie politique, où les camps se multiplient — parfois jusqu’à se fractionner eux-mêmes, comme c’est le cas au sein de la “bulle de l’impact”d’ailleurs ou en politique, quand un désaccord sur 10 % des idées suffit à tout bloquer alors qu’on partage 90% des valeurs. Mais on les retrouve aussi dans le quotidien : dans nos écoles, dans nos immeubles et jusque dans nos entreprises – qui sont, elles aussi, traversées par ces logiques, entre générations, entre femmes et hommes, entre niveaux hiérarchiques, nationalités, visions des transformations en cours (de l’écologie à l’IA) ou que sais-je encore…
On a vite fait, naturellement, de montrer du doigt les réseaux sociaux comme responsables de la polarisation croissante de nos sociétés. Le philosophe américain Eli Pariser a d’ailleurs décrit dès 2011, dans The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, la manière dont les algorithmes façonnent des environnements informationnels sur mesure, qui renforcent nos certitudes plus qu’ils ne les bousculent. Pourtant, il y a plus grave encore, comme l’expliquait déjà Charlotte Hervot dans Chut! Magazine (consacré à l’observation de la transformation numérique de la société et de nos vies) en 2021, car les algorithmes des plateformes ne sont pas les seuls responsables de l’effet d’enfermement que l’on ressent parfois en ligne : nos usages eux-mêmes accentuent ce phénomène. Autrement dit, nous dessinons nous-mêmes les contours de nos bulles en privilégiant des interactions homogènes — un mécanisme que les sociologues appellent « homophilie », à savoir notre tendance à se rapprocher de nos semblables. Vincent Cocquebert, dans La Civilisation du cocon (Arkhê, 2021), rappelle combien cette aspiration au repli est aujourd’hui dominante. Parfois, d’ailleurs, l’entreprise elle-même devient une bulle : un lieu de repli et d’entre-soi affichant des valeurs d’ouverture, tout en restant socialement homogène et culturellement refermé.

Mais dans une société confrontée à des défis aussi immenses que la transition écologique et sociale, casser ces bulles et repenser nos usages devient une condition de survie collective. Car aucun des défis communs qui nous attendent – qu’ils soient climatiques, économiques ou sociaux – ne pourra être relevé sans que nous le fassions ensemble, dans une logique de coopération renforcée avec des personnes aux visions et aux idées différentes des nôtres.
1. LA FRANCE ARCHIPELISEE : DIAGNOSTIC D’UNE FRAGMENTATION SILENCIEUSE
La question semble provocatrice mais elle mérite d’être posée : sommes-nous encore capables de parler avec des personnes qui ne pensent pas comme nous ? A la veille d’une période qui risque de cliver encore davantage les Français (avec les élections municipales en 2026 puis les présidentielles en 2027), il est urgent de penser aux façons d’amener la dépolarisation et la cohésion sociale dans le débat public, mais aussi dans les entreprises ou dans les récits collectifs qui façonnent nos comportements.
Sans cela, confrontée à l’affaiblissement du débat public, la société française risque de se fragmenter plus encore – alors que les données récentes dressent déjà un tableau préoccupant. Selon l’enquête du même CEVIPOF – Sciences Po précité (édition 2025), seuls 30 % des Français déclarent désormais faire confiance à leurs concitoyens, tandis que 62% pensent que « la France est plutôt un ensemble de communautés qui cohabitent les unes avec les autres » et que 28 % seulement estiment que « la démocratie fonctionne bien en France » (score le plus bas de l’étude, derrière l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie), en grande partie en raison d’un sentiment croissant d’entre-soi social et de rupture territoriale (voir le récent numéro de ma newsletter sur la ruralité). L’étude souligne que cette défiance est fortement corrélée avec le sentiment de ne pas vivre dans une société tenant sa promesse d’égalité. En matière scolaire, l’indicateur de position sociale (IPS) met en évidence une ségrégation croissante : 61 % des collèges parmi les 10 % les plus favorisés sont privés, et jusqu’à 90 % parmi les 10 meilleurs établissements sociaux. Dans l’habitat aussi, les grandes métropoles voient s’accentuer les disparités spatiales selon le revenu : tous les groupes sociaux vivent désormais dans des quartiers de moins en moins mixtes, à l’exception des plus modestes.

Ce sujet est au cœur de l’analyse menée dès 2019 par Jérôme Fourquet dans L’archipel français (Seuil) : l’essayiste y décrit « l’avènement d’une nation multiple et divisée » où les groupes sociaux, loin d’avoir disparu, se sont autonomisés et vivent dans des entre-soi à rebours de l’unification fantasmée. Il y voit les effets conjoints d’un individualisme de masse, de la déstructuration des référentiels collectifs (notamment religieux), et de la fragmentation territoriale et culturelle. À ses yeux, « la société française est devenue de facto une société multiculturelle », et « ne connaîtra plus jamais la situation d’homogénéité ethnoculturelle qui a prévalu jusqu’à la fin des années 1970 ».
Pour Fourquet, cette fragmentation est accentuée par la fin de ce qu’il nomme la « matrice catholique », qui structurait encore largement la société française jusqu’au milieu du XXe siècle. La dislocation des repères communs – culturels, religieux, sociaux – a ouvert la voie à un éclatement des appartenances, des modes de vie et des imaginaires. L’électorat, devenu « éminemment volatil », exprime cette crise de représentation profonde, alimentée par un sentiment d’abandon et de non-écoute.
Un mouvement de fond, même si le religieux semble revenir en force : mi-2025 selon L’ADN, plus de 10 000 adultes avaient reçu le baptême en France soit 45 % de plus qu’en 2024, qui marquait déjà une hausse de 31 % par rapport à l’année précédente. Du lancement prochain du magazine chrétien Le Cri par le journaliste Théo Moy ou le très intéressant mouvement « Lutte et contemplation » créé par le polytechnicien Benoit Halgand en passant évidemment par le TikTok chrétien, le retour de la Silicon Valley sur les chemins de la foi, ou la stratégie tentaculaire des milliardaires français Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin pour propulser une culture chrétienne dans les médias de masse, cette tendance est multi-facettes et n’est évidemment pas toujours porteuse de dépolarisation, loin s’en faut, mais le besoin auquel elle répond est en soi intéressant.
Ces éléments confirment donc une réalité sensible : nous évoluons de plus en plus dans des bulles. Des bulles géographiques, sociales, scolaires, culturelles, médiatiques. Des bulles qui nous séparent, et qui nourrissent l’incompréhension, la méfiance (cité en tête de ce qui décrit le mieux l’état d’esprit actuel dans l’étude CEVIPOF – Sciences Po par 45% des répondants), et parfois l’hostilité. Les briser n’est pas une coquetterie civique, c’est une nécessité démocratique (voir aussi le numéro de ma newsletter consacré aux algorithmes), écologique et culturelle.
2. LES BULLES DE FILTRES : ENTRE CHOIX PERSONNELS ET ENFERMEMENT ALGORITHMIQUE
On l’a dit, nos usages numériques contribuent activement à ce phénomène. Nous suivons sur Instagram ou LinkedIn (et parfois encore sur X ) des personnes qui nous ressemblent, partageons des contenus qui confirment nos croyances, et finissons par nous persuader que « tout le monde pense comme nous ». Léa, une Rennaise de 24 ans, expliquait ainsi il y a quelques années dans un article de Chut! Magazine qu’en suivant surtout des comptes féministes, elle avait l’impression que « la révolution féministe est pour demain », avant de réaliser brutalement, au contact de personnes extérieures à son cercle, combien cette perception était faussée.

Les algorithmes viennent amplifier ce phénomène. Netflix , par exemple, personnalise jusqu’aux vignettes d’illustration des films et séries proposées, en fonction de nos goûts supposés. Un amateur de romance verra ainsi une affiche centrée sur une histoire d’amour, tandis qu’un passionné de comédie se verra proposer une image drôle de la même œuvre. Cette illusion de choix est en réalité une prison douce : nous pensons explorer, alors que nous sommes guidés dans un couloir invisible. Comme le souligne le philosophe Bernard Stiegler, ces algorithmes construisent un « double numérique » de nous-mêmes qui n’est qu’une projection statistique, au détriment de notre singularité.
La critique ne porte pas seulement sur la privation de surprise. Elle touche aussi la diversité culturelle et démocratique. Olivier Schrameck, ancien président du CSA, alertait dès 2017 sur « la menace d’une standardisation de la création » induite par ces mécanismes. En réduisant la diversité des propositions et en favorisant les contenus les plus rentables ou engageants, les plateformes contribuent en effet à appauvrir notre horizon collectif.
3. APPRENDRE A COOPERER : L’ETHIQUE RELATIONNELLE, ANTIDOTE A LA POLARISATION AFFECTIVE
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas tant la polarisation des idées (dite « idéologique » par les experts) qui explose aujourd’hui, mais celle des identités et des émotions (dite « affective »). Certes la polarisation idéologique – centrée sur des désaccords rationnels (qu’elle porte sur la réforme des retraites ou l’interdiction des voitures en centre-ville) – mène au désaccord voire au conflit : certes, elle peut être intense, passionnée, bruyante… mais elle fait partie du débat démocratique et tend à se réduire, dans les grandes démocraties occidentales, depuis les années 1980 et la fin du communisme. Et elle peut être négociée : on peut poser des règles, trouver un compromis, apaiser les tensions.
A l’inverse, la polarisation affective, qui repose non pas tant sur les idées que sur les identités, augmente en flèche dans les démocraties occidentales – la discussion y est nettement plus compliquée, parce que ce qui est en jeu, ce n’est plus le sujet-même de la discussion… mais tout simplement qui tu es. Résultat : elle aboutit le plus souvent au rejet de l’autre en tant que tel, et à une hostilité vis-à-vis de ceux que l’on perçoit comme étant dans le « camp » adverse. Comme l’explique Bart Brandsma, philosophe néerlandais spécialiste des dynamiques de polarisation : « le conflit est centré sur un contenu, là où la polarisation est centrée sur une relation. » Autrement dit : je suis contre toi, avant même d’être contre ton idée.
Face à cette situation, le sociologue et philosophe américain Richard Sennett, dans Ensemble : pour une éthique de la coopération (Albin Michel, 2014), déplore la perte des compétences de coopération dans nos sociétés. A le lire, le travail à court terme, l’individualisme, l’hypercompétition ont abîmé l’empathie et la capacité d’engagement.
Il identifie la multiplication des « tribalismes » (le syndrome « nous contre eux » de la polarisation affective) comme des formes dégradées de la coopération, tout comme les effets silos dans les entreprises ou les replis individuels. Pour Sennett, la vraie coopération ne consiste pas à penser ou ressentir la même chose, ni à gommer les désaccords pour parvenir à un consensus de façade. Elle repose au contraire sur l’acceptation des divergences : “nous ne nous comprenons pas, mais nous voulons faire quelque chose ensemble.” Autrement dit, la coopération ne cherche pas à effacer les différences, mais à les articuler autour d’un projet commun. Ce qu’il appelle une “coopération exigeante” suppose aussi une capacité à maintenir des conflits détendus, à écouter sans chercher à convaincre, à reconnaître l’altérité de l’autre et à goûter aux plaisirs sérieux de la conversation.

Pour Sennett, la coopération est un travail artisanal (cooperation as craft), fragile, basé sur le faire. Elle se travaille, elle se bricole, elle se tisse. Dans les ateliers d’artisans qu’il prend comme métaphore, les désaccords sur les gestes ou les matériaux ne disparaissent pas, mais deviennent une ressource pour inventer de nouvelles solutions. Et dans la musique de chambre qu’il pratique lui-même, chaque musicien garde son interprétation, son timbre, son intention, et pourtant l’ensemble fonctionne parce que chacun.e accepte de se plier à la dynamique collective sans effacer sa singularité.
Dans un monde où la différence est trop souvent vécue comme une menace, cette approche artisanale et concrète du lien devient un acte de résistance. Elle nous rappelle que la coopération n’est pas une harmonie parfaite, mais une pratique patiente et fragile, faite d’écoute, d’essais, d’ajustements – pour faire ensemble, malgré les différences.
4. DIALOGUER AUTREMENT : DES EXPERIENCES ET INITIATIVES POUR CASSER LES BULLES

Le lien comme acte de résistance, c’est aussi ce qui motive Clara Delétraz , entrepreneuse sociale, ex-collaboratrice de Fleur Pellerin, co-fondatrice de La French Tech et plus récemment fondatrice de ENSEMBLE(S), une newsletter qui devient aussi une méthode de dialogue transformant, et une série d’expériences immersives. Clara m’a consacré un bon moment de discussion pour préparer cette newsletter sur ce sujet qui la passionne et je l’en remercie. Son objectif : inverser le constat dressé par Destin Commun en 2024, selon lequel 77% des Français pensent que la société est divisée et plus de la moitié déclarent que les différences entre eux sont trop importantes pour continuer à avancer ensemble. Avec Faut qu’on parle – projet mené sur la première édition avec Brut., La Croix et le Fonds Bayard Agir pour une société du lien – Clara a permis en 2024 à plus de six mille citoyens de se rencontrer pendant deux heures malgré des opinions opposées. Le résultat est sans appel : 95 % des participants se disent satisfaits, 75 % souhaitent rester en contact avec leur binôme, et la polarisation affective – c’est-à-dire les sentiments négatifs vis-à-vis de ceux qui pensent autrement – diminue de 77 % après seulement deux heures d’échange. Et l’opération vient d’être relancée cette année par La Croix pour des échanges encore plus riches et nombreux le 22 novembre prochains … Bien décidée à ne pas s’arrêter là, Clara déploie aussi dans les organisations et les grands événements une conférence « Parler ENSEMBLE(S) », qui est aussi une expérience collective singulière de dialogue et de confrontation positive – pour connecter différentes bulles et apprendre à se confronter sans s’affronter sur les sujets sensibles qui comptent, grâce à un algorithme de « matching » entre participants aux angles de vue différents et à une solide méthode de dialogue testée dans de nombreux contextes. Elle porte aussi un projet d’émission TV, « ENSEMBLE(S), mission impossible ? » autour d’un concept : dans une France fracturée, une brigade composée d’une personnalité publique fédératrice et de quatre experts de la réconciliation sillonne la France en van pour intervenir sur des situations de crise entre des groupes polarisés qui n’arrivent plus à se parler.

Clara travaille aussi beaucoup en ce moment sur la façon de mettre davantage de dépolarisation et de cohésion sociale dans les récits collectifs, via du travail avec des scénaristes et producteurs qui manifestent, dit-elle, « une grande appétence » pour produire des « fictions dépolarisantes », c’est-à-dire des contenus qui n’alimentent pas les récits identitaires, ne rentrent pas dans le jeu des caricatures clivantes et évitent de jouer sur des leviers émotionnels activant le sentiment d’animosité contre de supposés « camps » adverses. L’enjeu, selon elle, n’est pas de chercher à réconcilier des camps minoritaires qui s’affrontent de manière très vocale aux extrêmes mais bien de s’adresser au « milieu ambivalent », à cette majorité de gens qui ont des dilemmes, savent que les choses sont plus complexes que l’approche très binaire « noir ou blanc ». Un bon exemple de tel contenu, souligne Clara, est fourni par le film #VingtDieux de Louise Courvoisier, qui sur le sujet de la #ruralité évite les clichés bucoliques (la campagne comme paradis perdu, l’exotisme urbain), n’oppose pas les urbains et les ruraux puisque l’histoire se joue entre ruraux (avec un casting 100% local et non-professionnel, réalisé sur des foires agricoles et pas dans des agences de casting parisiennes), fait une proposition plus nuancée que ce que l’on voit habituellement sur ce sujet (pas d’ « urban gaze » – ce regard citadin et bourgeois qui déforme, simplifie et caricature les représentations des territoires ruraux, tout en alimentant un sentiment de supériorité des villes sur les campagnes) et un succès qui rend optimiste.

Elle cite aussi la vidéo « faites un pas en avant » que vient de sortir Amnesty International France pour nous rappeler qu’au-delà de nos différences, nous pouvons faire ensemble le prochain pas vers un monde dépolarisé. Autre exemple : le très puissant documentaire « White Right: Meeting the Enemy » de la réalisatrice activiste Deeyah Khan qui s’est vu décerner l’Emmy Award du meilleur film d’actualité internationale.
En avril 2025, l’association Parlons Climat a de son côté organisé No Bulles, un événement conçu pour interroger nos manières de communiquer sur la transition écologique mais aussi explorer comment « sortir de la bulle écolo » et dépasser le cercle des convaincus. L’idée de départ était simple : les récits climatiques, malgré leur multiplication, semblent buter sur un plafond de verre. Ils touchent surtout des militants déjà acquis à la cause et peinent à engager celles et ceux qui n’en font pas partie. Alors comment sortir de ces bulles militantes pour parler à tout le monde ?

Trois grandes pistes se sont dégagées des échanges. La première consiste à commencer par écouter. Comme le rappelle la journaliste Nina Fasciaux, directrice des partenariats du Solutions Journalism Network, dans son livre « Mal Entendus » (Payot, 2025), notre société souffre d’un déficit d’écoute. Cela commence avec les médias qui, trop souvent, privilégient la rapidité, la polémique ou la viralité, au détriment d’une attention réelle aux voix diverses. Résultat : les publics se sentent incompris, mal représentés, et finissent par se détourner du débat commun. Ce pourquoi, notamment, l’écoute pourrait être un antidote au sentiment de rejet que suscite parfois le discours écologique, perçu comme une idéologie moralisatrice ou dominatrice. Fasciaux plaide plus largement pour un journalisme qui sache accueillir la complexité, donner place à la parole inattendue, et mesurer son impact non à l’audience, mais à sa capacité à créer du dialogue et à retisser des liens de confiance. Car écouter, c’est prendre au sérieux les aspirations, les contradictions et les valeurs de ceux auxquels on s’adresse, au-delà des segmentations simplistes par âge, classe ou territoire. C’est aussi reconnaître que chacun vit dans une vision particulière de la société – et que comprendre cette vision est la condition pour engager un dialogue fécond.
La deuxième piste est de proposer une projection désirable dans une société idéale. Les valeurs écologiques – respect de la nature, préservation du vivant, sobriété – sont souvent brandies comme des évidences, mais sans qu’on explicite le projet de société qui les accompagne. Or les enquêtes de L’ObSoCo (2022) montrent que 51 % des Français se déclarent favorables à une « utopie écologique » fondée sur l’équilibre et la sobriété. Ces aspirations rejoignent des désirs très quotidiens : passer plus de temps avec ses proches, faire davantage par soi-même, retrouver un rapport simple et direct à la nature. Autant de points d’appui pour imaginer une transition qui ne soit pas seulement une contrainte, mais la promesse d’un mode de vie plus enviable.
Enfin, la troisième piste est d’aller chercher l’inspiration hors des cercles habituels. No Bulles donne la parole à des organisations qui ne travaillent pas sur l’écologie mais qui, dans leurs propres domaines, ont trouvé des façons originales d’engager leurs publics. Ainsi l’Institut national du cancer (INCa) a montré comment miser sur le projet très désirable et consensuel de vivre en bonne santé dans la durée, au prix de quelques saines habitudes à prendre dès aujourd’hui, quitte à mettre de côté les traditionnelles campagnes informant sur les risques (de la consommation de tabac, par exemple), permet de changer des comportements sans tomber dans la peur. Tandis que les exemples de BlaBlaCar et LA VIE™ prouvent la force de communications conniventes et humoristiques, pariant sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare – à savoir la recherche de convivialité et de connexions plutôt qu’une solution de transport écolo, pour Blablacar… ou la défense joyeuse du bien-être animal pour LA VIE, aux antipodes des clivages entre végétariens et carnivores, mais aussi de la quête rationnelle d’un faux jambon au meilleur rapport qualité-prix. Ces exemples convergent vers une même idée : pour « sortir de la bulle écolo », il faut partir des aspirations profondes des publics et faire « avec eux » plutôt que de plaquer arbitrairement des injonctions climatiques. Santé, convivialité, autonomie, fierté et attachement sont autant de portes d’entrée pour relier transition écologique et désir de vivre autrement. En ce sens, No Bulles a ouvert une voie prometteuse : celle d’une communication écologique qui cesse de prêcher des convaincus, évite de braquer les sceptiques et redonne à chacun l’envie de se sentir acteur d’un futur commun.


5. QUEL ROLE POUR LES ENTREPRISES ET LES MARQUES ?
Les entreprises ne sont pas en reste sur ces sujets et les experts convergent pour dire que dans la période actuelle, elles ont un rôle clé tant sur leurs pratiques internes vis-à-vis de leurs équipes que sur leur « brainprint » et l’influence sur leurs clients et leurs communautés, puisque les marques sont aussi des médias puissants et des productrices régulières de contenus. Comme le souligne Théo Scubla dans son livre Le Grand Rapprochement (Cherche-Midi, 2022), l’entreprise est l’un des derniers lieux capables de créer du commun. Parce qu’elle réunit des personnes d’horizons divers autour d’un objectif économique partagé, elle agit comme un « générateur d’histoire commune », un espace où se rencontrent des individus, des idées et des mondes que tout semblait séparer, un lieu de vie où la joie ne vient pas seulement de la réussite individuelle, mais bien de l’engagement partagé dans l’action commune, dans la construction d’un récit collectif. Clara Deletraz le confirme : « les entreprises sont un terrain intéressant pour travailler à la dépolarisation, car elles sont les derniers lieux où l’on trouve des gens très différents réunis autour d’un objectif commun. Elles ont un levier stratégique à activer dans leur intérêt propre, car elles ont, partout, des bulles à casser entre les générations, les métiers et les équipes, et c’est un bon angle pour aborder le sujet – mais elles ont aussi une responsabilité sociétale à travailler ces questions en ce moment. Cela suppose de former leurs collaborateurs sur ces sujets, de porter une culture de la confrontation positive, d’en faire un muscle collectif au service du business et de la coopération avec leurs parties prenantes. »
Du côté des marques, affirme Clara, « la dépolarisation est le prochain sujet sur lequel les marques doivent s’engager ». Certaines ont déjà ouvert la voie avec des initiatives intéressantes, notamment lors de la première élection de Donald Trump en 2017. Quelques jours après l’élection, au Danemark, la chaîne nationale TV 2 Danmark a ainsi lancé le très beau film de sa campagne « All that we share », qui montre qu’au-delà de nos différences apparentes et des « cases » dans lesquelles on peut nous ranger un peu vite (selon notre origine, notre niveau de vie, notre lieu de naissance…), ce sont les expériences vécues et partagées qui nous rapprochent : comme on le voit dans le film, la solitude, un cœur brisé, l’expérience de la parentalité… créent entre nous des affinités inattendues, bien au-delà des « cases ».

Aux Etats-Unis, la marque de barres de céréales KIND a elle aussi lancé en 2017 sa campagne « Pop Your Bubble » : concrètement, KIND a conçu une application mobile connectée à Facebook, qui analysait le profil des utilisateurs pour leur proposer de suivre des personnes aux opinions radicalement différentes des leurs, en un simple clic. L’initiative faisait directement référence à la polarisation croissante révélée ou aggravée par la campagne de Donald Trump : une campagne vidéo virale a permis d’exposer la polarisation algorithmique, montrant combien les plateformes comme Facebook enferment les gens dans des bulles d’opinions similaires aux leurs, tandis que des publications géolocalisées et adaptées aux États « rouges » comme aux États « bleus » encourageaient la participation à travers tout le pays. En quelques semaines, plus de 50 000 nouvelles relations ont été créées sur Facebook, et plus de 70% des utilisateurs ont « fait éclater leur bulle » en ajoutant dix personnes ou plus à leur fil d’actualité. L’initiative, qui a aussi généré plus de 140 millions d’impressions médias, incarnait la promesse de la marque selon laquelle « la gentillesse commence par l’écoute » -faisant de la marque un acteur de la réconciliation civique.

La même année, The HEINEKEN Company a proposé sa campagne « Worlds Apart », imaginée par l’agence Publicis London. Le dispositif reposait sur une expérience sociale filmée assez proche du fonctionnement de Faut Qu’on Parle : deux inconnus aux opinions opposées (sur le féminisme, le climat, les droits LGBT, etc.) devaient coopérer pour construire un meuble, avant de découvrir, autour d’une bière, leurs divergences profondes. Le film, visionné plus de 17 millions de fois en quelques jours, illustre le potentiel de l’écoute et du dialogue. Mais des critiques ont pointé un risque de simplification excessive : « tout ne peut pas se résoudre autour d’une bière » affirmaient-ils ainsi dans différents articles, arguant du fait que certaines fractures sociales ou politiques nécessitent des réponses structurelles, bien au-delà d’un moment de convivialité.

Un quatrième bel exemple de marque pensée dès le départ comme un « ferment de dépolarisation » est celui des Danone du Monde, lancé en 2018 par ma camarade Anne Thevenet-Abitbol, directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone. L’idée ? Utiliser un produit universel – le yaourt – pour célébrer les cultures alimentaires du monde entier, cultiver l’esprit d’ouverture et rapprocher les peuples par le goût. A l’origine de cette gamme, en effet, le constat que « le monde semblait se rétrécir, un manque de bienveillance émergeait » alors même que « l’alimentaire peut participer à l’ouverture aux autres, à la diversité », rappelle sa fondatrice. Chaque référence s’inspirait d’une tradition étrangère (lassi indien, ayran turc, skyr islandais, etc.), adaptée pour plaire à un large public tout en suscitant curiosité, respect et dialogue interculturel. C’est d’ailleurs dans cette gamme pionnière qu’est née l’intuition du skyr, devenu aujourd’hui un best-seller en France. Plus qu’un simple produit, Les Danone du Monde portait un récit fort : rassembler dans la diversité, par la gourmandise et la découverte – bien avant que l’on parle de diplomatie culinaire ou d’alimentation inclusive.

Au-delà de ces campagnes emblématiques, les entreprises et les marques disposent de nombreux leviers pour contribuer en continu à briser les bulles en interne et en externe, en lien avec ce qui précède sur la dépolarisation des récits collectifs. D’abord, elles peuvent intégrer davantage de diversité éditoriale et culturelle dans leurs communications en veillant à mettre en avant des récits minoritaires ou inattendus. Elles peuvent aussi développer des partenariats croisés avec des associations, des artistes ou des acteurs éloignés de leur univers, de manière à bâtir des ponts qui relient des univers sociaux ou culturels distincts. Elles peuvent encore organiser pour leurs collaborateurs ou clients des formations voire des parcours immersifs qui bousculent les habitudes : séjours dans un autre territoire, ateliers avec des publics très éloignés de leur quotidien, ou encore mises en situation où chacun découvre un rôle qu’il n’a pas l’habitude d’endosser. Ces expériences permettent de « traverser le miroir » et de changer de perspective.
Un autre levier d’action consiste à développer des services numériques avec des fonctionnalités qui incitent à sortir des bulles : filtres inversés (« montrez-moi un contenu différent de ce que je consulte habituellement », comme l’a fait KIND), indicateurs de diversité, ou recommandations croisées qui évitent la seule logique de similarité. Enfin, les entreprises qui déploient des solutions d’intelligence artificielle peuvent proactivement vérifier que leurs outils ne reproduisent pas les biais sociaux ou culturels : cela suppose de diversifier les jeux de données, d’évaluer systématiquement les biais générés et de concevoir des IA qui élargissent les horizons au lieu de renforcer les stéréotypes.
CONCLUSION : UNE TROISIEME VOIE ENTRE LE CONSENSUS MOU ET LE CONFLIT…
J’espère vous en avoir convaincu.e : la fragmentation de notre société n’est pas une fatalité, et nous avons tous un rôle à jouer (individuellement et collectivement) pour que cela change. Les bulles qui nous enferment – sociales, culturelles, numériques… – peuvent être percées, à condition d’en prendre conscience et de développer des stratégies volontaristes pour les dépasser.
Cela implique notamment de repenser nos usages numériques et de questionner les logiques algorithmiques, mais aussi d’inventer de nouvelles pratiques et de nouveaux récits qui relient plutôt qu’ils ne séparent. Les entreprises ont un rôle particulier à jouer à cet égard, car elles sont l’un des derniers lieux capables de créer du commun pour des gens d’horizons très variés, en interne et dans leurs communautés.
Tout cela, dans un contexte actuel géopolitique tellement tendu, selon Clara Deletraz, qu’il nous faut naviguer en continu « entre l’écueil du lisse et du consensus mou d’un côté, et l’écueil du conflit de l’autre » : l’enjeu est donc souvent de trouver, avec le bon cadre, une troisième voie – celle d’une confrontation positive dans tous les espaces possibles – de l’entreprise aux médias, des fictions à la vraie vie …
Et vous, quelle est la dernière fois où vous avez parlé, vraiment , avec quelqu’un qui ne pense pas comme vous ? Il existe mille manières, simples et concrètes, de commencer à sortir de nos bulles. Cela peut passer par le fait d’oser engager la conversation avec un inconnu, dans un train ou à la caisse d’un supermarché, plutôt que de rester plongé.e dans son téléphone. Oser tendre la main à quelqu’un d’un autre âge, d’un autre style de vie ou d’une autre opinion. Cela peut aussi consister à s’abonner à des sources d’information d’un autre bord politique ou culturel, à varier ses lectures, ou à sortir de sa chambre d’écho en consultant des plateformes comme L’Esprit Critique ou Brief.me qui proposent des visions contrastées d’un même sujet.
C’est aussi l’idée de rejoindre un débat citoyen ou un espace de dialogue structuré comme celui proposé par Faut qu’on parle, où des personnes aux opinions divergentes discutent dans un cadre bienveillant et respectueux – pour mémoire les inscriptions pour la prochaine édition du 22 novembre sont ouvertes. Parfois, il suffit d’inviter la différence à sa table, en proposant un café ou un dîner à quelqu’un qu’on côtoie sans le connaître vraiment (un collègue, un voisin, un commerçant…), pour faire un pas de côté. Enfin, il y a la possibilité de mettre de l’aléatoire dans ses propres algorithmes, en suivant volontairement sur les réseaux des comptes ou des newsletters qui bousculent nos repères ou en modifiant ses préférences pour laisser entrer d’autres façons de voir le monde dans son fil d’actualités.
Alors on se lance ?

PS : écrire cette newsletter, c’est aussi ma manière à moi de sortir de ma bulle. Merci de me lire, et parfois, de me répondre. J’avais promis un rythme toutes les 3 semaines… mais la rentrée est dense pour beaucoup d’entre nous (et les bugs de Linkedin n’arrangent rien). Merci pour votre fidélité. On reprend tranquillement, sans céder aux algorithmes, sans renoncer à la lucidité – ni à l’ouverture.
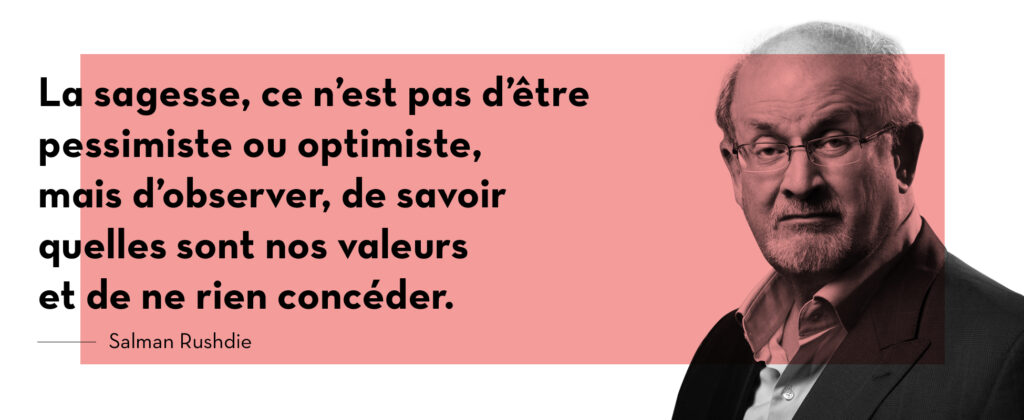
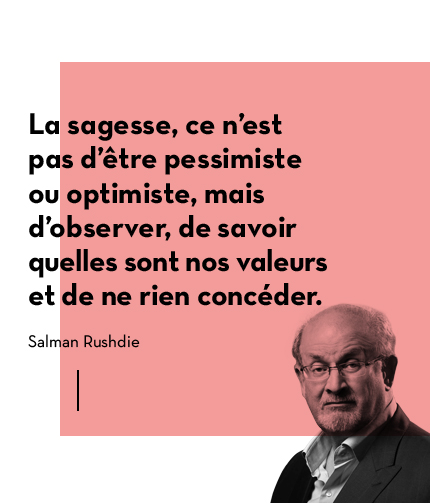
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire