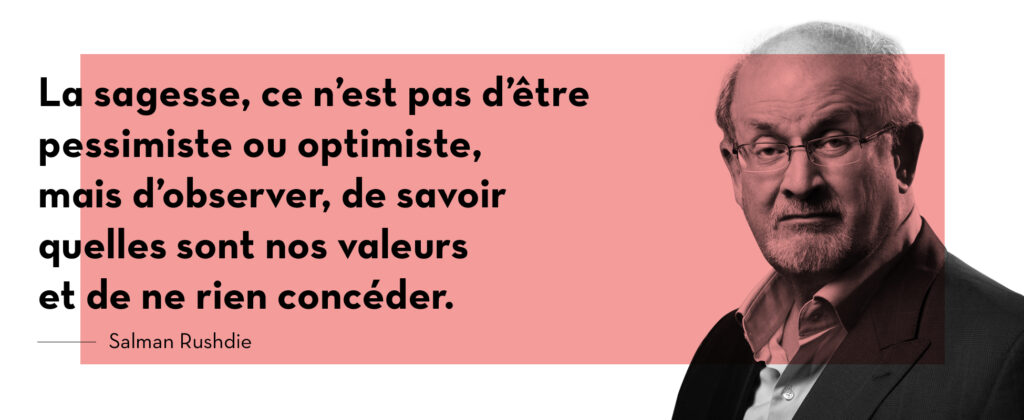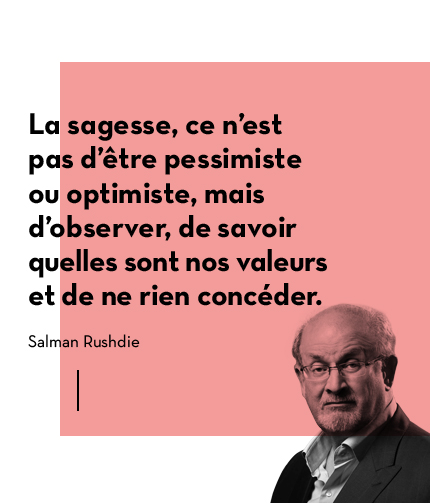Bioéconomie | Perspectives et enseignements
Comment l’AFD / Expertise France perçoit-elle actuellement la bioéconomie au Brésil et sur la scène internationale ?
L’Agence Française de Développement (AFD) et Expertise France considèrent que le moment de la bioéconomie au Brésil est particulièrement prometteur, stimulé par une dynamique sociale, politique et environnementale très favorable.
Le pays réunit des conditions uniques : 14 % de son territoire est constitué de terres indigènes – plus d’un million de km² –, auxquelles s’ajoutent les aires protégées, les réserves légales privées et les « territoires durables » gérés par l’agriculture familiale. L’ensemble représente l’une des plus grandes couvertures forestières du monde — encore soumise à de fortes pressions liées à l’expansion de l’agro-élevage, ce qui exige des politiques et instruments innovants pour contenir la déforestation et promouvoir une agriculture à faibles émissions de carbone.
Ces pôles de défis du développement durable de l’Amazonie — transition vers un élevage durable et promotion d’une économie fondée sur les ressources forestières — sont au cœur du Programme Amabio, qui vise à promouvoir un modèle de développement durable et inclusif pour le biome amazonien.
La plupart de ces zones (98 % des terres indigènes, soit presque deux fois la superficie de la France métropolitaine) se trouvent dans l’Amazonie légale, formant des « mosaïques » forestières essentielles à l’atténuation du changement climatique. Elles abritent plus de 300 ethnies et diverses populations traditionnelles dont les pratiques soutiennent l’économie de la sociobiodiversité. C’est pourquoi l’on parle de plus en plus au Brésil de « sociobioéconomie », notion qui intègre patrimoine naturel et patrimoine socioculturel.
Dans ce contexte, l’AFD et Expertise France voient un moment stratégique pour consolider la bioéconomie brésilienne, porté par la mobilisation de la société civile, l’écosystème d’innovation, les nouvelles orientations politiques et institutionnelles — notamment le Plan National de la Bioéconomie — et l’alignement avec des partenaires engagés dans les économies de la sociobiodiversité. Cet environnement renforce le rôle du Brésil comme référence mondiale de la transition verte, où conservation, innovation et inclusion sociale s’articulent aux agendas internationaux du climat, de la biodiversité et des finances durables.
Quels sont les principaux défis et opportunités pour faire de la bioéconomie un levier de développement durable et de création de valeur pour les territoires et les communautés ?
La mise en œuvre de la sociobioéconomie au Brésil se heurte à des défis structurels, mais elle offre aussi d’importantes opportunités de transformation.
Parmi les principaux obstacles figurent la fragilité de l’organisation communautaire, l’accès limité au financement et aux marchés, ainsi que la faible échelle de production et le manque de planification économique des organisations de producteurs. Ces facteurs compliquent l’accès aux subventions et aux investissements publics ou privés.
S’y ajoutent la complexité logistique liée au manque d’infrastructures dans les régions reculées du biome amazonien, la fragilité des chaînes de valeur, et la nécessité d’amplifier l’innovation technologique adaptée aux réalités locales.
D’autres défis persistent, notamment la coordination des politiques publiques pour les ancrer territorialement, ainsi que la formation technique et entrepreneuriale des acteurs communautaires de la bioéconomie.
Assurer l’inclusion sociale, le respect des droits territoriaux et des savoirs traditionnels est essentiel pour consolider un modèle équitable et durable. Sur le plan environnemental, la déforestation et l’exploitation illégale des ressources continuent de menacer la base naturelle de la sociobioéconomie.
En revanche, le contexte actuel — marqué par l’élaboration de la Stratégie nationale de bioéconomie, la vitalité de la société civile, l’intérêt croissant de partenaires publics et privés nationaux et internationaux — ouvre une fenêtre d’opportunité pour consolider les chaînes de valeur de la sociobiodiversité comme moteurs de développement durable fondés sur le concept de « forêt vivante ».
Quels enseignements ou recommandations feriez-vous à d’autres organisations souhaitant initier des projets de bioéconomie ?
L’expérience du Programme Amabio, encore en phase initiale, montre que les initiatives de bioéconomie nécessitent une intégration entre les dimensions territoriale, sociale, institutionnelle et financière.
Un apprentissage central est que la sociobioéconomie dépend de réseaux de coopération entre communautés, pouvoirs publics, recherche et marché, tout en valorisant les savoirs traditionnels et la diversité sociale et productive de chaque territoire.
Un autre point clé est la nécessité de mécanismes d’accompagnement technique et financier adaptés aux réalités locales, pour renforcer la durabilité des initiatives, en s’appuyant sur le riche réseau de soutien (ONG, associations, universités, institutions de développement), ainsi que sur les crédits subventionnés des banques publiques destinés à la bioéconomie et à l’agriculture familiale.
Enfin, il est crucial d’aligner les actions sur la Stratégie nationale de bioéconomie, de renforcer la gouvernance participative et les compétences en gestion, commercialisation et certification, afin d’élargir l’accès aux marchés durables — locaux, nationaux et internationaux (comme le démontrent les filières des noix, du guaraná, des huiles et autres produits).
En somme, il convient d’adopter une approche intégrée qui associe conservation, génération de revenus et gouvernance territoriale, afin de consolider des chaînes de valeur inclusives et un écosystème de bioéconomie au service du développement durable et de la valorisation de la sociobiodiversité.
COP et bioéconomie | Rôle international et coopération
Comment percevez-vous la relation entre les débats des COP et la bioéconomie comme stratégie contre le changement climatique ?
Les débats de la COP, en particulier dans cette édition organisée au Brésil, montrent que la bioéconomie constitue une stratégie clé pour répondre à la crise climatique, notamment en Amazonie.
Elle propose un modèle de développement alliant conservation, génération de revenus et valorisation des savoirs locaux, contribuant directement aux objectifs de l’Accord de Paris, auquel le Brésil est signataire.
Pour l’écosystème brésilien de la bioéconomie, il s’agit d’une approche concrète d’atténuation et d’adaptation, qui renforce les chaînes de production bas carbone et promeut l’utilisation durable de la biodiversité.
Cette vision s’aligne sur le Plan de Transformation Écologique du gouvernement fédéral, plaçant la bioéconomie parmi les piliers d’une économie à faibles émissions de carbone. Ce plan vise à transformer la base productive du pays à travers innovation, finance durable et inclusion sociale.
Cette stratégie est particulièrement pertinente pour lutter contre la déforestation et les pratiques d’élevage prédatrices, principales causes de la perte forestière en Amazonie, en offrant des alternatives économiques durables et à forte valeur ajoutée dans les territoires.
De plus, reconnaître la valeur scientifique des pratiques ancestrales et renforcer les économies des peuples et communautés traditionnelles est essentiel pour maintenir la forêt debout.
Ce sont précisément les terres indigènes, territoires quilombolas et zones d’agriculture familiale qui contribuent le plus à la conservation de l’Amazonie. Valoriser ces économies revient à reconnaître ces territoires comme véritables gardiens de la biodiversité et alliés stratégiques dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique.
En quoi la coopération France–Brésil, à travers des initiatives comme Amabio, peut-elle renforcer la présence des deux pays dans les débats mondiaux ?
La coopération France–Brésil, à travers des projets comme Amabio, approfondit un partenariat historique autour de la protection des forêts tropicales et de la transition écologique juste, désormais enrichi par la convergence territoriale entre l’Amazonie brésilienne et la Guyane française.
Cette dimension amazonienne partagée — entre deux pays disposant de vastes biomes et territoires ultramarins stratégiques — renforce leur présence commune dans les forums mondiaux sur le climat et la biodiversité.
En combinant valorisation des économies de la sociobiodiversité, l’innovation mêlant savoirs scientifiques et traditionnels, et le financement durable, cette coopération s’impose comme référence internationale en matière de solutions intégrées bas carbone, conciliant conservation, inclusion sociale et diplomatie environnementale.
Quelle est l’opportunité stratégique du Brésil pour se positionner à l’international dans la transition vers une économie bas carbone fondée sur des solutions naturelles et régénératives ?
Le Brésil s’est affirmé comme un leader mondial, en articulant sa vaste base territoriale et environnementale à des politiques innovantes et inclusives de protection de la sociobiodiversité et de promotion de la bioéconomie.
Le pays joue un rôle pionnier en soutenant, avec d’autres nations tropicales, le Tropical Forests Forever Fund (TFFF), lancé lors de la COP de Belém.
En transformant la « forêt vivante » en valeur économique et sociale, le Brésil peut se positionner comme puissance de la transition vers une économie bas carbone, en promouvant des solutions naturelles et régénératives alignées sur les agendas mondiaux du climat et de la biodiversité.