
J’ai commencé cette newsletter non pas penchée sur mon Mac ou dans une bibliothèque, mais dans un théâtre. Et plus précisément au Festival d’Avignon, devant La Distance, la dernière pièce de son directeur Tiago Rodrigues. Ce récit de science fiction, dense et bouleversant, nous projette dans un futur proche où l’humanité a colonisé Mars. Une jeune femme, idéaliste, vient d’y arriver dans une colonie expérimentale organisée par une « Corpo-Nation » (qui n’est pas sans rappeler l’entreprise d’Elon Musk – lequel rêve de sauver l’humanité en allant coloniser Mars). Son père, resté sur Terre dans un hôpital à l’abandon, tente de maintenir un lien avec elle à travers des messages vocaux.
Ce dialogue à distance, fragile et différé, devient le théâtre d’un affrontement symbolique entre deux visions du monde. Elle veut faire table rase. Lui croit encore qu’on peut réparer. Elle rêve d’un ailleurs radicalement nouveau, quitte à y céder aux relents d’un totalitarisme technologique. Lui se bat pour sauver ce qui peut l’être ici, dans un monde chaotique mais humain. Ce conflit n’est pas qu’un désaccord familial : c’est une question existentielle.
Faut-il changer le monde ou changer de monde ? Faut-il transmettre ou tout effacer ?
La pièce pousse ces interrogations à leur paroxysme, dans une scénographie spectaculaire en forme de disque tournant sur lui-même. Un plateau circulaire, comme une planète ou une platine vinyle, fait alterner deux paysages en miroir : celui de la Terre et celui de Mars. Au centre, un arbre arraché. Une roche rougeâtre. Des souvenirs flous, une mémoire qui se délite.
Dans ce monde qui vacille quand il accélère, faut-il perdre la mémoire pour se réinventer ? Ou faut-il, au contraire, cultiver les racines pour résister aux secousses ?
Cette question, ici posée avec une rare sensibilité par Tiago Rodrigues, était d’ailleurs très présente dans les festivals du sud de la France cet été : ainsi, Les Perses d’Eschyle, première tragédie de l’histoire humaine connue (472 av. J.-C.), était revisitée à Avignon par Gwenael Morin et un quatuor d’acteurs – non pas tant comme un monument que comme un miroir pour nos temps guerriers ; au Festival Les Suds, à Arles, le groupe Stick in the Wheel faisait vibrer dans le théâtre antique des chants populaires anglais de 1752 sur fond d’électro-folk contemporaine, tandis que Walid Ben Selim, poète et musicien franco-marocain, met en musique des vers soufis du neuvième siècle portés par une voix de feu et de foi ; enfin, lors du bal du 14 juillet, Le Mange Bal réinventait la branle de Noirmoutier et d’autres danses populaires dans une fête électro-folk joyeusement collective et décentrée. Dans tous ces cas, le passé n’est pas sacralisé : il est mobilisé, rechargé, réincarné. Il devient une ressource vivante, une matière à réinterpréter. Une mémoire active. Une racine ravivée qui permet d’oser des formes nouvelles. Et cette approche me paraît devoir nous questionner bien au-delà du théâtre et de l’art. Elle s’adresse en réalité à chacun.e d’entre nous, et peut inspirer tout autant les citoyens que les entreprises ou les territoires.
LA RETRO-INNOVATION : PUISER DANS LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ANCIENS POUR REPONDRE AUX DEFIS CONTEMPORAINS
Car ce geste a un nom : la rétro-innovation. Il ne s’agit pas de nostalgie ni de réaction en résistance au monde qui s’emballe, mais d’un autre rapport au progrès. Dans un monde où tout semble courir vers l’inédit, la rupture, la disruption, la rétro-innovation propose une voie alternative : revisiter des savoirs, des techniques, des formes ou modèles anciens pour y puiser des réponses aux défis contemporains.
Quand on y songe, cette approche est déjà très présente dans nos assiettes par exemple, où de nombreuses entreprises, jeunes ou plus établies, redonnent vie à des traditions délaissées. Créée en 2022, la start-up lyonnaise Vieille Graine propose ainsi des pâtes et farines à base de sorgho et de millet, deux céréales anciennes qui demandent peu d’eau, supportent bien la chaleur et sont riches en nutriments. Ses produits sont distribués dans les réseaux bio, en restauration collective et dans quelques circuits premium…
Autre exemple : la pinsa, pizza oubliée d’origine romaine, mieux digérée et moins calorique car fabriquée à base de farines de riz, blé et soja, est aujourd’hui produite industriellement dans le nord de la France par de jeunes entreprises comme Fourneo Flatbreads.

Dans un esprit différent, la chicorée, une plante de la famille de l’endive, cultivée dans le Nord et réputée contribuer à la stimulation de la digestion, revient sur le devant de la scène alors qu’elle fut longtemps reléguée au rang de substitut de café. La PME CHERICO® a lancé une gamme biologique, sans caféine, qui a trouvé sa place dans les coffee shops urbains et dans les linéaires des supermarchés. Un an après son lancement, elle a annoncé une levée de fonds d’un million d’euros.
Et le croissant végétal de Land&Monkeys emmené par Rodolphe Landemaine ? Il reprend la logique du « croissant ordinaire » qui cohabitait jadis avec le pur beurre. Cette version sans produit animal est 90 % moins carbonée, et se vend désormais dans plus de 20 points de vente à Paris.

Même les vignobles s’y mettent. Des cépages anciens comme l’Orbois ou le Genouillet, oubliés au profit de variétés plus productives, sont aujourd’hui redécouverts pour leur résistance naturelle aux maladies et leur faible taux de sucre. Une réponse aux défis du réchauffement climatique qui menace l’équilibre de nos terroirs.
Enfin, cet été marque le grand retour de la consigne pour réemploi des emballages à large échelle – avec l’expérimentation ReUse, financée par Citeo et pilotée par GO! RÉEMPLOI, qui se déploiera sur 18 mois dans le quart Nord-Ouest de la France. Pour mémoire, la consigne fut inventée au dix-neuvième siècle pour les bouteilles de bière et d’eau gazeuse et s’est généralisée jusqu’aux années 1970, avant d’être abandonnée au profit du jetable (considéré comme plus « moderne » et pratique – avec notamment les bouteilles en plastique PET) dans les années 1980 et d’être considérée comme dépassée avec le développement du tri sélectif et du recyclage dans les années 1990… avant de revenir aujourd’hui comme solution 3circulaire d’avenir, poussée par la réglementation européenne SUP de 2019 sur les plastiques à usage unique et les initiatives pionnières d’acteurs comme Loop, Jean Bouteille Uzaje ou Bout’ à Bout’. Elle incarne aujourd’hui une rétro-innovation circulaire, où l’on redécouvre qu’un ancien système peut être plus vertueux que ceux qui l’avaient remplacé – de sorte que l’ère du jetable pourrait n’avoir été qu’un épiphénomène à l’échelle de l’histoire, comme celle (espérons-le) de la fast-fashion. Depuis juin dernier, donc, 16 millions de consommateurs dans 4 régions (Bretagne , Normandie, HautsdeFrance, PaysdelaLoire) peuvent ainsi rapporter leurs bocaux et bouteilles réemployables dans 750 magasins participants (toutes les enseignes de distribution, de Coopérative Biocoop à Carrefour, et cinquante marques sont partenaires de l’opération) avec une consigne de 10 à 20 centimes par contenant retourné. Le dispositif ambitionne d’atteindre un taux de retour de 50 % dès la première phase, puis 85 % à terme, pour contribuer à l’objectif national de 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027.
PALEO-ENERGETIQUE : REANIMER LES INVENTIONS DORMANTES
Cette même logique inspire le travail de Cédric Carles, designer et fondateur du collectif Paleo-Energetique.org, qui mène depuis 2014 une exploration passionnée des inventions énergétiques oubliées – non pas par nostalgie, mais par conviction que certaines d’entre elles offrent des réponses pertinentes aux défis d’aujourd’hui. Les archives technologiques permettent ainsi de retrouver des inventions oubliées, souvent marginalisées par les choix industriels ou politiques du vingtième siècle.
Le collectif a ainsi exhumé plus de 300 innovations depuis les archives INPI ou les brevets anciens, documentées et partagées dans une base open-source pour être reprises, adaptées, développées. Parmi les exemples marquants de cette base :
Dans son ouvrage Rétrofutur (Buchet-Chastel, 2018), le collectif souligne d’ailleurs que l’innovation ne suit pas une ligne droite. Beaucoup d’inventions ont été oubliées non parce qu’elles étaient inefficaces, mais parce qu’elles étaient trop en avance, mal comprises ou inadaptées aux modèles économiques ou intérêts dominants, souvent liés au pétrole et au charbon. Les redécouvrir aujourd’hui, c’est élargir l’horizon des possibles, de manière éco-efficace sans chercher à « réinventer la roue ».
Ainsi le mouvement paléoénergétique ne vise pas à répliquer le passé, mais à en faire un réservoir de solutions dormantes, un laboratoire d’idées éprouvées. Il parie sur la mémoire active plutôt que sur une fascination aveugle pour la nouveauté, proposant une vision de l’innovation plus humble, plus enracinée dans la mémoire, qui considère le progrès comme un palimpseste (ces parchemins déjà utilisés, dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau) où l’on écrit en tenant compte des couches précédentes. Cette philosophie rejoint celle de la rétro-innovation : valoriser le temps long, penser l’innovation comme un recyclage fertile, questionner les modèles dominants, et rouvrir l’espace des possibles en déjouant le récit linéaire du progrès. Car parfois, avancer, c’est se retourner pour se hisser sur les épaules de ceux qui nous ont précédé.
L’EFFET LINDY OU LA ROBUSTESSE DU TEMPS LONG
Ce geste de retour aux sources peut paraître contre-intuitif dans une époque obsédée par la nouveauté. Mais il est soutenu par une idée forte, celle de l’effet Lindy, cher à mon camarade Arnaud Florentin directeur associé d’UTOPIES (que je remercie pour sa précieuse contribution à cette newsletter) qui le résume ainsi : « au lieu de chercher le next big thing, on peut chercher le next old thing ».
Cette « loi de Lindy » naît dans un article publié en 1964 dans The New Republic par Albert Goldman, critique culturel et biographe américain, qui observe alors les routines du Lindy’s Deli à New York, repaire d’humoristes. Ces derniers y formulent une maxime empirique : plus un comédien passe à la télévision, plus sa carrière sera brève. Autrement dit, l’exposition médiatique accélère l’usure. Mais cette intuition initiale — à moitié sérieuse — va être renversée et théorisée autrement par le mathématicien Benoît Mandelbrot. Dans ses travaux des années 1980 sur les phénomènes statistiques, ce dernier soutient qu’un phénomène qui a duré longtemps est plus susceptible de durer encore. Il introduit une lecture probabiliste : la durée passée devient un indicateur de robustesse.
C’est finalement l’essayiste Nassim Nicholas Taleb dans son livre Antifragile (2012), qui donne au Lindy Effect sa version la plus connue aujourd’hui et en fait une règle heuristique de résilience. Pour lui, cette loi s’applique à tout ce qui n’est pas vivant — idées, livres, technologies, traditions, entreprises — et peut se formuler simplement : l’espérance de vie future de certaines choses « non périssables » est proportionnelle à leur âge actuel. Un livre vieux de 100 ans a plus de chances d’être encore lu dans un siècle qu’un best-seller du moment. Un pont romain encore debout sera probablement là demain, à la différence d’un édifice récent et à la mode.
Arnaud explique ainsi cette loi à la fin de son livre : « les choses qui existent depuis longtemps ne vieillissent pas comme les personnes, mais vieillissent « à l’envers » : chaque année qui passe sans extinction double (a minima) leur espérance de vie. Cela signifie que quelque chose qui a 40 ans atteindra probablement 40 autres, sinon plus. Pourquoi ? Les choses qui ont résisté à l’épreuve du temps, aux aléas, à la volatilité, au stress, au désordre, sont plus robustes – ou antifragiles, – et sont donc susceptibles de continuer à exister plus longtemps que les nouvelles choses qui n’ont pas encore passé l’épreuve du temps ».
Dans le contexte qui nous intéresse ici de la rétro-innovation, la loi de Lindy nous invite à regarder avec attention ce qui résiste au temps. À chercher dans la durée, et non dans la rupture, les clés de la résilience. Et à faire naître l’innovation, non pas de la disruption mais d’un dialogue avec la mémoire. Ce principe éclaire sous un nouveau jour les traditions, les savoir-faire anciens, les formes culturelles oubliées — non comme des reliques, mais comme des vecteurs de robustesse et d’inspiration pour demain. La paléo-inspiration traverse ainsi les champs de l’alimentation on l’a vu, mais aussi de l’économie locale, du design, du marketing ou de la chimie. Ainsi le bleu Maya, utilisé il y a plus de 1 000 ans, est aujourd’hui étudié comme l’un des premiers nanomatériaux de l’histoire : un pigment à base d’indigo végétal, extraordinairement stable, encore intact sur les fresques murales ou des sculptures anciennes… car les Mayas ont eu l’idée géniale de mélanger ce pigment à un minéral présent dans certaines argiles mexicaines, pour en faire l’une des encres les plus robustes (et complexes) de l’histoire de l’humanité.
TERRITOIRES : L’INNOVATION PAR LE PATRIMOINE
Un fascinant rapport du CESER NOUVELLE-AQUITAINE – Conseil Économique Social & Environnemental Régional, intitulé « Les patrimoines, leviers de développement des territoires » (2022), explore cette même logique à l’échelle des territoires, invitant à repenser le patrimoine non comme un vestige à préserver dans une vitrine, mais comme un moteur actif de transformation. Au passage, les auteurs donnent un cadrage dynamique de la notion-même de patrimoine, défini comme une construction sociale qui rassemble ce que nous jugeons digne de conserver de nos prédécesseurs, et que nous choisissons de transmettre aux générations futures. Partant du constat qu’avec plus de 6 200 monuments historiques classés ou inscrits, la région possède le patrimoine le plus dense de France métropolitaine, il affirme que ce patrimoine devient véritablement utile lorsqu’il est mobilisé au service du développement local. Ce, d’autant plus que dans une époque où une quête de sens s’exprime, les patrimoines sont porteurs de valeurs et sont des leviers de cohésion sociale et de dynamiques territoriales. Ainsi, le patrimoine participe au récit territorial et à la qualité du cadre de vie, c’est un levier de reconquête des centres-villes et des centres-bourgs, il est porteur d’une dynamique économique significative (revenus, emplois…) et bien sûr, il est une « matière première » essentielle du tourisme. Ainsi quand on restaure un moulin à eau, une filature ou un sentier oublié, on ne valorise pas seulement un souvenir : on crée des emplois, on attire des visiteurs, on redonne du sens aux habitants.
Afin de « faire territoire par le patrimoine », le CESER décline une trentaine de fiches avec des initiatives concrètes illustrant toute la diversité des manières de mobiliser le patrimoine au service de l’innovation locale, et débouchant sur une méthode pour le faire – qui commence par la connaissance du patrimoine local, puis sa mise en projet(s), sa protection et sa valorisation, sa transmission avec une implication des habitants, sa structuration en filière et en métiers.
Parmi les exemples concrets figurent le label Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) – L’excellence des savoir-faire français qui valorise les entreprises porteuses de savoir-faire artisanaux ou industriels d’excellence : en Nouvelle-Aquitaine, 172 entreprises bénéficient de ce label, notamment dans des secteurs comme l’ébénisterie, la coutellerie ou la céramique. C’est un outil fort pour ancrer l’économie dans la transmission et la qualité, avec des retombées locales en emploi et en image. Naturellement les AOP et AOC sont également citées comme des piliers de ce patrimoine vivant, car ces indications protègent et valorisent des savoir-faire exigeants dans un cadre collectif : le rapport cite l’exemple du fromage OssauIraty, du piment d’Espelette, mais aussi du Cognac, du Pineau ou encore des vins de Bordeaux – tous emblématiques d’un lien étroit entre territoire, pratiques anciennes et réputation mondiale.
D’autres exemples valorisent par exemple la communauté de communes de Saint Jean d’Angély, qui réhabilite des friches patrimoniales, restaure des couvents, et soutient l’artisanat local pour en faire des outils de développement et de fierté collective. Dans la Ville de Poitiers, le projet de revitalisation du quartier du Palais articule de la même façon bâti historique, nouvel urbanisme et lien social pour transformer un héritage en moteur de renouveau. À Mauléon Licharre, ce sont les espadrilles basques, emblèmes du textile local, qui réconcilient artisanat ancestral et design contemporain. Dans l’île de Ré, les marais salants sont réactivés par des paludiers soucieux de durabilité, mêlant tradition, écologie et économie locale. Le patrimoine naturel n’est pas en reste : en Haute-Vienne, la culture du châtaignier est relancée comme réponse agroécologique à la perte de biodiversité et aux sols pauvres. Et les chemins de Saint Jacques de Compostelle, bien plus que des sentiers de randonnée, irriguent encore la vie économique et symbolique de nombreuses communes.
Ces études de cas montrent qu’il ne s’agit pas de muséifier le passé, mais de l’activer. Le rapport du CESER insiste sur le rôle du patrimoine comme levier d’innovation sociale, de développement économique et de construction identitaire. À condition, précise-t-il, de ne pas en faire un décor figé, mais une ressource partagée, vivante et évolutive – nourrie par la participation des habitants, facilitant la création de circuits courts, la valorisation des savoir-faire, l’emploi local, et la construction d’une identité partagée. Un héritage en mouvement, en somme.
LA MEMOIRE COMME LEVIER D’AVENIR POUR LA STRATEGIE DES MARQUES
Les entreprises et les marques peuvent tout autant tirer parti de ces approches. Certaines emploient des historiens, explorent leurs archives, relisent leurs récits fondateurs, explorent le potentiel de matières premières ancestrales, rééditent des produits anciens avec une nouvelle exigence écologique ou sociale. L’histoire d’une marque est un capital sous-exploité – et plus encore à l’heure de la contrainte climatique, quand les imaginaires liés à la lenteur, à la réparation, à la transmission… redeviennent porteurs de valeur. Il est possible de puiser dans les savoirs, récits et formes anciennes qui ont traversé le temps pour créer des marques plus robustes.
Ainsi la marque Chicorée Leroux, créée il y a 165 ans, a-t-elle relancé la chicorée avec une narration axée sur le terroir et sa filière 100% française, la santé et le goût. Ou encore GALLIA PARIS , marque de bière parisienne relancée en 2009 par deux entrepreneurs sur la base de recettes et de publicités des années 1930, en accord avec un des descendants de la marque.
La maison J.M.Weston (créée il y a 134 ans), en valorisant ses formes iconiques et ses modèles historiques comme le mocassin 180 (créé en 1946 et issu d’une fabrication artisanale entièrement réalisée dans sa manufacture de Limoges), montre comment une grammaire esthétique ancienne peut nourrir une posture contemporaine. Petit Bateau , marque née en 1893, revisite également ses motifs d’archives et ses techniques de tricot pour proposer des pièces plus sobres et durables. Dans le même esprit, le chausseur Paraboot Pro, fondé en 1908, affiche une production 100 % française et s’appuie sur ses modèles historiques comme la Michael (créé en 1945 en période de restriction avec un cahier des charges orienté sur la sobriété) pour conjuguer héritage et style actuel.
Et que dire de SAINT JAMES, née en 1889, dont les rayures évoquent autant le style des pulls marins (ces « marchands d’ail » qui ont donné leur nom aux célèbres « chandails ») que les savoir-faire des ateliers de Normandie ?
Dans tous ces exemples, le patrimoine agit comme une mémoire active, une boussole, un levier de différenciation, d’authenticité, mais aussi de création.
CONCLUSION : (RE)PRENDRE RACINE POUR FAIRE FACE
Dans La Distance de Tiago Rodrigues, la fille choisit l’oubli. Le père choisit la mémoire. Et nous, que choisissons-nous ? Si la réinvention passait moins par la rupture que par la reconnexion ? Si le passé devenait un allié, un socle, un guide ?
Car dans cette époque de bouleversements, nous avons besoin de repères, de robustesse, et de sens. La rétro-innovation ne nous invite pas à reculer devant la complexité. Elle nous donne au contraire les points d’appui pour initier le mouvement. Elle nous invite à penser l’innovation non plus comme une rupture ou une tabula rasa, mais comme une évolution enracinée.
Ce que la rétro-innovation nous suggère, au fond, c’est sans doute ceci : nous avons été trop prompts à jeter. Des savoir-faire. Des objets. Des gestes. Des récits. Des possibilités. Contrairement à une idée reçue, le passé n’est pas poussiéreux : il est fertile, outillé, habité et ancré sur les territoires.
En résumé : il me semble bien que face à l’accélération du temps, à l’obsolescence programmée, la rétro-innovation incarne une forme de résistance joyeuse, qui ne nie pas la modernité mais la nourrit autrement, en proposant un progrès circulaire, enraciné et partagé.
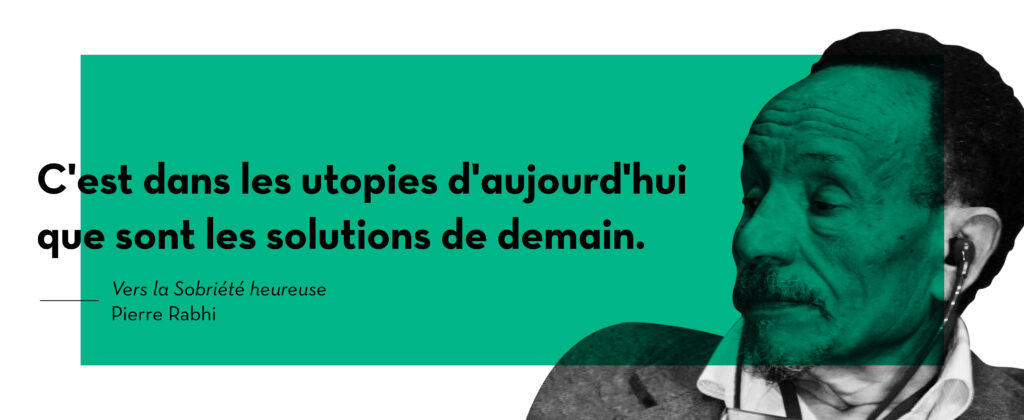
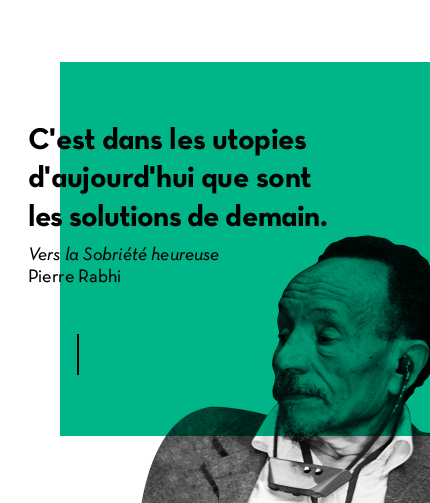
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire