
Après un précédent numéro sur le pouvoir des minorités actives, je persiste et je signe, actualité oblige : nous poursuivons dans cette newsletter l’exploration de ce que la psychologie comportementale, la pensée systémique (notamment celle de l’Ecole de Palo Alto chère à ma camarade Sophie MINGASSON) et les stratégies de bascule inspirées de la psychologiesociale peuvent nous apprendre pour réussir la transition. Car force est de constater que nous avons beau marteler les chiffres, empiler les rapports alarmants, mobiliser autour des COP successives, développer des outils de mesure de plus en plus sophistiqués, et accélérer la prise de conscience… nous ne changeons pas vraiment, ou trop rarement, les pratiques. Et la transition écologique peine encore à advenir. Ou en tout cas bien trop lentement au regard de l’urgence des enjeux.
Pour ne rien arranger, depuis quelques mois, on sent monter une forme de rejet de l’écologie : il y aurait ainsi trop de climat (paradoxalement, alors que les événements climatiques extrêmes, les pics de chaleur et les catastrophes naturelles se multiplient, le dérèglement climatique ne fait plus d’audience – et le temps d’antenne dédiée à l’environnement en 2024 est en diminution de 30% rapport à 2023), trop de normes ESG (voir le recul de l’Europe sur la CSRD mais aussi sur la directive anti-greenwashing), trop d’injonctions à la parité ou à la diversité, et trop de coûts associés à la transition dans une période déjà incertaine et marquée par l’inflation. En face, pour convaincre de tenir le cap, notre réflexe est souvent de faire ce que nous avons toujours fait , en intensifiant nos efforts : expliquer, documenter, convaincre. Mais cette réaction, nous suggèrent les précieux travaux de l’Ecole de Palo Alto, pourrait être ce qui alimente le problème – car quand un problème résiste, c’est souvent parce que la solution elle-même est devenue le problème. Le psychologue Paul Watzlawick et ses collègues (dont l’anthropologue Gregory Bateson, le mari de Margaret Mead) considèrent qu’alors un second niveau de changement devient nécessaire – pour changer de regard, de cadre, de logique. Une approche dont on sait combien Steve Jobs, né à Palo Alto dans les années 50, alors que ce courant de pensée se développe à Stanford, en était imprégné et s’en est inspiré pour imaginer Apple et son approche iconoclaste.
Cette idée qui m’est chère (et que nous avions déjà creusée en 2015 dans l’étude « La vie happy », publiée avec le soutien de l’ADEME et toujours disponible ici) et qui consiste à dire que la solution de la transition ne se trouve pas uniquement dans la science du climat et de l’environnement, mais aussi dans la science du comportement individuel et collectif, est au coeur de deux rapports récemment parus : d’abord le premier rapport de l’ALLIANCE POUR LE GIECO, un collectif de chercheurs fondé par le médecin Jacques Fradin pour éclairer un « angle mort » majeur de la transition : le facteur humain. Et ensuite la note « Vers un pivot majoritaire de l’écologie ? » que l’ONG Parlons Climat vient de publier avec l’Iddri – qui s’intéresse aux conditions d’une bascule de l’écologie des minorités actives vers une majorité sociétale.
Croiser ces approches dans une même réflexion, c’est acter que nous n’avons pas seulement besoin de vérité climatique, mais d’un changement de regard sur le changement lui-même. Ce croisement est d’autant plus fécond qu’il repose sur une convergence profonde. Car le GIECO et l’Ecole de Palo Alto partagent le même constat : la rationalité ne suffit pas. L’un et l’autre s’accordent sur un même pivot, le facteur humain, qu’ils considèrent non comme un obstacle mais comme une clé. Ils proposent un même remède : changer nos façons de faire, de penser, de raconter. Avec une même finalité : faire du changement une aventure désirable.
Faire résonner les enseignements de Palo Alto avec les travaux du GIECO ou de Parlons Climat présente l’intérêt de produire une lecture systémique des impasses actuelles de la RSE et de l’écologie : moralisme, reporting hypertrophié, empilement d’engagements, accumulation de chiffres et de tableaux Excel qui font perdre de vue le sens de tout cela… On est proche de ce que John Elkington appelait il y a quelques années le « carpet bombing syndrome », hérité des stratégies militaires de la Seconde Guerre mondiale : l’idée qu’un bombardement massif – ici d’informations, de preuves et de données – suffira à faire plier l’adversaire, ou à provoquer un sursaut. Sauf que cette approche, si elle rassure ceux qui la pratiquent, rate souvent sa cible et fait des ravages en oubliant que ce ne sont pas les faits qui changent les comportements, mais leur résonance émotionnelle et sociale.
Mais au-delà de l’analyse des dynamiques à l’œuvre et de l’exploration des ressorts profonds de la motivation humaine, un nouveau cadre d’action émerge, puisant dans les sciences comportementales – pour passer de l’information à l’activation, de l’argumentaire à l’émotion, de la norme au récit, de l’indicateur à l’imaginaire, de la compréhension des écosystèmes à celle des conditions du changement. Et cela pourrait bien être la réponse la plus crédible et efficace à la situation actuelle…
1. LA TRANSITION, UN ECHEC DE LA RATIONALITE ?
Depuis trois décennies, nous avons tenté de convaincre par la science. De prouver, chiffres à l’appui, que l’urgence climatique était réelle. Nous avons cru qu’il suffisait d’avoir raison. Alors nous avons démontré. Mesuré. Justifié. Quantifié. Multiplié les preuves, les labels, les KPI, les cases à cocher. Mais plus nous avons tenté de convaincre, plus la résistance a grandi. Trop d’arguments. Trop de chiffres. Trop de moralisation ou de bonne conscience. Et trop peu de changement, in fine. Car, on le sait en psychologie sociale, savoir n’est pas agir. L’opinion n’engage pas directement le passage à l’action ; parfois la prise de conscience bloque, repousse le problème, voire stimule le déni – comme un effet possible de la dissonance cognitive (Festinger, 1954).
L’École de Palo Alto nous offre sur ce point un angle de compréhension puissant. Fondé dans les années 1950 en Californie, ce courant de psychologie systémique et de communication thérapeutique (mené notamment par Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Don Jackson et d’autres chercheurs du Mental Research Institute – MRI) l’avait pressenti dès ses débuts : faire « plus de la même chose » et multiplier les efforts sur une « tentative de solution » qui semble logique mais ne fonctionne déjà pas, ne résout jamais un problème – cela aggrave le problème. De sorte que comme le disait Watzlawick, « la solution, c’est le problème. »

Parmi les cas célèbres qui ont illustré leur théorie : un mari qui se plaignait que sa femme ne l’écoutait pas, et qui, pour se faire entendre, se mettait à crier. Plus il criait, plus elle se fermait. Sa « solution » était devenue le coeur du problème. Accompagné par Paul Watzlawick, le changement est venu non pas en criant plus fort, mais en faisant le silence.
Car l’approche de Palo Alto repose en synthèse sur trois leviers qu’on retrouve bien (mais c’est un autre sujet) dans le « think different » d’Apple : d’abord interrompre les solutions inefficaces, puis faire ce fameux « pas de côté » paradoxal, un virage à 180° dans la posture (qui modifie la structure même du système ou du récit), et enfin observer ce qui émerge lorsque l’on cesse de lutter contre le symptôme. Ainsi, au patient qui se plaint de troubles du sommeil et cherche chaque jour à se rendormir le plus vite possible quand il se réveille en pleine nuit, Watzlawick demande, dans un premier temps, de retarder au maximum le moment d’un éventuel rendormissement, en faisant exactement l’inverse de ce qu’il fait d’habitude…

Ce constat, le rapport fondateur du GIECO (Groupe International d’Experts sur les Changements de Comportements) le partage pleinement : nous ne changeons pas faute d’information, mais faute de changement dans notre approche du changement. Le facteur humain reste l’angle mort des politiques climatiques, alors même que selon le GIEC (2022), les comportements individuels pourraient réduire jusqu’à 40-70% des émissions mondiales de GES à l’horizon 2050 si les bons leviers sont activés. Mais pour modifier nos comportements, il ne suffit pas de savoir où est le problème : nous devons comprendre comment fonctionnent nos comportements. C’est l’objectif que s’est donné Jacques Fradin, docteur en médecine et psychothérapeute, qui a fait de l’étude du comportement sa spécialité. En matière de médecine comme d’écologie, il est convaincu que le facteur humain est au cœur du basculement de nos modes de vie. Et avec un collectif international de scientifiques (chercheurs en psychologie, neurosciences, sociologie, pédagogie, éthologie…), il a fondé en 2020 une initiative privée, le GIECO (Groupe International d’Experts sur les Changements de Comportements), dont la vocation est précisément de rassembler les connaissances scientifiques qui pourront nous aider à changer.
2. CHANGER, OUI. MAIS COMMENT ?
Le GIECO propose donc dans son rapport une vision holistique du changement de comportement, avec l’idée d’établir un socle commun de leviers éprouvés, ou à tester, pour soutenir la bascule. Pour Jacques Fradin, ce changement repose sur quatre piliers : d’abord, la connaissance – via l’intégration des sciences du comportement dans l’analyse des politiques climatiques ; ensuite le récit – via le fait de proposer des imaginaires désirables, cohérents avec nos émotions et nos valeurs ; ensuite encore, la pratique – via le fait de favoriser les expérimentations concrètes, les nudges, les routines écologiques positives – car comme le disait le philosophe Alain « le secret de l’action c’est de s’y mettre » ; et, enfin, ll’incarnation – via es figures inspirantes, des entreprises pionnières, des communautés en mouvement.
Le premier rapport du GIECO, intitulé « Drivers of behavioral change and non change in transition times » (Facteurs de changement, et de non-changement, des comportements en période de transition – pour l’instant disponible en anglais seulement) est particulièrement complet (plus de 400 pages) et entend marquer une étape décisive : celle d’un changement de regard sur la transition. Car face aux limites avérées des approches rationnelles, technologiques ou réglementaires, il affirme qu’il est temps d’intégrer le facteur humain comme levier central du changement.

S’appuyant sur plus de 250 références scientifiques en psychologie, économie comportementale, neurosciences, sociologie, anthropologie, etc., le GIECO établit un double constat. D’abord, que la connaissance ne suffit pas : les faits et chiffres ne déclenchent pas l’action, car ils peinent à générer du désir, à contrer l’inertie, à franchir les résistances émotionnelles. Ensuite, que l’inaction n’est pas un simple statu quo : elle est animée par des dynamiques profondes de déni, de minimisation, de mise à distance du problème. Elle est aussi une défense identitaire face au changement, perçu comme une menace pour les repères, les habitudes et les appartenances.
Le GIECO souligne que la stratégie technosolutionniste – croire que la science et la technologie résoudront tout – fonctionne comme une excuse implicite pour ne pas changer de comportement. Il rappelle au passage que les humains sont très conservateurs : les bouleversements touchent à l’identité et suscitent un besoin de sécurité, pas d’injonctions.
Dans ce contexte, l’éco-anxiété apparaît paradoxalement comme une bonne nouvelle – car elle signifie que le message du GIEC est entendu, souligne Hélène Jalin, psychologue clinicienne et docteure en psychologie. Dans une étude publiée dans Current Psychology menée auprès de 522 adultes francophones, elle démontre que l’éco-anxiété n’est pas forcément pathologique : elle est une réaction rationnelle à des menaces réelles, qui ne devient problématique que lorsqu’elle paralyse ou isole. Son approche thérapeutique est donc de ne pas chercher à supprimer l’éco-anxiété, mais de la transformer en levier d’action constructive, car une corrélation claire existe entre éco-anxiété et engagement : ceux qui s’en préoccupent passent plus souvent à l’action. Le défi, alors, n’est pas de calmer cette anxiété mais de la canaliser vers des formes de mobilisation collectives, concrètes et restauratrices de pouvoir d’agir.
Au fil des articles qui le composent, le rapport insiste aussi sur le rôle stratégique de la culture environnementale en entreprise – car les études montrent qu’elle a non seulement un impact direct sur les performances écologiques, mais aussi (de manière plus inattendue) sur la performance économique et opérationnelle, via la stimulation de l’innovation et la capacité à éco-innover. Encore faut-il pouvoir piloter et mesurer ces interactions, à travers des outils et indicateurs adaptés.
Autre recommandation clé du GIECO : rendre le changement désirable, visible, humain. Apaiser la peur du chaos incontrôlable en donnant à voir ce qui fonctionne déjà. Car si le cognitif ne donne pas envie, l’émotion, la narration, l’exemple, la mise en situation sont autant de leviers pour dépasser les blocages. Et le rapport de citer les cours d’empathie , dispensés en Scandinavie depuis vingt ans, dès le plus jeune âge : ils ont permis de réduire la violence scolaire de 45%, tout en augmentant les capacités de coopération et l’engagement civique. Le rapport souligne aussi que, de la même manière qu’une personne qui ne fait pas de vélo par peur de l’accident a besoin qu’on lui parle de sécurité plus que de santé, la transition écologique gagnerait à être abordée par des bénéfices indirects : qualité de vie, pouvoir d’achat, lien social, emploi, etc. Une approche qui fait écho également aux recommandations de Dominique Méda et de François Gemenne.
Enfin, le GIECO se propose d’outiller une science du changement appliquée, comme le fait le GIEC pour le climat : produire des rapports scientifiques réguliers, mais aussi des formats courts, co-écrits avec des praticiens, pour tester, documenter, diffuser ce qui marche. Un appel salutaire à sortir des incantations pour entrer dans l’opérationnalité du changement des comportements, au service des acteurs de terrain : institutions, collectivités, entreprises, ONG.
3. DE LA SENSIBILISATION A LA BASCULE : QUELS LEVIERS POUR EMBARQUER VRAIMENT LA MAJORITE SILENCIEUSE DANS UN CHANGEMENT DE PRATIQUES ?
Le think-tank Parlons Climat, associé à l’Iddri pour la note « Vers un pivot majoritaire de l’écologie ? » qui vient de sortir, s’intéresse de son côté aux stratégies qui pourraient donc permettre une sortie des minorités actives et un « pivot majoritaire » de l’écologie.
Pour les auteurs, nous ne sommes en effet pas dans une phase d’essoufflement mais à la fin d’une phase de sensibilisation et de mobilisation, qui fut en effet principalement menée par des experts et des militants, et dont les prémisses remontent au rapport Meadows de 1972 sur les limites de la croissance. L’étude s’intéresse d’abord aux limites des stratégies actuelles qualifiées « d’influence minoritaire » (et basées sur la théorie des minorités actives de Serge Moscovici), où les minorités en question se structurent autour d’un combat, d’une posture spécifique, inventant un nouveau langage et mettant en place des pratiques pionnières pour influencer la majorité. Elles portent une position contestataire singulière, cohérente et persistante, sans se laisser altérer par le discours dominant, afin de faire changer les normes sociales. Pour les auteurs, ces approches ont été cruciales pour mettre l’écologie à l’agenda politique et renforcer sa place dans l’opinion, de sorte que l’intérêt pour les questions environnementales et climatiques y est désormais visible et élevé, mais on assiste à une stagnation après des années de croissance.

Paradoxalement en effet, alors que les événements climatiques extrêmes, les pics de chaleur et les catastrophes naturelles se multiplient, le dérèglement climatique ne fait plus d’audience – et le temps d’antenne dédié à l’environnement en 2024 est en diminution de 30% rapport à 2023. Et la sobriété ne fait plus recette : quand on questionne les Francais sur leurs modes de vie et de consommation (pour mémoire, selon l’ADEME, 83 % des Français considèrent que « les gens consomment trop en France » mais seulement 28 % ont le sentiment de « consommer trop » tandis que 73 % ne considèrent pas consommer plus que la moyenne des Français et que 82 % pensent avoir un mode de vie déjà sobre).
Tout cela, pour une raison très simple : l’écologie a beau être devenue un sujet de société incontournable, la préoccupation de l’opinion publique pour la cause environnementale se heurte désormais aux défis du passage à l’acte et de la mise en oeuvre effective de la transition écologique. Du coup, justement parce que l’écologie a pris du pouvoir ces dernières années, l’opposition se durcit : les forces conservatrices (dont l’inquiétude monte quant à la possible fin du statu quo) deviennent plus radicales, et organisent leur riposte en discréditant les messages et les messagers de la transition, pour maintenir le mouvement en position minoritaire – ce qu’il n’est plus.
Pour traverser cette période, souligne la note, les acteurs de la transition doivent comprendre quels mécanismes issus de leurs actions peuvent expliquer cette situation (ou en quoi la solution est le problème) : en particulier, selon les auteurs (Lucas Francou Damesin Mathieu Saujot et Marion Bet) la promotion de l’écologie a privilégié une approche de « consommateur responsable », mettant l’accent sur la responsabilité et les comportements individuels. Cette approche montre des limites, le pouvoir du consommateur étant limité par ses environnements et par l’offre ou les politiques des entreprises (voir à ce sujet l’excellente étude « Quand on peut, on veut » de l’Iddri que j’ai déjà citée dans un précédent numéro sur le backlash écologique) : des changements collectifs sont nécessaires (au niveau des territoires, des services publics et des entreprises) pour permettre l’émergence de nouveaux modes de vie.

Ensuite, la transformation de l’écologie en un élément de distinction sociale pour les élites aisées et éduquées, les tactiques militantes créant du clivage pour s’assurer une mise à l’agenda politique et médiatique, les tensions issues notamment des réseaux sociaux (les riches contre les pauvres, ou inversement, les jeunes contre les vieux, les habitants des villes contre les ruraux, etc.) et la polarisation politique autour des enjeux écologiques entraînent la création d’une « bulle » qui isole le mouvement et fait de l’écologie une cible facile pour certains acteurs. Et enfin, l’écologie a souvent été abordée comme un enjeu isolé, sans suffisamment prendre en compte les enjeux sociaux et économiques plus larges – ce qui a conduit à un isolement de la cause écologique, pourtant intrinsèquement interdépendante de nombreux enjeux sociaux et sociétaux, et à une difficulté à l’intégrer dans un projet social plus global, illustrée par la fameuse opposition « fin du monde vs fin du mois ».
C’est ici notamment (avec le prisme du contrat social) que les auteurs proposent d’agir, pour mieux arrimer l’écologie aux enjeux sociaux, en reconnaissant que la transition écologique bouscule les règles du jeu et nécessite une renégociation collective. Pour créer les conditions de cette bascule majoritaire de l’écologie, la note propose d’abord de diversifier les figures qui incarnent l’écologie, à partir du constat que les critiques actuelles, ainsi que la polarisation dans l’opinion, concernent aujourd’hui davantage les écologistes eux-mêmes que leurs idées. Le rejet du messager finissant par nuire à l’intelligibilité du message, il est nécessaire selon les auteurs de mettre en avant des « rôle modèles » nouveaux qui incarnent une écologie populaire et non-donneuse de leçons, proposent des solutions pragmatiques, et communiquent aussi sur les bénéfices à court terme du passage à l’acte (santé, qualité de vie pouvoir d’achat, inégalités, sécurité…). Ils recommandent aussi de reconnaître la diversité des situations et d’accepter que l’écologie change de visage et s’adapte au fur et à mesure qu’elle touche de nouveaux groupes sociaux.
Ensuite, leur note propose (dans la lignée de celle de l’IDDRI et du rapport du GIECO) d’agir sur les environnements et les contextes pour rendre les pratiques durables possibles, faciles, désirables et même collectivement répandues « par défaut », plutôt que de se contenter d’injonctions individuelles.
Enfin, l’urgence climatique ne suffisant manifestement plus à « embarquer » les citoyens dans une transition désirable, les auteurs recommandent d’intégrer l’écologie dans un projet politique et social plus large – en repartant des conditions de vie et des préoccupations du quotidien (emploi, pouvoir d’achat, etc.) plutôt que de la seule question environnementale. Selon eux, les préoccupations à court terme (tensions et perte de sens au travail, budgets contraints, vulnérabilité aux crises économiques, déclassement, etc.) ne vont pas s’effacer face à la montée de l’éco-anxiété et de l’insécurité climatique – laquelle exige de plus une capacité de projection dans l’avenir que tous les groupes sociaux n’ont pas. Autre point : il est nécessaire d’éviter la conflictualité directe avec le monde économique (voir le destin récent des réglementations environnementales) en proposant des leviers de changement à la portée de chacun, prenant en compte le pouvoir d’achat mais aussi la réalité économique des entreprises, face à l’inertie des pouvoirs publics. Ce qui revient, dans la lignée des travaux de Théodore Tallent sur le « backlash écologique » que j’avais également évoqués ici, à suggérer de prendre (mieux) en compte les contraintes individuelles et les inégalités sociales face aux coûts de la transition, d’organiser une convergence des luttes (climat, écologie et justice sociale), d’élargir les formes de soutien au-delà des aides financières, et de redonner du pouvoir d’agir à chacun en valorisant une pluralité de parcours et de formes d’engagement.
CONCLUSION : ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI ?
Et si, pour enclencher enfin la bascule, il ne s’agissait pas de “changer le monde”, mais de changer notre manière de vouloir le changer ?
Le facteur humain n’est pas un obstacle. Il est la solution. Pour peu qu’on cesse de le réduire à de la faiblesse, et qu’on le regarde comme un levier d’intelligence collective, de créativité, de récit et de reliance – comme le développe aussi depuis quelques années la Fresque du Facteur Humain de Séverine Millet.
Voici ce que nous proposent – chacun à leur manière – le GIECO et Parlons Climat, en écho aux chercheurs de l’Ecole de Palo Alto : un nouvel art de la transition. Qui ne cherche plus à mobiliser par la peur, l’injonction ou la honte. Qui ne veut plus convaincre, mais activer, accompagner, inspirer, donner envie. Qui ne divise plus, mais veut rassembler. Qui n’impose pas un modèle unique mais accueille une pluralité de parcours et de formes d’engagement. Qui multiplie les récits, les figures, les formats : films, BD, témoignages, expériences immersives, rituels… Qui soutient les acteurs relais : managers, enseignants, élus locaux, médias… qui sont autant de catalyseurs si on leur en donne les moyens.
Et si au bout du compte, la révolution consistait surtout à faire en sorte que la transition ne soit plus une injonction, mais un désir – plus une épreuve individuelle, mais une épopée collective ?
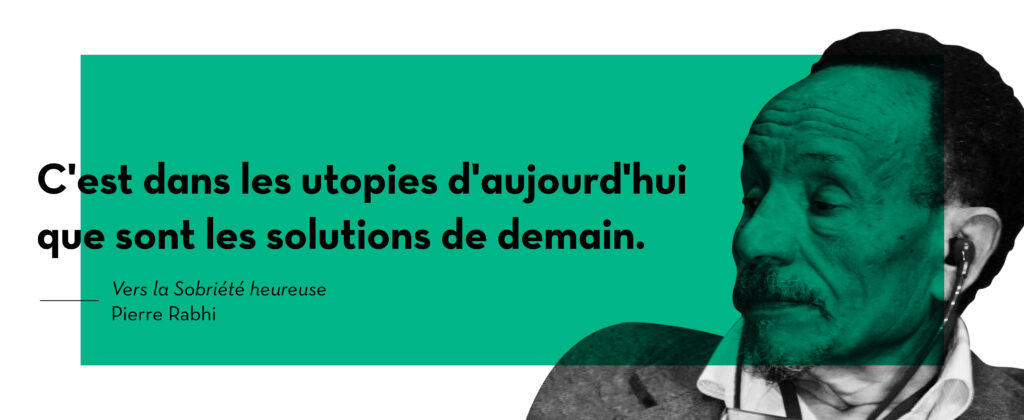
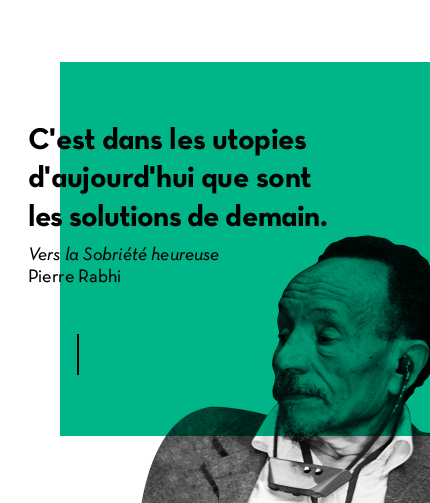
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire