
« Chaque Conseil d’Administration devrait systématiquement avoir trois chaises vides : l’une pour les générations futures, la seconde pour les espèces en danger, et la troisième pour la personne la plus pauvre au monde – afin que leurs intérêts soient pris en compte dans les décisions. » Cette idée et formule géniale de Tom Gladwin, professeur à l’Université du Michigan, m’a été soufflée lors d’une réunion à la fin des années 90 par son ami Jorgen Randers, lui-même professeur au Massachusetts Institute of Technology et à la BI Norwegian Business School, mais surtout co-auteur avec le couple Meadows du rapport fondateur sur « Les limites de la croissance » dans les années 70 (ce qui me permet de mentionner au passage « Cabane » d’Abel Quentin, récemment paru aux Editions de l’Observatoire, et qui raconte de manière romancée l’histoire de ce rapport).
Rien n’est aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue, dit-on : plus de trois décennies plus tard, la Nature, longtemps reléguée à la périphérie du pouvoir économique, commence à se frayer un chemin vers le cœur des décisions. Ce n’est plus seulement une affaire de compensation ou de conformité réglementaire : de plus en plus d’acteurs économiques s’interrogent sur la possibilité – voire sur la nécessité – de représenter la Nature, les écosystèmes et les générations futures dans les lieux de décision.
Pourquoi se poser cette question au fond ? Un excellent petit guide « Onboarding nature » publié fin 2024 par les équipes européennes de B Lab (l’ONG qui préside notamment aux destinées du mouvement #BCorp) l’explique clairement dans son introduction : au fond la nature et le monde non-humain sont les premières et les dernières parties prenantes dans le cycle de vie des activités humaines. Concrètement, selon un rapport publié en amont de la COP16 sur la biodiversité en 2024 par la Banque Centrale Européenne, 72 % des activités économiques en Europe dépendent directement ou indirectement de la préservation de la nature. Et à l’échelle planétaire, c’est plus de la moitié du PIB qui dépend des services rendus par la nature et par la biodiversité, selon le CGDD – Commissariat général au développement durable.

Malgré cette importance capitale, “les entreprises, le secteur financier et les décideurs politiques ont longtemps sous-estimé, voire ignoré l’importance économique des services écosystémiques” explique ainsi la BCE. Ces services sont assurés par les écosystèmes naturels et soutiennent les activités sociales et économiques : le cas des abeilles qui pollinisent les cultures est connu – on estime généralement que parmi les espèces de plantes cultivées, 60 à 80 % dépendent, au moins en partie, des pollinisateurs pour la production de graines et de fruits, et cela représenterait environ 35 % de la production alimentaire mondiale. Mais il y a aussi la végétation qui maintient les sols et retarde l’érosion, les sols qui filtrent et dépolluent les eaux, ou encore la biodiversité qui contribue à la fertilité des écosystèmes. Au total, selon l’institution bancaire européenne, ce sont environ 3 millions d’entreprises européennes qui « dépendent de manière critique des services écosystémiques et seront confrontées à d’importants problèmes économiques en raison de la dégradation des écosystèmes”. En d’autres termes, des secteurs entiers de l’économie européenne ne pourraient fonctionner sans ces services écosystémiques.
Le problème, évidemment, est que l’Europe (comme le monde) subit de plein fouet l’effondrement de sa biodiversité et la dégradation massive de ses écosystèmes. Selon le WWF et son très nécessaire rapport Planète Vivante 2024, les populations d’espèces vivantes se sont effondrées dans le monde de 73% depuis 50 ans, tandis qu’en Europe selon la BCE, près de 1 700 espèces vivantes seraient à risque d’extinction, dont 50% des espèces d’arbres endémiques, ainsi qu’une grande partie des pollinisateurs, qui sont partout en déclin. Selon l’IPBES (le GIEC de la biodiversité) « en Europe […] 14 types d’habitats naturels sur 15 ont vu leur étendue et l’état de leur biodiversité décliner depuis les années 1950 » et 69% des surfaces naturelles de l’UE présentaient un statut de conservation défavorable. Cette dégradation pourrait s’accentuer au fur et à mesure que les pressions sur la nature augmentent, notamment avec l’intensification du réchauffement climatique. Certains acteurs commencent à s’inquiéter des conséquences économiques de cette crise globale car pour les entreprises qui dépendent de la nature, il s’agit là d’une vulnérabilité systémique. « Même des événements apparemment mineurs – comme la disparition d’une seule espèce d’abeille – peuvent avoir des répercussions économiques considérables » explique ainsi la BCE.
Selon elle, ce phénomène menacerait même potentiellement la stabilité financière de l’Europe, puisqu’“environ 75% de tous les prêts aux entreprises de la zone euro sont accordés à des entreprises qui dépendent de manière critique d’au moins un service écosystémique” et que “30% des investissements des assureurs dépendent de manière critique de la nature et des services qu’elle fournit.” Résultat : à une échelle macroéconomique, la crise de la biodiversité pourrait constituer un obstacle dans la réalisation de “l’objectif de maintien de la stabilité des prix et de la stabilité financière” qui est un volet-clef de la mission de la BCE. En sachant que la grande majorité des banques privées et publiques du continent continue en parallèle de financer des investissements qui contribuent à amplifier l’érosion de la biodiversité européenne.
Le premier #NatureBenchmark de la World Benchmarking Alliance (qui couvre la période 2022-2024) a montré que la grande majorité des entreprises « ne comprend pas quelle est la nature de leurs liens à la nature et quels sont les impacts de son érosion sur leurs activités ». Seules 5% des entreprises analysées (dans 20 secteurs d’activité) évaluent ainsi leur impact, 2% sont capables de prouver le fait que leur conseil d’administration a de l’expertise sur les sujets biodiversité ou climat, et moins de 1% ont procédé à une évaluation de leur dépendance à l’égard de la nature.

Du coup, les standards volontaires ou réglementaires tentent de stimuler cette prise en compte : dans la #CSRD, les entreprises doivent désormais intégrer les intérêts des parties prenantes dans leur stratégie, et rendre compte précisément de leurs impacts et dépendances vis-à-vis de la nature, avec un focus spécifique sur la biodiversité et les écosystèmes (via la norme ESRS E4). Elles doivent notamment analyser via la double matérialité les effets positifs/négatifs et réels/potentiels de la perte de biodiversité sur leurs activités, ainsi que leur contribution aux causes de cette perte. Aux États-Unis (SEC – Règle 113), depuis mars 2024, les entreprises doivent divulguer les risques climatiques significatifs, actuels ou anticipés, affectant leur stratégie et leurs performances financières. En Afrique, de plus en plus de pays mettent en place des mécanismes de divulgation environnementale pour éviter que les efforts liés à la nature ne soient discrédités par des accusations de #greenwashing. Et en Asie, bien que les normes de l’ISSB soient pour l’instant volontaires, elles devraient devenir obligatoires dans plusieurs pays d’ici 2025.
Autrement dit, comme le souligne le Forum de Davos lui-même, la Nature est le fondement de la croissance économique et de la création d’emplois, et par conséquent la principale “partie prenante” de notre époque. Et peu à peu pointe l’idée qu’on ne peut plus se contenter de mesurer les impacts des entreprises sur la nature… mais qu’il faut aussi trouver des moyens d’écouter aussi ce que la Nature aurait à dire, si elle était autour de la table. Même le World Economic Forum, qui a pourtant peu de choses à voir avec un druide ou un chamane, affirme désormais que « les entreprises doivent entamer un dialogue avec la Nature et écouter les écosystèmes ».
Cette formalisation progressive du rôle de la Nature comme partie prenante se déroule de manière intéressante en parallèle et en synergie avec le mouvement des #DroitsdelaNature (Rights of Nature) – une approche juridique qui vise à étendre la protection des espèces non humaines et des écosystèmes en leur reconnaissant des droits légaux, pour donner à la Nature une personnalité juridique.
En mars 2023, plus de 500 initiatives de Droits de la Nature étaient ainsi recensées dans 29 pays par l’ONG Earth Law Center.
L’Équateur a été le premier pays au monde à inscrire les droits de la Nature dans sa Constitution, dès 2008, reconnaissant à la #Pachamama (Terre-Mère) le droit de maintenir et régénérer ses cycles vitaux – un cadre qui permet à tout citoyen ou collectif d’intenter une action en justice au nom de la Nature, notamment pour protéger la forêt amazonienne.
En Colombie, le fleuve #Atrato, menacé par l’exploitation minière illégale, a obtenu en 2016 le statut de sujet de droit, avec des droits à la protection, la conservation et la restauration – permettant aussi le respect des droits fondamentaux des populations riveraines, notamment les communautés afro-colombiennes.
Un an plus tard, le fleuve #Whanganui, sacré pour les Māori, est devenu la première entité naturelle au monde à obtenir un statut juridique complet – il est désormais reconnu comme une personne morale, ou un ancêtre vivant, avec deux tuteurs légaux : un représentant de l’État de Nouvelle-Zélande et un représentant des Māori.
Dans la foulée, un tribunal du nord de l’Inde a reconnu le Gange et son affluent, la Yamuna, puis les glaciers #Gangotri et #Yamunotri, ainsi que des lacs et forêts d’Himalaya comme des « personnalités juridiques ».
Aux Etats-Unis, en 2019, les citoyens de Toledo (Ohio) ont adopté par référendum local une “Charte des Droits du lac #Érié”, reconnaissant au lac le droit à exister, prospérer et évoluer naturellement – un droit invalidé ensuite par les tribunaux mais qui a ouvert un débat animé sur la capacité des communautés à protéger les écosystèmes face aux pollutions industrielles.
En France, le #ParlementdeLoire est une initiative artistique et politique lancée en 2019 par le collectif POLAU et l’artiste Camille de Toledo – le projet (qui n’a pas de statut légal officiel) vise à donner une voix juridique et symbolique au fleuve Loire, en réunissant des juristes, des scientifiques, des artistes et des citoyens pour imaginer une représentation du fleuve en tant que sujet de droit.

La même année, l’ONG Wild Legal a été créée en France, et se consacre à la promotion des Droits de la Nature et à l’évolution du droit environnemental pour intégrer la nature comme sujet de droit dans les cadres juridiques existants.
En Europe, le Parlement espagnol a enfin été la première institution nationale à adopter une loi (en septembre 2022) accordant une personnalité juridique à la lagune du #MarMenor et à son bassin versant, avec des droits explicites à la protection, à la conservation, à l’entretien et à la restauration, afin de garantir son droit d’exister en tant qu’écosystème et d’évoluer naturellement.
Cependant qu’un autre exemple intéressant est celui du Pays de Galles, où la loi de 2015 sur le bien-être des générations futures a désigné un Commissaire indépendant pour le bien-être des générations futures Derek Walker, qui présente en ligne sa mission et ses actions) : actif depuis 2016, son rôle est de défendre les intérêts des générations futures (et donc des écosystèmes naturels) dans les décisions publiques. Le souhait prophétique formulé par Tom Gladwin à la fin du 20e siècle est en bonne voie…

Et sans aucun doute, la montée en puissance de ce mouvement des Droits de la Nature au cours des deux dernières décennies a favorisé l’idée d’une intégration dans la gouvernance d’entreprise de la Nature comme partie prenante. Même si les Droits de la Nature relèvent de la sphère publique, tandis que la gouvernance intégrant la Nature concerne les acteurs privés régis par le droit privé, ces deux leviers ont, ensemble, le potentiel de transformer en profondeur notre relation à la Nature, et de faire émerger une vision nouvelle où la Nature possède une volonté propre, une voix, un rôle et des droits.
Comme l’explique le guide produit par B Lab Benelux notamment, plusieurs initiatives, encore marginales mais visionnaires, donnent déjà, d’un bout à l’autre de la planète, un aperçu de ce que pourrait être une gouvernance élargie dans les entreprises.
Ainsi, l’entreprise de cosmétiques naturels Faith In Nature (Royaume-Uni) a été la première au monde, en 2022, à nommer officiellement la Nature comme membre de son conseil d’administration, représentée par une avocate spécialisée en droits du vivant, Brontie Maria Ansell, par ailleurs directrice de l’ONG Lawyers for Nature, et qui a déclaré à The Guardian que son rôle était semblable à celui d’un tuteur représentant un enfant devant un tribunal. Elle dispose d’une voix sur toutes les décisions stratégiques, et cette décision a été prise conformément à la modification des statuts de l’entreprise qui stipulent désormais qu’elle poursuit un double but – le premier autour de son succès économique et le second l’engageant à conduire ses activités de manière à ce qu’elles génèrent un bénéfice pour la Nature.

Toujours en Angleterre, House of Hackney est une marque de décoration d’intérieur engagée à « inspirer chacun.e à protéger notre maison commune en faisant entrer la beauté de la Nature dans la sienne ». Egalement certifiée #BCorp, l’entreprise (qui dit vouloir évoluer vers l’entreprise « véritablement régénérative » en allant au-delà de la préservation pour contribuer à la restauration et la régénération des ressources naturelles et des systèmes sociaux) a suivi les conseils de Tom Gladwin peut-être sans le savoir… et consacre désormais deux sièges au sein de son conseil d’administration à ces questions, avec une place pour la Nature et une autre pour les générations futures.

Dans le même esprit, Tony’s Chocolonely, marque hollandaise engagée pour un chocolat 100% sans esclavage, a innové en 2023 avec un dispositif de gouvernance unique : le #MissionLock, un comité composé de trois “Gardiens de la Mission” qui forment un verrou éthique intégré à la gouvernance, pour protéger la mission via un pouvoir de veto sur tout changement légal qui trahirait les engagements fondamentaux, et le pouvoir de traiter toute alerte liée à des pratiques en contradiction avec la mission (n’importe quel acteur de la chaîne, y compris les travailleurs en amont ou une ONG, peut faire remonter anonymement ses préoccupations et obtenir une réponse – une démarche rare en matière de gouvernance inclusive)
Aux Pays-Bas, Wilder Land (Pays-Bas), qui produit des infusions issues de la régénération des terres agricoles, qui a intégré dans son comité de mission un écologue indépendant, chargé d’évaluer les décisions de l’entreprise à l’aune de leur impact sur les écosystèmes locaux. Tout comme en France, les #sociétésàmission Laboratoires Expanscience, Aigle ou GSE, entr’autres, ont intégré à leur comité de mission des représentants d’ONG environnementales, des experts de la biodiversité et du climat ou des écologues pour qu’ils portent eux aussi la voix de la Nature. Même approche au Palais de Tokyo pour le programme Ré-générations, puisque l’association Earth Law Center représente les générations futures au comité d’orientation du centre d’art, aux côtés notamment de l’association Les Lycéens! qui représente la génération Z ou de Féris Barkat, le jeune cofondateur de l’organisation BANLIEUES CLIMAT, qui vise à « l’émancipation grâce aux enjeux climatiques dans les quartiers populaires ». Cette approche connaît un succès significatif en Belgique où, depuis 2023, six entreprises wallonnes et bruxelloises (Realco, Maison Dandoy, N-Group, Danone Belux, le groupe Copains, et la brasserie Dupont) ont intégré la Nature et le Vivant dans leur gouvernance, à travers des instances volontaires de consultation et de décision qui se veulent des « comités régénératifs » plus particulièrement dédiées aux enjeux environnementaux (90% des décisions sont ensuite suivies par les conseils d’administration). Dans ce type de comités consultatifs, comme dans les conseils d’administration, la démarche s’inspire un peu de la méthode dite des #chapeauxdeBono – au sens où l’un ou plusieurs des participant.e.s sont invité.e.s à adopter un rôle spécifique, comme celui de la Nature, des générations futures ou de la société civile, afin d’enrichir les débats et de favoriser une prise de décision réellement systémique et inclusive.
Plus récemment et plus connue, Patagonia (États-Unis), entreprise iconique labellisée B Corp depuis 2011, a transféré en 2022 la totalité de ses actions à une fondation-actionnaire dédiée à la planète. Les bénéfices sont reversés à des causes environnementales, sous la supervision d’un comité composé de scientifiques, juristes et militants pour le vivant – ce qui amené l’entreprise à annoncer que la Terre était désormais son seul actionnaire.

Le rapport de B Lab cite également deux entreprises hollandaises, le producteur de fromages végétaux Willicroft (qui a hélas déposé le bilan récemment) et l’agence de RP BLYDE BENELUX | certified B Corp™ , qui ont toutes deux fait campagne sur les réseaux annonçant leur décision de nommer symboliquement Mère Nature comme PDG de l’entreprise – une décision qui ne se traduit pas par une représentation au conseil d’administration mais par une présence forte dans la culture qui engage chaque membre de l’équipe à se poser, dans toutes les prises de décision, la question-clef de « ce qu’en penserait Mère Nature, ma PDG ? ».

Dernier exemple en date : le groupe de services numériques norsys a fait parler de lui en France ces dernières semaines, en attribuant à la Nature un siège avec droit de vote (et droit de veto) au sein de sa fondation-actionnaire. La Nature y est donc désormais représentée par Frantz Gault (auteur de « La Nature au travail » chez EPFL Press et co-fondateur de l’association belge Corporate ReGeneration), qui est consulté sur toute décision stratégique à impact environnemental. En complément, un Haut Conseil pour la Nature a été créé pour regrouper tous les représentants environnementaux dans les organes-clés de l’entreprise (comité de mission, comité éthique, comité permaentreprise…), et le CSE a été transformé en Conseil Social, Économique et Environnemental, avec un droit de regard sur les actions écologiques du groupe. L’ensemble s’inscrit dans une logique de soutenabilité forte, déjà inspirée de la nature via le modèle de “permaentreprise” développé par Sylvain Breuzard (voir son livre éponyme chez Eyrolles et le site web dédié).

À partir de ces exemples, quatre modèles d’intégration de la Nature comme partie prenante de l’entreprise ont été identifiés par B Lab – allant de la Nature comme source d’inspiration (y compris pour la mission statutaire de l’entreprise) à la Nature comme actionnaire (le cas de Patagonia), en passant par la Nature comme conseillère (le plus souvent il s’agit de présence d’une « voix censée parler pour la Nature » dans un comité consultatif ou un comité de mission) et la Nature comme administratrice.

Ces modèles et leurs expérimentations, encore rares, dessinent les contours d’une gouvernance post-anthropocentrée. Une gouvernance qui considère le vivant non pas comme un “stakeholder à risque”, mais comme la condition-même de possibilité de toute activité humaine et économique. Sur ce sujet, certains acteurs financiers esquissent également des approches novatrices : ainsi, en 2023, le gestionnaire d’actifs responsable Regnan (Australie), filiale de Pendal, a publié un rapport incitant les entreprises et les investisseurs à penser un nouveau cadre de gouvernance pour les investisseurs et les entreprises pour mieux intégrer la biodiversité, les écosystèmes, mais aussi les cultures et savoirs locaux – à l’encontre des approches actuelles de gestion de la biodiversité jugées trop fragmentées, technocratiques et déconnectées des réalités sociales.
Repenser la #gouvernance, on le sait, est sans doute l’un des leviers les plus structurants de la transformation écologique et sociale des entreprises. Mais la gouvernance de la transition ne se résume pas à mieux allouer les responsabilités, à former ou diversifier les profils, à perfectionner les indicateurs et les critères de décision, à faire évoluer les politiques et les rémunérations. Elle suppose, dans sa forme la plus avancée, une redéfinition radicale de qui a voix au chapitre – et sur quoi. Autrement dit : qui est légitime à participer aux décisions qui engagent notre avenir commun ?
Les exemples évoqués dans cette newsletter montrent qu’il est désormais possible – et peut-être nécessaire – de faire entrer dans les cercles de décision des voix absentes mais essentielles : celles des générations futures, des plus vulnérables, des écosystèmes fragiles, des non-humains, des territoires sans représentation.
Dans la logique de Tom Gladwin, poser trois chaises vides autour de la table, c’est questionner la nature-même du pouvoir économique : faut-il encore le réserver à ceux qui le détiennent, ou l’élargir à ceux qui en subissent les conséquences sans jamais être invités à la table des négociations ?
Plus qu’un symbole, ces expérimentations esquissent une gouvernance à visée #régénérative, où les entreprises cessent d’être des agents de prélèvement des ressources ou d’accumulation des richesses pour devenir (par intérêt bien compris aussi) des garantes de l’habitabilité du monde qui conditionne leurs activités. Cela suppose d’intégrer, dans les comités de mission, les fondations actionnaires, les conseils d’administration, des garde-fous éthiques, des tuteurs du vivant, des portes-paroles de cette habitabilité.
Ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas d’une poétique utopie, ni d’une coquetterie intellectuelle. Mais plutôt, très pragmatiquement, d’un levier-clef pour les entreprises qui veulent rester pertinentes et résilientes dans un monde marqué par la raréfaction des ressources, les crises systémiques et la quête de sens.
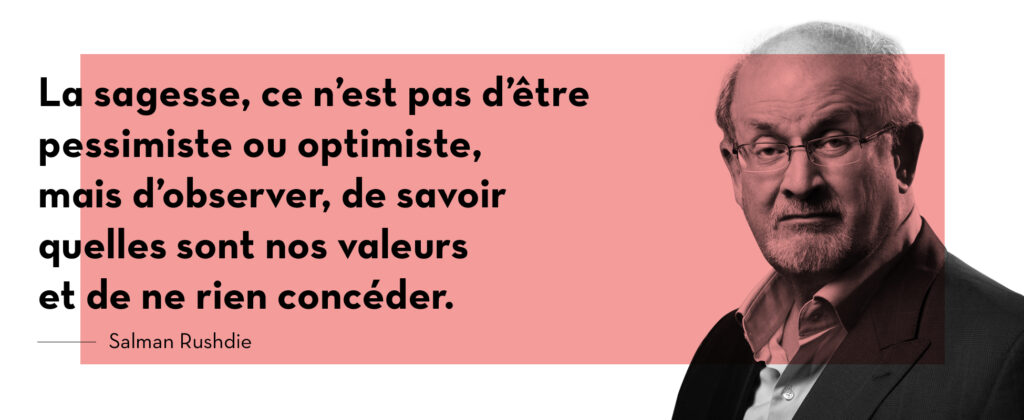
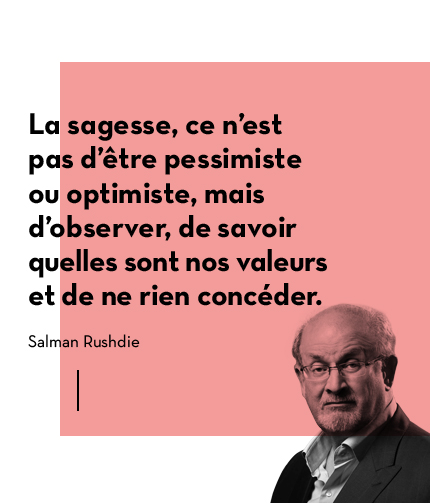
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire