
Crise climatique, fractures sociales, inflation, désenchantement démocratique : les « poly-crises » qui s’entremêlent aujourd’hui mettent à nu les fragilités du modèle dominant. Plus les appels à « verdir » le capitalisme se multiplient, plus paradoxalement les résistances montent contre cette transition qui ne se soucie pas toujours de justice sociale… aussi une question plus radicale s’impose-t-elle : et si une autre manière d’entreprendre, déjà bien vivante, pouvait nous servir de boussole vers la transition juste ? L’Économie sociale et solidaire (ESS) n’est pas une utopie à la marge. En France (premier pays coopératif d’Europe), elle représente déjà un pan entier de l’économie, avec 2,7 millions de salariés et 13,7 % de l’emploi privé, dans des coopératives, mutuelles, entreprises sociales, associations et fondations qui placent l’utilité sociale et l’ancrage territorial au cœur de leur mission. Mieux encore : au 1er semestre 2024, l’emploi dans l’ESS a progressé de +1,4 %, soit près du double du rythme moyen enregistré au cours de la décennie précédente. Autrement dit, et c’est la bonne nouvelle qui justifie cette newsletter, l’ESS est une réalité économique, mais aussi un laboratoire politique, social et culturel qui démontre chaque jour qu’une autre économie est possible — et qu’elle est peut-être déjà en train d’advenir.
À l’heure où un certain récit autour du backlash écologique menace de freiner les transitions en opposant environnement et justice sociale, l’ESS vient utilement rappeler (et prouver, souvent) que ces deux dimensions sont indissociables. La transition écologique ne sera acceptée que si elle est aussi protectrice des emplois, des territoires et des plus fragiles. C’est précisément ce que l’ESS met en pratique depuis des décennies : une manière unique d’articuler sobriété et solidarité, climat et inclusion, innovation et ancrage démocratique.
Cette thèse, c’est aussi celle du livre Une autre entreprise est possible (éd. Le Bord de l’eau), à paraître le 2 octobre, co-écrit par Christophe Sente et Timothée Duverger, responsable de la Chaire Territoires de l’Économie Sociale et Solidaire TerrESS à Sciences Po Bordeaux. Pour Timothée, avec lequel je me suis entretenue pour ce numéro un peu plus long à faire et à lire mais que j’espère aussi passionnant pour vous que pour moi, « l’ESS est déjà le futur souhaitable déjà là », mais encore trop fragile si elle n’élargit pas sa base sociale et ses alliances – avec les syndicats, les collectivités, les entreprises engagées, les mouvements citoyens ou politiques… « Karl Polanyi montrait déjà en 1944, avec une analyse qui reste très pertinente, qu’il existe toujours deux mouvements : celui qui vise à libéraliser et autonomiser le marché, ce qu’on voit aujourd’hui aux Etats-Unis évidemment… et celui qui cherche à le réencastrer dans la société avec d’autres finalités. L’ESS s’inscrit dans ce second mouvement : elle existe pour démarchandiser certaines activités, mais aussi le travail ou la nature, en proposant des alternatives concrètes – mobilités partagées, alimentation durable, économie circulaire, finance au service de projets collectifs. Certes, ce ne sont pas des modèles parfaits car ils évoluent dans un cadre capitaliste, mais ils apportent des solutions très efficaces aux enjeux sociaux et écologiques » souligne Timothée.

1. QUAND L’ESS AMORTIT LES CRISES ET PROTEGE L’EMPLOI
Souvenez-vous : en 2020, l’économie française plonge brutalement dans le choc du COVID. L’emploi recule de 2 % dans le secteur privé, mais seulement de 0,9 % dans l’ESS (Observatoire national de l’ESS, 2021) – des chiffres qui surprennent à l’époque mais illustrent toute la capacité de l’Economie Sociale et Solidaire à amortir les crises grâce à sa gouvernance inclusive, à son ancrage territorial et à sa mission d’utilité sociale.

À Roubaix, l’histoire de RÉSILIENCE (que nous avons le plaisir de compter parmi les clients d’UTOPIES – merci à Jean Souflet de sa confiance) illustre puissamment cette fonction d’amortisseur des crises. Nous sommes toujours au temps du COVID : en 2020, au cœur de la crise sanitaire, pour répondre à la pénurie de masques tout en redonnant du travail à des personnes en situation de précarité accrue avec la crise sanitaire, Thibaut Guilluy (cofondateur du Groupe Ares (Association pour la Réinsertion Economique et Sociale), alors Haut-Commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises et aujourd’hui Directeur général de France Travail), et Pierre GUERIN ont l’idée de s’appuyer sur des structures de l’économie sociale et solidaire pour lancer un réseau d’ateliers textiles autour de la production de masques en France. Ensemble, ils mobilisent rapidement 80 ateliers, et forment des centaines de personnes en insertion ou en situation de handicap aux métiers de la couture pour produire 43 millions de masques en quelques mois. Mais Résilience ne s’arrête pas à cette mission d’urgence. Après la crise, elle décroche un contrat de l’État pour fabriquer 180 000 kits textiles “1000 premiers jours”, puis fournit le t-shirt des 45 000 volontaires des Paris 2024 – Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec Decathlon. Produisant du textile 100 % Made in France, Résilience propose des gammes qui vont des tote bags aux accessoires, conçus pour des marques soucieuses de leur impact. Résilience travaille ainsi avec des marques premium comme SANDRO ou Zadig et Voltaire (en valorisant des stocks dormants). Ses bénéfices sont réinvestis par son actionnaire, l’association Plus de gens plus heureux, dont la vocation est d’ « employer le maximum de personnes ». Aujourd’hui, Résilience est devenu un acteur de référence du textile inclusif et durable en France, autour d’une triple mission : sociale (inclusion et adaptation des postes pour personnes handicapées), sociétale (relocalisation, relance de la filière textile française, capacité à produire à grande échelle) et environnementale (matières recyclées, sourcing local) – dans une ville dont l’identité industrielle est marquée par le textile, de sorte que le projet est aussi une manière de réactiver en beauté un patrimoine matériel et social.
Le cas exemplaire de INTERSPORT Group confirme également cette robustesse coopérative. En avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble choisit l’enseigne coopérative pour reprendre Go Sport : 72 magasins repris, environ 90 % des emplois sauvegardés. Il faut dire qu’ INTERSPORT FRANCE s’était déjà distinguée durant la pandémie : alors que le marché du sport s’effondrait, elle surperformait par rapport à ses concurrents, enregistrant en 2021 une croissance de +14 % par rapport à 2019, quand d’autres enseignes restaient fragilisées. Ce différentiel, et le rachat emblématique d’une enseigne privée, illustrent l’effet protecteur du modèle coopératif, capable de maintenir un maillage dense et une proximité client. En 2024, Intersport affiche 3,88 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 6,3 %, et vise 5,5 milliards d’ici 2030.

Autre exemple, toujours temps du COVID : la façon dont les mutuelles de santé ont démontré une robustesse supérieure aux assureurs privés. En 2020, leur résultat technique excédentaire a atteint 3,2 % des cotisations, contre 1,8 % pour les assurances commerciales, tandis que les institutions de prévoyance paritaires (qui sont appartiennent aussi à l’ESS, et dont certaines sont aussi mutualistes comme AG2R LA MONDIALE) étaient déficitaires. Cette résilience s’explique aussi, évidemment, par la baisse de la consommation de soins durant les confinements, qui a généré 2,2 à 2,6 milliards d’euros d’économies pour le secteur des complémentaires santé. Dans un secteur soumis à une taxe COVID exceptionnelle de 1,5 Md€ pour le financement de la Sécurité sociale, les mutuelles en ont été les premières contributrices (elles pèsent près de 50% des cotisations santé, contre 36% pour les sociétés d’assurance et 17 % pour les institutions de prévoyance. Les mutuelles ont aussi choisi de renforcer leurs contributions volontaires pendant la pandémie : création de fonds d’urgence pour les adhérents fragilisés, soutien psychologique gratuit, ou encore dispositifs spécifiques pour les étudiants précarisés – et ont de surcroît mobilisé leur réseau de centres de santé, cliniques mutualistes et Ehpad pour contribuer à la campagne vaccinale, à l’image du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de protection sociale en France avec plus de 11 millions de personnes couvertes. Une action qui a été décisive dans certains territoires sous-dotés, confirmant l’importance du maillage ESS dans l’accès aux soins.
Dernier exemple intéressant : la MAIF a frappé les esprits en avril 2020 en annonçant sa décision de redistribuer 100 millions d’euros à ses assurés auto (soit environ 30 € par contrat), au titre des kilomètres non parcourus durant le confinement. Cette décision militante a été largement saluée, comme une autre manière d’incarner la différence mutualiste – celle qui fait primer l’intérêt collectif des sociétaires sur le profit, dans le champ de la santé ou en dehors.

2. QUAND L’ESS SOIGNE ET INCLUT : SANTE ET SECTEUR SOCIAL
L’ESS est donc tout particulièrement présente au cœur du secteur social et médico-social. L’exemple du GROUPE SOS est emblématique : né dans les années 1980 à l’initiative de Jean-Marc Borello pour répondre à la crise du sida et à l’exclusion des jeunes, il est devenu en quarante ans un acteur majeur avec 22 000 salariés, 850 établissements et 2 millions de bénéficiaires par an. Son modèle repose sur une hybridation unique : financements publics, partenariats privés, innovation sociale et ancrage territorial. Actif dans la santé, le grand âge, l’insertion, la jeunesse, la culture et l’écologie, le Groupe SOS intervient comme un « secouriste » territorial au service des grands enjeux locaux, fidèle à sa philosophie fondatrice (Sauver, Oser, Servir), tout en prouvant qu’une structure associative peut rivaliser avec de grands groupes privés pourvu qu’elle garde l’utilité sociale comme boussole.

Dans le champ du handicap, l’Adapeila (Association Départementale des Amis et Parents des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique) illustre également la force de l’ESS. C’est l’une des plus importantes associations du réseau Unapei, première fédération française du secteur médico-social (900 associations, 3 000 établissements et services, plus de 200.000 personnes accompagnées) – née d’un mouvement de familles qui, face à l’absence de solutions publiques, a bâti pas à pas un réseau d’accompagnement durable, ancré dans les territoires et reposant sur des valeurs de solidarité et de dignité. Avec près de 100 établissements et services, plus de 3 100 personnes accueillies et un budget de 144 M€ en 2023, l’ADAPEILA se distingue comme l’une des plus grosses ADAPEI de France. N’hésitant pas à adopter une vision holistique de sa mission, l’ADAPEILA a tout particulièrement pionnière dans l’élaboration d’une stratégie RSE au sein d’un secteur associatif et médico-social encore peu familier de ces démarches – structurant ses engagements autour de 18 axes de progrès (gouvernance, ressources humaines, participation des personnes accompagnées, transition écologique, partenariats territoriaux…) intégrés dans ses projets d’établissement (PERSE), obtenant en 2018 le Label Lucie en 2018 et publiant chaque année un Rapport Social, Financier & RSE qui rend compte de ses impacts et de ses engagements, en chiffres.

Cette démarche pionnière illustre la capacité du secteur associatif et de l’ESS à anticiper les évolutions sociétales en s’appuyant sur leur ADN militant: bien avant que la RSE ne s’impose aux entreprises à but lucratif, ces entreprises (dont certaines ont un statut associatif) montrent qu’il est possible de conjuguer projet social, ancrage territorial et responsabilité environnementale, et contribuant ainsi à positionner l’ESS comme un véritable laboratoire de l’économie de demain.
3. QUAND L’ESS INVENTE DE NOUVEAUX « COMMUNS » AU SERVICE DES TERRITOIRES
On l’a dit, l’une des forces majeures de l’ESS est son ancrage territorial exemplaire, qui permet de travailler le proche au sens de la proximité comme le disait Bruno Latour – une proximité géographique mais aussi affective, culturelle, organisationnelle et relationnelle. Contrairement à des modèles hyper-financiarisés, l’ESS crée des emplois non délocalisables, relie les citoyens à des biens communs concrets et réinvente des services collectifs.
Enercoop, qui vient de fêter ces vingt ans cet été, incarne parfaitement cette dynamique dans l’énergie. Fournisseur d’énergie 100 % renouvelable (et d’origine éolienne pour 70% des volumes), l’entreprise est organisée en 12 coopératives régionales qui associent clients sociétaires, salariés, collectivités et producteurs. Privilégiant la relation directe, Enercoop va au-delà du simple certificat de garantie d’origine de l’électricité et a inscrit dans son ADN l’achat de l’électricité en contrat direct aux producteur⋅ices, pour un maximum de transparence et de traçabilité de l’électricité commercialisée. Fin 2024, le réseau comptait 67 000 sociétaires et s’approvisionnait auprès de 524 producteurs, dont les 2/3 sont des projets citoyens et/ou des projets de collectivités, représentant en volume 40 % de l’approvisionnement. Enercoop propose également des outils pédagogiques et des formations pour inciter les citoyens qui sont ses clients à devenir acteurs de la transition énergétique.

Du côté de la mobilité, CITIZ déploie depuis 2002 un réseau coopératif d’autopartage couvrant la France – avec 2 700 véhicules dans plus de 250 villes et 130 gares, avec plus de 100 000 usagers en 2024 (dont moi à Marseille, j’adore). Mais au-delà des chiffres, Citiz a une histoire singulière : né à Strasbourg dans les années 2000, il a progressivement fédéré des coopératives régionales (Autopartage Provence, Mobility Bourgogne-Franche-Comté, etc.) autour d’un modèle qui permet de mutualiser des véhicules, de réduire les coûts pour les usagers, de libérer de l’espace public et d’éviter l’achat de véhicules individuels. Chaque territoire adapte son offre (nombre et type de véhicules – citadines, utilitaires, électriques, …, tarification ajustée aux usages locaux, implantation des stations en lien avec les collectivités et les usagers…) – une souplesse qui permet à Citiz de tenir tête aux plateformes internationales standardisées de l’autopartage comme Getaround (anciennement Drivy), qui dispose en Europe d’une flotte supérieure à 60 000 véhicules disponibles en libre-service.

Dans l’agriculture, Terre de Liens a de son côté permis de soustraire 12 000 hectares de terres agricoles à la spéculation, d’installer près de 1 000 paysans, et de mobiliser 44 000 citoyens-épargnants. L’initiative est née en 2003, avec un objectif clair : préserver le foncier agricole pour des pratiques durables. Concrètement, elle combine une fondation reconnue d’utilité publique, un réseau associatif et une foncière solidaire, pour acheter des fermes, souvent grâce à l’épargne citoyenne, puis les louer à des agriculteurs qui s’engagent sur la bio ou l’agroécologie.
Sur un tout autre secteur, celui des médias, la presse indépendante est l’un des visages les plus visibles de l’économie sociale et solidaire. En France, près de 1 600 médias relèvent de l’ESS, soit environ 28 % des titres imprimés, selon ESS France. Alternatives Economiques en est le porte-drapeau : édité par une Scop détenue par ses salariés, il tire encore près de 60.000 exemplaires par mois, ce qui en fait le deuxième magazine économique du pays. À ses côtés, des médias associatifs comme Reporterre ou Basta! fonctionnent quasi exclusivement grâce aux dons de leurs lecteurs, prouvant qu’un modèle sans publicité peut être viable. Coop-médias, la coopérative citoyenne des médias indépendants illustre de son côté une nouvelle génération de projets, fédérant Politis, Socialter, Climax, Fracas ou Vert pour mutualiser moyens et financement citoyen. Au-delà des questions écologiques, ces médias s’aventurent sur des terrains variés – société, culture, politique – en plaçant la participation des lecteurs au cœur de leur gouvernance.
À l’étranger, des coopératives de presse comme Die Tageszeitung (taz) en Allemagne ou El Salto en Espagne montrent que l’information indépendante peut atteindre une véritable taille critique. Fondée en 1978 à Berlin-Ouest, le taz est devenue l’un des quotidiens nationaux les plus lus du pays, avec plus de 60 000 exemplaires vendus chaque jour, et elle reste aujourd’hui un symbole de journalisme coopératif détenu par ses lecteurs et ses salariés. En Espagne, El Salto, né en 2017 de la fusion d’une vingtaine de médias indépendants, fonctionne grâce à une coopérative éditoriale financée par environ 10 000 membres-soutiens. Ces deux exemples prouvent que des modèles adossés à l’économie sociale et solidaire, loin d’être marginaux, peuvent non seulement survivre mais aussi s’imposer comme des acteurs reconnus du paysage médiatique national, en conjuguant pluralisme, indépendance éditoriale, participation citoyenne et soutenabilité économique.

4. QUAND L’ESS REGENERE LES TERRITOIRES
Pour les raisons précédemment évoquées, certains territoires ont bien compris l’intérêt de développer l’ESS – et Thimothée Duverger cite volontiers en exemple les politiques actuelles de l’Espagne, du Brésil ou du Sénégal visant mettre en place des financements, développer des filières coopératives, accompagner le secteur avec des incubateurs, etc.
La ville de Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre, est devenue un cas d’école de relance par l’ESS (on parle même du « modèle de Preston ») et par ce qu’il est convenu d’appeler le Community Wealth Building depuis la crise de 2008 : triplement des dépenses publiques consacrées aux entreprises locales, incitations aux reprises d’entreprises par les salariés, création de foncières solidaires, accompagnements pour les modèles coopératifs menés par l’Université locale du Central Lancashire… Entre 2015 et 2019, ce modèle municipal a permis une hausse de 4% de l’emploi par rapport à des villes comparables – le taux de chômage local, qui atteignait 6,5% en 2014, est tombé à 3,1% en 2017, passant sous la moyenne nationale (4,6%). Cette amélioration s’est accompagnée d’un boost du bien-être : le salaire médian a progressé de 11%, la satisfaction de vie de 9%, et la santé mentale de 11% – comme le montrent les nombreuses études menées sur ce cas emblématique. Un succès qui témoigne de l’impact d’une stratégie politique forte articulée autour d’un ancrage coopératif local.

Mais le modèle absolu (qui a inspiré Preston) est celui lancé en 1956 dans la cité basque de Mondragón par le prêtre José María Arizmendiarrieta, MONDRAGON Corporation est aujourd’hui le plus grand groupe coopératif au monde. C’est aussi le dixième groupe d’Espagne avec plus de 70 000 travailleurs (dont 30 000 au pays basque, soit 3,4% de l’emploi régional) et 266 entreprises (dont 98 coopératives) qui génèrent plus de 11 milliards d’Euros de chiffre d’affaires dans des secteurs d’activité principalement axés sur l’industrie, la finance, le savoir ou encore l’alimentation – sous le slogan « humanity at work ». Le groupe produit des pièces pour les plus grands constructeurs automobiles, occupe la cinquième place européenne en matière de production d’électroménager et détient une chaîne de supermarchés coopératifs, Eroski, de même qu’une banque, la Caja Laboral. En plus de son activité économique, la coopérative détient son propre système de sécurité sociale et de pension, une douzaine de centres de recherche et de développement et une université, qui jouit d’une bonne renommée grâce au lien étroit qu’elle entretient avec les entités du groupe. Dans une région anciennement marquée par la pauvreté, Mondragon (qui est largement présent à l’international) est devenu la première entreprise locale mais surtout un pilier économique et social, avec un modèle qui repose sur des règles fortes : écart de salaires limité (le rapport historique de 1 à 3 est désormais de 1 à 6 pour éviter la fuite des talents), réinvestissement des bénéfices dans l’entreprise (à hauteur de 60%, le reste étant reversé à la région selon la loi locale pour 10% et attribués aux travailleurs coopérateurs à hauteur de 30%) et solidarité interne (les salariés menacés de licenciement dans une coopérative sont reclassés dans une autre). Exemple emblématique du fait que l’ESS peut être à la fois innovante, profondément démocratique et performante, Mondragon a permis à une région historiquement pauvre de se hisser au rang des territoires les plus prospèresd’Espagne.

5. L’ESS, UN ACTEUR MAJEUR DU LOGEMENT SOCIAL EN FRANCE
En France, le parc locatif social représente environ 5,4 millions de logements, soit près de 17% des résidences principales. Parmi ceux-ci, près de 50 % sont gérés par les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) — structures privées à but non lucratif relevant de l’ESS — tandis qu’environ 45 % sont portés par les offices publics de l’habitat (OPH). Autrement dit : l’ESS, avec notamment les ESH et les coopératives HLM, est très active sur ce marché du logement social où la justice sociale compte tout autant que l’ancrage territorial et la transition écologique (c’est souvent le montant des charges qui fait que les familles ne peuvent pas payer leur loyer, et les bâtiments sobres ont donc une vertu sociale évidente). Et elle innove aussi à travers des modèles hybrides – qui combinent l’épargne solidaire, le volontariat et la transition écologique pour transformer durablement l’accès au logement, réconcilier mixité sociale et dignité, et améliorer la réponse aux besoins locaux.
Prenons trois exemples emblématiques pour l’illustrer. D’abord, Action Logement (client de UTOPIES et souvent présenté comme le premier groupe de l’ESS en France dans le secteur du logement), qui finance et gère plus d’un million de logements sociaux et intermédiaires, logeant chaque année près de 2,5 millions de personnes. Fondé dans le cadre du dispositif du 1 % logement, ce groupe paritaire et interprofessionnel soutient à la fois l’accès au logement des salariés et la rénovation énergétique à travers des investissements massifs : près de 16 milliards d’euros sur cinq ans pour la rénovation, la construction neuve et la transformation de logements vacants. La différence d’Action Logement par rapport à un bailleur public ou privé réside dans son ADN : gouvernance paritaire entre syndicats et patronat, mission au service de l’emploi et du lien entre habitat et territoire, et financement par la participation des entreprises plutôt que par le seul État.
Autre acteur important, Habitat et Humanisme a été fondée en 1985 à Lyon par le père Bernard Devert, ancien promoteur immobilier devenu prêtre, pour loger les plus fragiles au cœur des villes, afin de leur redonner la possibilité de reconstruire leur vie, en bénéficiant d’un logement digne et des liens sociaux qu’offre la vie urbaine. Depuis 40 ans, l’association a inventé un modèle original alliant mobilisation citoyenne, innovation financière et accompagnement social : plus de 4 800 bénévoles et près de 900 salariés œuvrent au quotidien pour offrir aux personnes fragiles un logement digne, souvent en centre-ville. L’association s’appuie sur des foncières solidaires (ex. Habitat & Humanisme Investissement), permettant à particuliers, fondations ou entreprises d’investir dans des projets immobiliers sociaux. Ces foncières gèrent aujourd’hui un patrimoine proche d’un milliard d’euros, constituant un levier majeur pour acquérir, rénover et mettre à disposition des logements accessibles. Bilan des courses : sur quatre décennies, Habitat & Humanisme a permis à plus de 35.000 ménages de trouver un logement stable et accompagné, gérant désormais plus de 9.000 logements sur tout le territoire, et accompagne chaque année environ 7.000 familles. Elle développe également des formes d’habitat innovantes : pensions de famille, maisons intergénérationnelles, résidences pour personnes âgées modestes ou encore colocations solidaires pour étudiants et réfugiés – chaque projet étant pensé comme un levier d’insertion et de reconstruction, où l’accompagnement est aussi important que le logement lui-même.

Enfin, la Foncière Chênelet illustre une autre facette de l’innovation en logement ESS. Créée en 2009 par François Marty, elle construit des logements écologiques de haute qualité pour des ménages précaires, tout en employant des personnes en insertion. Son parti-pris : « à rebours de l’idée reçue de pauvres maisons pour les pauvres », elle conçoit des habitats aux normes suédoises et suisses en matière d’écologie, permettant à leurs occupants de réduire drastiquement leurs charges énergétiques et d’éviter les impayés. Avec 300 salariés, quatre sites industriels en France et une filiale en Belgique, la Foncière Chênelet est à la fois constructeur et bailleur social. Certifiée B Corp depuis 2017 et désormais société à mission, elle démontre qu’un acteur ESS peut tirer l’ensemble du marché vers le haut, en combinant insertion professionnelle, innovation écologique et lutte contre la précarité énergétique
6. L’ESS, LABORATOIRE DE LA DEMOCRATIE EN ENTREPRISE ET DU PARTAGE DE LA VALEUR
On l’a dit, l’ESS ne se limite pas à des pratiques économiques différentes : elle est aussi un laboratoire démocratique. Ses structures — coopératives, mutuelles, associations, fondations — mettent en œuvre des modèles de gouvernance qui interrogent directement le fonctionnement du capitalisme. « Un Homme, une voix » reste la règle dans de nombreuses coopératives, contrastant avec le poids parfois démesuré des actionnaires dans les entreprises conventionnelles.
Cette singularité fait de l’ESS un terreau fertile de citoyenneté, où les salariés, sociétaires, usagers et élus locaux peuvent co-construire les orientations stratégiques – ce qi explique d’ailleurs que la confiance des Français soit bien plus forte envers les assureurs mutualistes (60 %) que les assureurs traditionnels (48 %) ou les banques (42 %), précisément en raison de cette gouvernance transparente et démocratique – selon le baromètre de l’Observatoire de la protection Aéma Groupe (2024).
Des expérimentations comme les conseils des usagers dans les mutuelles de santé, les comités de parties prenantes dans les coopératives ou les fondations, ou encore l’ouverture des conseils d’administration à la société civile, esquissent un modèle de gouvernance élargie où les salariés et les usagers/clients peuvent exprimer leurs besoins et influencer les décisions. Le Labo de l’ESS parle d’une « démocratie au travail » qui vise à rendre l’entreprise responsable devant ses salariés et ses usagers, et pas seulement devant ses financeurs.
Ces innovations démocratiques ne sont pas anecdotiques : elles montrent qu’un autre mode de gouvernance est possible, mieux aligné sur l’intérêt général. Elles pourraient inspirer les entreprises conventionnelles, à l’heure où la défiance envers les dirigeants ne cesse de croître.
Ce d’autant plus qu’au cœur de l’ESS, une autre question est centrale : celle du partage de la valeur. Le label ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) impose par exemple des règles strictes : lucrativité limitée, encadrement de la rémunération du capital, réinvestissement de la majorité des bénéfices dans le projet, limitation des écarts de salaire…. Ces contraintes, loin d’être des freins, garantissent que la valeur créée sert l’intérêt général.
En janvier 2023, la MAIF a lancé son « dividende écologique », consacrant 10 % de ses bénéfices annuels — soit 18 M€ depuis 2023 — à financer des projets de régénération écologique et de prévention des risques. « Ce dividende est la traduction financière de notre engagement militant, expliquait son PDG Pascal Demurger lors du lancement. Parmi les projets soutenus : la restauration de zones humides avec CDC Biodiversité, des programmes d’éducation aux risques climatiques dans les écoles, ou encore des actions de prévention routière.
Au même moment, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, de son côté, instaurait un « dividende sociétal » – se montant à 15 % du résultat net, soit près de 3 milliards d’euros annoncés d’ici à 2027. D’ores et déjà le dividende sociétal du Crédit Mutuel s’est établi à 439 millions d’euros en 2023 et à 617 millions d’euros en 2024 – ce qui en fait désormais le premier mécène de France. Concrètement la moitié de l’enveloppe est consacrée à un « fonds de révolution environnementale et solidaire », chargé d’investir dans des entreprises porteuses de projets à impact, sans considération de leur rentabilité financière ; 35 % est consacrée aux développements de nouveaux services solidaires à destination des clients et sociétaires de la banque, comme des prêts à taux zéro dédié à la rénovation énergétique délivrés à des clients aux revenus modestes ou des programmes d’inclusion numérique (ordinateurs pour familles modestes) ; et les 15 % restants sont attribués à des activités de mécénat tournées vers la solidarité entre les territoires et l’environnement. « Nous voulons ancrer la solidarité dans nos statuts », affirmait lors de son lancement Nicolas Théry, son président (qui vient de co-signer « Pour une société plus mutuelle » avec Daniel Baal, paru en mai dernier aux Éditions de l’Aube). Un mécanisme structurel qui transforme en effet le mode de calcul de la prospérité : une part fixe des profits devient un levier systématique de transition et de solidarité.

En mai 2025 également, Harmonie Mutuelle (qui fait patie du Groupe VYV) a annoncé sa décision d’activer à son tour et pour la première fois un « dividende Éco-santé », dispositif inédit de redistribution de ses excédents. Forte de résultats positifs en 2024, la mutuelle -qui n’a aucun actionnaire à rémunérer – a décidé de reverser 84 millions d’euros à ses adhérents particuliers et entreprises clientes sur deux ans. Concrètement, dès juin 2025, près de 40 millions d’euros ont été versés directement aux assurés éligibles, sous la forme d’un virement bancaire de 44 € par contrat santé. Une deuxième phase de redistribution, de 44 millions d’euros supplémentaires, sera pilotée par son conseil d’administration. Cette initiative s’inscrit dans le mouvement Écosanté lancé par Harmonie Mutuelle pour promouvoir une consommation de soins plus responsable et une prévention renforcée. Comme le souligne Catherine Touvrey, sa directrice générale, il s’agit d’un geste « pour une protection sociale juste et transparente et pour une santé accessible et durable », qui est aussi une bonne illustration de la spécificité mutualiste – Harmonie Mutuelle s’engageant à garantir qu’au moins 80 % des cotisations santé sont reversées sous forme de prestations et/ou, quand les résultats le permettent, redistribuées directement aux adhérents.
7. LA DIFFERENCE MUTUALISTE : COMMENT VALORISER A L’EXTERIEUR, DANS LE POSITIONNEMENT DE MARQUE, LE BIEN QU’ELLE FAIT A L’INTERIEUR ?
Longtemps, par humilité ou complexe d’infériorité les acteurs mutualistes ont cherché à « ressembler » aux acteurs classiques, effaçant leur différence et insistant sur le fait qu’ils pouvaient être tout aussi performants que les autres… et tout aussi capables d’attirer durablement les clients ou les talents. Mais comme les initiatives ci-dessous l’illustrent, l’heure est désormais à la valorisation de leur singularité, qui a tout pour bâtir une réelle différence de marque – afin que le bien que le mutualisme fait à l’intérieur (en termes de démocratie, de partage de la valeur, etc.) se voit à l’extérieur (innovation produits, ancrage territorial, etc.).
Au début des années 90, une banque anglaise, The Co-operative Bank (filiale d’un groupe coopératif), ouvre la voie de manière audacieuse pour revendiquer la différence coopérative. Prenant au pied de la lettre la gouvernance démocratique, elle s’appuie sur un large sondage réitéré auprès de 370 000 clients sur leurs attentes quant à ce que doit financer (ou pas) leur argent, et sur cette base elle définit sa « politique éthique »qu’elle inscrira dans ses statuts en 2013 – refusant de financer l’armement, les énergies fossiles, les entreprises qui pratiquent des tests sur animaux ou sont suspectes d’atteintes aux droits humains. Les campagnes choc qui lancent cette politique éthique (en presse et TV) mettent en scène différentes situations où, dans une banque classique, les gens épargnent pour quelque chose qui leur tient à cœur (ex. financer les études de vétérinaire de leur fille) alors que leur banque utilise, à leur insu, leur épargne pour financer l’exact opposé (ex. des entreprises faisant des tests sur animaux).

Portée par cette dynamique, The Co-operative Bank plc devient une référence mondiale en matière de finance responsable avec son expérience pionnière de RSE participative auprès des sociétaires et sa politique très robuste… avant d’être fragilisée par la crise financière de 2013, qui entraîna une période compliquée au terme de laquelle la banque a renoué début 2025 avec un actionnariat coopératif qui devrait lui permettre de ré-affirmer fortement sa différence.

Cette différence mutualiste, la MAIF, « assureur militant » auto-revendiqué depuis 20 ans, a également a fait son ADN de marque, qui imprègne autant ses pratiques (le dividende écologique déjà cité) que son offre (épargne responsable, remboursement des médecines alternatives, utilisation de pièces de réemploi dans les réparations automobiles, investissement socialement responsable, protection digitale, etc.) ou ses campagnes de communication désormais déployées avec humour pour rendre le modèle plus contemporain.

Autre exemple intéressant : Crédit Coopératif se revendique clairement en France comme celui qui prouve qu’ « une autre banque est possible », une posture qui structure historiquement son action et son discours, comme en témoigne sa dernière campagne. Son site web invite d’ailleurs à rejoindre « la banque de ceux qui veulent changer le monde » (produits d’épargne solidaires AGIR, investissements traçables et responsables, financement de la transition et de l’ESS, exclusion volontaire des activités spéculatives ou contraires à l’éthique, comme l’extraction de charbon ou les paradis fiscaux …) et positionne sans ambiguïté la banque comme un acteur au service du développement durable, solidaire et responsable. D’ailleurs sa communication externe met le plus souvent sur l’accompagnement des acteurs de la transition – associations, coopératives, entrepreneurs sociaux – plus que sur les produits bancaires. Cette approche permet de maintenir une cohérence forte entre discours, offre et valeurs, renforçant ainsi la légitimité du Crédit Coopératif comme banque alternative, active dans l’économie à impact

Biocoop , enfin, a bâti sa notoriété sur une communication cohérente avec ses valeurs coopératives et militantes : ses campagnes, récentes (l’enseigne ne faisait pas de campagne nationale avant 2011) mais souvent percutantes, n’hésitent pas à bousculer le secteur en relayant des renoncements forts (pas d’eau en bouteilles, pas de fruits et légumes emballés, par de production en serre chauffée ni de produits venant de la zone de production espagnole appelée « mer de plastique », dans la province d’Almería, etc.) tout en affirmant que « La bio nous rassemble ». Mais au-delà de la publicité, Biocoop est aussi très présente localement comme l’illustre sa campagne sur « les missions plus que locales » : chaque magasin est une coopérative indépendante, impliquée dans son territoire et des campagnes militantes locales, qui privilégie l’approvisionnement de proximité et les partenariats avec les producteurs bio régionaux.

Toujours dans la distribution, un cas emblématique est celui de Système U, redevenu Coopérative U en 2024, 40 ans après son premier changement de nom dans l’autre sens : l’enjeu cette fois est de « réaffirmer le choix d’un modèle coopératif agile, solidaire et durable » pour se différencier de ses concurrents hyper-financiarisés, puisque son modèle fondé sur des commerçants indépendants regroupés en coopérative. En 2020, la campagne « Une minute » avait posé les bases de ce choix en opposant un monde de l’entreprise privée hors sol, où des dirigeants prennent des décisions rapides depuis un avion, à celui des coopérateurs de U qui prennent le temps d’aller à la rencontre de leurs producteurs sur le terrain. Une manière subtile de rappeler que la gouvernance démocratique prend du temps, mais qu’elle a les pieds sur terre, au service du long terme.
Côté banques coopératives, le Groupe Crédit Agricole a longtemps incarné cette logique avec ses campagnes emblématiques sur le rôle du sociétaire. Dans ses visuels et spots des années 2010, l’épargnant est montré « ici », tandis que son argent sert à financer « là » (sur le même territoire) une entreprise, un emploi, un projet agricole. Une idée reprise en 2023 par la Fédération nationale des Caisses d’Epargne (FNCE), dans la campagne « grâce à vous »où une mère emmène sa fille à l’école et croise, chemin faisant, tous les projets que son épargne de sociétaire contribue à financer. Dans les deux cas, le message est clair : l’épargne coopérative irrigue directement le territoire.

Une approche que la Banque Triodos (pionnière de la banque éthique en Europe, certifiée B Corp et qui gère plus de 22 milliards d’euros d’actifs) pousse encore plus loin, en étant la seule à garantir une traçabilité absolue de l’argent pour ses cients, puisqu’elle publie chaque année la liste et la carte intégrales des projets qu’elle finance… avec l’argent de ses clients.
8. DES EXEMPLES INTERNATIONAUX INSPIRANTS
À l’international toujours, on l’a dit, les exemples d’entreprises coopératives puissantes et aux marques fortes abondent : ainsi les caisses Desjardins au Québec, fondées en 1900 par Alphonse et Dorimène Desjardins, sont-elles devenues le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord avec près de 8 millions de sociétaires (l’équivalent de population québécoise) au Canada. Vancity, née en 1946 à Vancouver, est aussi une grande coopérative financière, pionnière du dividende sociétal (30% de ses profits sont consacrés chaque année à son programme Shared Success qui finance des actions communautaires ou bénéficie à ses sociétaires via des dividendes) et des cartes de paiement engagées (5% des profits liés à ses cartes de paiement sont reversés à des projets écologiques), avec plus de 560 000 sociétaires et 34 milliards de dollars canadiens d’actifs. Aux Pays-Bas, la Rabobank finance près d’un tiers du secteur agroalimentaire néerlandais.

Deux autres grands exemples méritent d’être cités. En Espagne, le groupe Eroski, fondé en 1969 au Pays basque, est l’une des plus grandes coopératives de distribution en Europe, avec plus de 1 600 points de vente (supermarchés, hypermarchés, stations-service, agences de voyages) – qui fut l’un des premiers clients de UTOPIES il y a 30 ans (sur les prémices de leur stratégie RSE et sur leur engagement pionnier d’école des consommateurs). Sa gouvernance repose sur un modèle dual : les salariés et les consommateurs sont à la fois membres et copropriétaires de la coopérative, avec un système d’assemblées régionales et un conseil élu. Du coup, Eroski est à la fois une enseigne de distribution et une association de consommateurs – un modèle hybride puissant qui se distingue par ses actions consuméristes (campagnes et ateliers d’éducation/sensibilisation des clients au mieux consommer mais aussi média dédié EROSKI CONSUMER – Consumidores bien informados) mais aussi par son engagement en faveur de la santé et de la durabilité : ses supermarchés privilégient les produits frais, locaux et sains, et l’entreprise a été pionnière en matière d’étiquetage nutritionnel simplifié. Le groupe réinvestit une partie de ses bénéfices dans des projets communautaires, éducatifs et environnementaux. Malgré les crises du secteur, il reste un acteur clé en Espagne, incarnant la capacité d’un modèle coopératif à rivaliser avec les géants de la grande distribution.

En Suisse, le Groupe Migros, fondée en 1925 par Gottlieb Duttweiler, est sans doute le plus emblématique des distributeurs coopératifs (et la première enseigne helvétique), selon un modèle imaginé initialement pour créer un « pont » entre les producteurs et les consommateurs. Organisée en coopératives régionales fédérées qui garantissent un enracinement territorial fort, propriété de ses clients-sociétaires (2,3 millions de personnes, soit près d’un quart de la population suisse, qui en détiennent le capital et participent à la gouvernance), Migros emploie plus de 100 000 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires de 32 milliards d’euros en 2022. Elle réinvestit une part significative de ses ventes dans des projets culturels, sociaux et environnementaux, notamment via son fameux « pour-cent culturel » instauré dès 1957 qui finance musées, festivals, formations ou initiatives citoyennes – 121 millions d’euros investis chaque année dans la culture, la société, la formation, les loisirs et l’économie… et un total de 5,9 milliards en sept décennies). Migros a été précurseur dans de nombreux domaines : refus de vente d’alcool et de tabac, commerce équitable, soutien à l’agriculture biologique et locale, promotion des labels de la consommation responsable et création de labels « maison » sur les catégories de produits où il n’en existait pas, transparence… Bien avant l’apparition de la RSE moderne ou des discours sur l’ »entreprise régénérative », Migros démontrait déjà qu’il est possible d’allier innovation, éthique, renoncements et performance économique. Elle incarne aujourd’hui encore ce que peut et doit être une entreprise engagée, pionnière et visionnaire.
En résumé : les exemples ne manquent pas, avec des chiffres et des trajectoires qui attestent du fait que la différence coopérative est non seulement un atout symbolique, mais aussi un facteur de poids économique et d’innovation durable.
CONCLUSION : CE QUE LES ENTREPRISES CONVENTIONNELLES PEUVENT APPRENDRE DE L’ESS ET COMMENT L’ESS PEUT ALLER PLUS LOIN…
L’ESS n’est pas un supplément d’âme pour l’économie : c’est un manifeste vivant. Elle prouve qu’on peut être performant sans renoncer à l’ancrage local, croître sans sacrifier la justice sociale, partager la valeur sans diluer la prospérité. Elle démontre qu’il est possible d’incarner une gouvernance réellement démocratique, de protéger des emplois dans la durée, de créer des communs utiles aux citoyens et aux territoires.
Ce que les entreprises conventionnelles peuvent apprendre de l’ESS est simple et radical à la fois : retrouver leur raison d’être profonde en se mettant au service de la société, plutôt que de se servir des causes sociales pour vendre plus. Dans un monde de méfiance et de défiance, où chacun marche sur des œufs avant de prendre la parole sur ses engagements, l’ESS (qui se méfie elle-même parfois encore du marketing) vient utilement nous rappelle que la confiance se bâtit d’abord par la cohérence entre les actes et les mots.
Comme le montrent notamment les exemples internationaux, ces modèles ne sont pas marginaux mais peuvent atteindre une taille critique et influencer durablement leurs marchés. L’ESS a déjà conquis des secteurs entiers et les 300 plus grandes coopératives ou mutuelles mondiales cumulent un chiffre d’affaires de plus de 2 409 milliards de dollars en 2021, équivalent au PIB du 8ème pays au niveau mondial et représentant quasiment le double du chiffre d’affaires des géants de la tech (Alphabet, Apple, Microsoft et Amazon). Leur trajectoire incarne une autre modernité du capitalisme : un capitalisme coopératif et mutualiste, patient et solidaire, qui met la démocratie, l’ancrage territorial et l’utilité sociale au cœur de son fonctionnement. Ils démontrent qu’il est possible de concilier innovation, performance économique et responsabilité, et qu’il n’y a pas d’opposition entre puissance de marché et exigence éthique.
Alors naturellement, les pratiques de l’ESS sont souvent imitées (et pas toujours égalées) : dans cette phase d’hybridation et de brouillage avec l’économie conventionnelle, nous rappelle Thimotée Duverger, « il est normal que des pratiques de l’ESS soient reprises, imitées, parfois déformées. Mais cela rappelle une exigence : pour rester fidèle à son projet, l’ESS doit s’ancrer dans des règles et des statuts clairs, dans une institutionnalisation solide. Sinon, elle risque la dilution. Bien sûr, elle ne sera jamais parfaite, mais son cadre fait sa différence. »
La bonne nouvelle est que « dans certains secteurs – la santé, la banque, l’agriculture, le médico-social – ou dans certains territoires, l’ESS est déjà dominante. Elle a le potentiel de devenir majoritaire, mais il lui manque, souligne Timothée Duverger, une perspective stratégique, pour qu’elle ne soit plus seulement une « alternative » mais un modèle majoritaire. Elle doit sortir de cette humilité qui la rend si attachante mais nourrit aussi un complexe d’infériorité, assumer qu’elle est tout aussi performante que l’économie classique, et penser son passage à l’échelle – non pas nécessairement en grossissant ou en fusionnant, mais en développant des stratégies de coopération et d’alliances pour transformer en profondeur l’économie.
Du côté de l’économie dominante, cela reste une bonne idée pour rester légitime que de s’inspirer de ce laboratoire grandeur nature. Car l’ESS n’est pas l’ »alternative » : elle est déjà l’avant-garde. Et trace les contours de ce que pourrait devenir l’économie tout entière : une économie au service du vivant, des territoires et des générations futures.
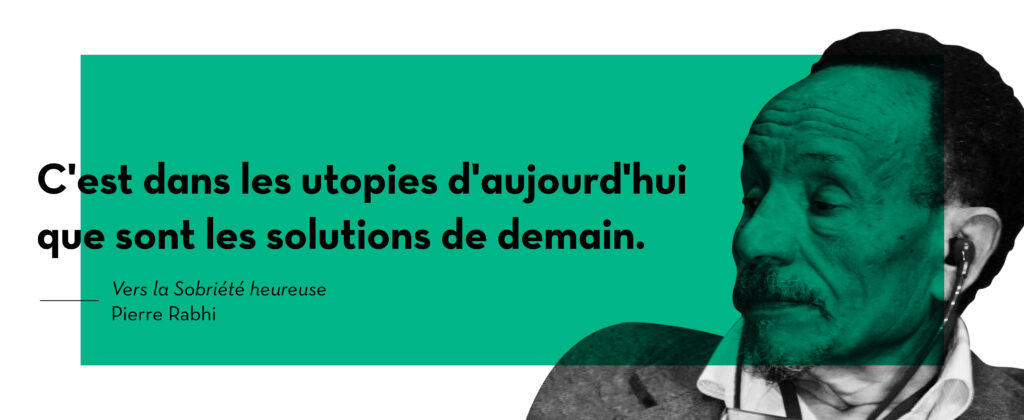
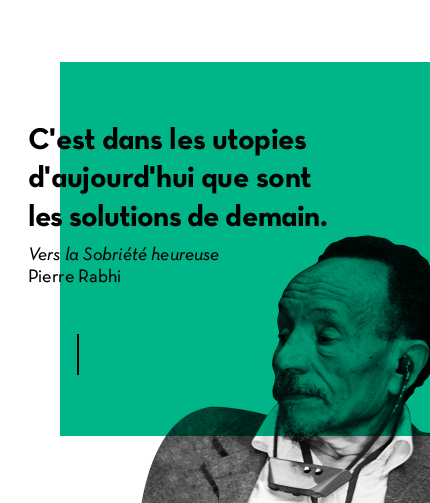
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire