
Et si ce n’était pas la majorité qui faisait l’histoire, mais une poignée d’individus conscients et engagés, comme le disait déjà en son temps l’anthropologue Margaret Mead ? Cette vérité déjà connue des experts de la psychologie sociale comme Serge Moscovici (autour de « Psychologie des minorités actives » dès les années 70), des militants comme Greta Thunberg à la tête de Fridays for Future, ou des alter-entrepreneurs pionniers de la RSE comme Anita Roddick (fondatrice de The Body Shop) ou Yvon Chouinard (fondateur de Patagonia), on la retrouve aujourd’hui au cœur des stratégies de transformation les plus ambitieuses. Car face à la complexité et à l’urgence de la transition écologique et sociale, ce ne sont pas les foules qui font bouger les lignes et déclenchent ces points de bascule qui peuvent changer le monde, mais bien les minorités actives, visionnaires et persévérantes, qui ne connaissent pas de repos… tant que leur vision n’a pas gagné la majorité silencieuse.
LES MINORITES ACTIVES ET LE POINT DE BASCULE, UN POTENTIEL INEXPLOITE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE
La démobilisation est palpable à tous les niveaux. Du côté politique et international, les réglementations internationales reculent et les négociations climatiques s’enlisent, alors que la COP 30 se profile à l’horizon. L’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris vient d’être reconnu comme hors de portée : présenté comme vital pour les petits États insulaires, il avait été ajouté, rappelle François Gemenne, « pour embarquer plus de monde » mais sans grande illusion… et pourtant dans le contexte actuel son échec annoncé risque aujourd’hui d’entraîner une dangereuse « démobilisation » collective.
Et ce n’est pas l’amendement surréaliste tout juste adopté par l’Assemblée nationale française, à l’initiative d’une coalition entre droite et extrême droite, pour suspendre le développement de nouvelles installations éoliennes et solaires (cependant que l’Europe semble vouloir reculer également sur la loi anti-greenwashing, sous la pression des mêmes groupes politiques) qui va nous rassurer : deux signaux inquiétants, alors que nous devons au contraire accélérer la transition énergétique, dans les actes et les pratiques, plus que dans les discours.
Dans ce contexte, l’analyse proposée par le journaliste britannique George Monbiot après l’échec de la COP26 (The Guardian, nov. 2021) résonne avec force. Il y affirmait déjà qu’il était « trop tard pour des changements incrémentaux » et qu’il fallait désormais compter sur un basculement soudain, lié à des dynamiques de seuils et des effets domino, pour éviter l’effondrement.
Et de rappeler que, de la même manière que les systèmes terrestres complexes dont dépend notre survie peuvent basculer soudainement d’un état à un autre, les systèmes créés par les humains le peuvent aussi. Nos structures sociales et économiques ont en effet des caractéristiques communes avec les écosystèmes : elles ont des propriétés auto-renforçantes – qui les stabilisent dans une certaine plage de stress, mais les déstabilisent lorsque la pression extérieure devient trop forte. Et si elles franchissent ces points de bascule, elles peuvent changer d’état à une vitesse stupéfiante. Notre dernier et meilleur espoir, souligne Monbiot, est donc d’utiliser ces dynamiques à notre avantage, en déclenchant ce que les scientifiques appellent des « basculements de régime en cascade ». Il se réfère à un article publié peu de temps auparavant dans la revue Climate Policy qui montre comment exploiter le pouvoir de ce qu’il nomme les « dynamiques domino » : des changements non linéaires, qui se propagent d’un point du système à un autre. L’article scientifique souligne que « la cause et l’effet n’ont pas besoin d’être proportionnels » : une petite perturbation, au bon endroit, peut déclencher une réaction massive du système et le faire basculer dans un nouvel état. C’est ainsi que la crise financière mondiale de 2008-2009 s’est produite : un choc relativement mineur (des défauts de paiement sur des prêts immobiliers aux États-Unis) se produit et se propage à tout le système, au point de presque l’effondrer. Selon les auteurs, nous pourrions mobiliser cette même propriété pour provoquer un changement positif accéléré – comme cela s’est d’ailleurs déjà produit dans d’autres domaines. Monbiot cite notamment la montée des véhicules électriques en Norvège : à mesure que les performances des batteries, des composants électriques et des bornes de recharge s’amélioraient et que leurs coûts diminuaient, le prix des voitures électriques a baissé, leur attractivité a monté en flèche et une réforme fiscale a suffi à entériner le point de bascule, en rendant les voitures électriques moins chères que les modèles à essence. Résultat : plus de 50 % des voitures neuves vendues dans le pays sont désormais électriques, et les modèles thermiques sont en voie de disparition. Selon Monbiot, la clef réside dans la mobilisation d’une minorité engagée représentant environ 25% de la population – un seuil qui peut suffire à faire basculer les normes sociales. « Notre survie dépend désormais de notre capacité à mobiliser ces 25 % pour créer le plus grand mouvement de masse de l’histoire. »

Ces idées autour du basculement social se retrouvent aussi dans le livre célèbre de l’éditorialiste du The New York Times Malcolm Gladwell « The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference » (2000) : l’auteur y développe l’idée que les idées, les comportements, les produits et les messages sociaux se propagent dans la société comme des épidémies. Et qu’à un certain moment — le tipping point, ou point de bascule —, un phénomène jusque-là marginal devient soudainement massif, souvent de façon spectaculaire et irréversible. Plus spécifiquement, Gladwell explique que les grandes transformations sociales ne naissent pas d’un vaste mouvement coordonné, mais d’un petit groupe de personnes hautement influentes qui jouent chacune un rôle distinct dans la propagation du changement. Il identifie trois types d’acteurs clefs : les « mavens », experts passionnés qui accumulent et partagent généreusement des connaissances ; les « connecteurs », individus dotés d’un vaste réseau social, capables de relier des mondes qui s’ignorent ; et les « salesmen », communicateurs charismatiques qui savent convaincre et entraîner l’adhésion. Ce trio forme l’infrastructure humaine des points de bascule : en réunissant expertise, diffusion et persuasion, ils permettent à une idée marginale de devenir soudainement dominante. Ce, à deux conditions supplémentaires : il faut d’abord soigner la forme du message afin qu’il soit suffisamment mémorable, impactant ou émotionnellement puissant et que les gens s’en souviennent… en ayant envie de le partager ; et aussi faire attention au contexte et à l’environnement immédiat dans lesquels le message est diffusé. Gladwell s’appuie notamment sur la théorie de la vitre brisée (Broken Windows Theory), selon laquelle un environnement négligé ou dégradé incite à la transgression : il cite le cas emblématique du métro de New York dans les années 1990, où la lutte contre les graffitis et le contrôle systématique de la fraude ont joué un rôle déterminant dans la baisse spectaculaire de la criminalité. En soignant les « petits signes » de désordre, les autorités ont envoyé un signal clair que la loi et l’ordre comptaient, ce qui a modifié en profondeur le climat social.
LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DE LA THEORIE DU POINT DE BASCULE
Cette dynamique des points de bascule (Malcolm Gladwell, 2000) est donc le premier fondement scientifique derrière la théorie des minorités actives : selon une série d’études menées en psychologie sociale et confirmées par des modélisations mathématiques (notamment celles publiées dans la revue Science en 2018), il suffit qu’environ 10 à 25 % d’un groupe adopte une nouvelle norme ou une pratique alternative (le végétarisme, les couches lavables, le vélo en ville, etc.) et maintienne cette innovation face à la pression de la majorité, en adoptant un « style comportemental » spécifique, pour que celle-ci devienne rapidement dominante. Ces minorités critiques déclenchent, comme l’expose Gladwell, des effets de seuil, où les comportements changent brutalement et en cascade — par imitation, opportunisme, ou alignement social.

Deux autres concepts issus des sciences sociales, psychologiques et systémiques permettent de comprendre le rôle puissant que peuvent jouer les minorités agissantes et pionnières dans la transformation sociale : la dissonance cognitive et la psychologie de ces minorités actives.
D’abord, la dissonance cognitive (Leon Festinger, 1956) postule que lorsqu’un écart trop fort se creuse entre les valeurs que l’on revendique et les comportements que l’on adopte, cela crée une tension psychologique inconfortable. Mais au lieu de modifier leur comportement, les individus cherchent souvent à réduire cette tension en minimisant l’importance de l’enjeu ou en se persuadant qu’ils ne peuvent pas agir. Cette dissonance, en particulier, est l’un des principaux freins à l’action climatique. Les minorités actives, en assumant leur engagement de manière cohérente et visible, rendent cette dissonance plus difficile à ignorer — car elles forcent leur entourage à se repositionner et à changer d’attitude.
Ensuite, la psychologie des minorités actives (Serge Moscovici, 1979) détaille la façon dont une petite fraction d’individus convaincus, persistants, et perçus comme crédibles peut inverser les normes dominantes et influencer profondément la majorité. Leur force vient non pas du nombre, mais de la cohérence de leur discours, de leur ténacité, et de leur capacité à susciter du doute sur l’ordre établi. Le sociologue Erwan Lecoeur rappelle les étapes nécessaires à ce « point de bascule » identifiées par Moscovici : « il faut d’abord une personnalité leader, source crédible de la nouvelle vision, qui fédère autour d’elle un groupe d’individus voulant s’opposer au statu-quo ; puis un discours consistant et structuré, avec des mots reconnaissables, est repris par des gens qui ne sont pas dans la minorité, mais s’en approprient le langage et le crédibilisent plus largement ; c’est là que ces arguments sont aussi critiqués et combattus, signe positif qu’ils sont pris au sérieux. Enfin, le discours rallie une « majorité culturelle » – le monde politique ou économique, les consommateurs engagés, qui peuvent changer la norme sociale. A ce stade la minorité active a créé un mouvement d’opinion potentiellement majoritaire : la plupart des gens sont prêts à accepter sa vision alternative du monde, qui devient alors normale. Cela s’est passé sur le mariage gay, les féminicides, les crimes pédophiles ou l’écologie. Comme le disait Gandhi, tout mouvement passe par ces phases : l’indifférence, la raillerie, les injures et enfin le succès ! ».
Une bonne illustration de cette dynamique de bascule est celle enclenchée notamment par Greta Thunberg à partir de 2018, et dont on peut dire qu’elle incarne l’apparition d’une dissidence adoptant un comportement en rupture avec la norme dominante, motivé par une forte conviction morale ou éthique : Greta commence seule avec sa grève scolaire et sa pancarte en 2018 devant le Parlement suédois, mais elle refuse aussi de prendre l’avion (allant en train à Davos avec un trajet de plus de 30 heures et en bateau à New-York avec une traversée de trois semaines). Gagnant des « followers » sur les réseaux sociaux (plus de 9 millions très rapidement, à 16 ans), sa position dissidente devient identifiable et clivante : elle suscite autant l’admiration que les critiques, ce qui augmente sa visibilité. Début 2019, le « flygskam » (honte de prendre l’avion) apparaît en Suède, devient un mot connu, et une tendance qui affecte le marché des vols intérieurs au pays de Greta. Selon Moscovici, plus la minorité est perçue comme stable, cohérente dans le temps et légitime, plus elle influence la majorité : Greta Thunberg incarne bien cela, elle continue son combat malgré les critiques, reste fidèle à ses engagements, gagne de nombreux soutiens (scientifiques, ONG, jeunes). C’est le début d’un retournement silencieux : une partie de la majorité commence à s’identifier aux valeurs de la minorité qu’elle incarne avec le mouvement des Fridays for Future, sans encore les adopter complètement. Pour autant la croissance des vols intérieurs ralentit en Europe et la tendance gagne en visibilité. Les compagnies aériennes commencent à craindre l’impact de cette tendance sur leur business : à l’été 2019, KLM lance sa campagne Fly responsibly encourageant ses clients à moins prendre l’avion et en septembre, Air France annonce la compensation carbone à ses frais des vols intérieurs, suivie par easyJet en fin d’année. La dissonance cognitive augmente : de plus en plus de gens hésitent à prendre l’avion, cherchent des alternatives, justifient leur choix. Ainsi en décembre 2019, la banque suisse UBS révèle qu’un sondé sur cinq en Europe affirme avoir changé ses plans pour éviter de prendre l’avion au cours de l’année écoulée – et 27% du panel dit réfléchir à voler moins à l’avenir. Début 2020, c’est comme souvent un point de bascule externe et inattendu (un événement symbolique, une opportunité politique ou une crise) qui joue le rôle de catalyseur : la pandémie du COVID 19 cloue les avions au sol et les citoyens renouent avec les vacances de proximité, cependant que les entreprises se ruent sur le télétravail et les réunions en distanciel – ce qui paraissait radical devient soudain évident ou même normalisé. Une nouvelle norme s’installe peu à peu : ne plus prendre l’avion devient respectable, voire souhaitable dans certains milieux ; certaines entreprises restreignent les déplacements professionnels et font des émissions évitées un indicateur-clef de performance ; Le Monde propose en 2020 ses 20 destinations de l’année dont pour la première fois la moitié est accessible en train ou voiture ; le patron de AEROPORTS DE PARIS Augustin de Romanet appelle en 2022 à prendre l’avion avec modération ; et Air France-KLM développe son programme « Train + Air » qui combine l’avion et le train sur certains trajets puis propose (depuis 2025) à ses clients d’utiliser leurs miles pour acheter des billets de train… Sur ce sujet au moins, en cinq années à peine, on est donc un peu entrés dans « le monde d’après ».

Erwan Lecoeur souligne d’ailleurs l’accélération de ce phénomène avec les modes ou le rythme de vie, telle que pointée par Harmut Rosa : « au milieu du 20e siècle, il fallait une génération, soit 20-25 ans, pour qu’un sujet bascule ; dans les années 70, ce n’était plus que 10 à 15 ans ; et aujourd’hui il suffit de 5 ans, ou moins ! »
Ces principes nous rappellent que dans tous les cas l’effet d’entraînement ne suit pas une logique linéaire. C’est une étincelle, pas une marche graduelle, qui peut faire basculer un système, voire la société toute entière.
Que peut-on en déduire pour la transition écologique et la RSE ? D’abord cette thèse du point de bascule a le mérite d’insister à juste titre sur le fait que la transition écologique n’est pas qu’une transition des comportements individuels mais aussi (et sans doute avant tout) une transition culturelle qui se joue collectivement et qui est aussi une affaire de normes sociales. Parce que les défis que nous devons relever sont massifs, il nous faut un effet de masse – et l’engagement du plus grand nombre, que seule peut entraîner cette transition culturelle, complément nécessaire de la transition écologique, bien qu’oubliée de l’agenda 21 et des ODD…
Ensuite (et c’est rassurant dans le contexte actuel) qu’il n’est pas nécessaire de convaincre tout le monde : il suffit d’un petit nombre d’individus bien choisis pour (re)lancer une dynamique massive. Après quoi le changement ne s’enclenche pas de manière linéaire, mais de façon non linéaire et rapide une fois un certain seuil atteint. A condition que l’on soigne la forme du message, sa désirabilité et le contexte dans lequel il est diffusé, pour maximiser ses chances de succès.
UNE INSPIRATION BIOMIMETIQUE : LES MURMURATIONS DES ETOURNEAUX, ILLUSTRATION VIVANTE DU CHANGEMENT COLLECTIF IMPULSE PAR LES MINORITES ACTIVES
« Va prendre tes leçons dans la nature » disait Léonard de Vinci. Cet enseignement vaut aussi sur les mécanismes de bascule collective, où l’observation des systèmes naturels peut nous éclairer – par exemple avec les « murmurations » des étourneaux, ces vols collectifs de milliers d’oiseaux qui virevoltent à l’unisson, dans une harmonie spectaculaire, sans chef ni plan.

Ces murmurations illustrent la puissance des dynamiques distribuées, où une minorité agissante peut impulser très rapidement un changement de direction à l’ensemble du groupe.
Ce phénomène n’est en effet pas coordonné par le haut, mais par quelques principes d’organisation qui suffisent à créer une dynamique collective fluide, résiliente et incroyablement réactive. D’abord, les capteurs qui détectent les changements de l’environnement (prédateurs, rafales de vent…) sont les oiseaux en périphérie, comme les minorités actives perçoivent les signaux faibles annonçant les nouvelles tendances. Ensuite, la propagation rapide de l’information fait qu’un mouvement initié localement se diffuse à vingt mètres par seconde à travers tout le groupe, comparable à la diffusion rapide d’une idée ou d’une norme issue d’une minorité active bien positionnée. Autre facteur intéressant : dans les murmurations, chaque étourneau adapte son vol en imitant précisément ses sept voisins les plus proches, illustrant la façon dont des influences localisées peuvent avoir un impact global, sans hiérarchie centralisée et en évitant la confusion. Enfin, dans une murmuration, les leaders sont éphémères : certains individus émergent temporairement sans s’imposer durablement, comme dans les mouvements sociaux et culturels où le leadership peut être distribué et mouvant.
Ce modèle s’avère ainsi riche d’inspiration pour la conduite du changement social et les stratégies d’influence des marques et des mouvements sociaux, mais aussi pour des formes nouvelles d’organisation plus horizontales dans les organisations.
LES MINORITES ACTIVES PEUVENT AUSSI ETRE MOBILISEES EN ENTREPRISE
Retour à la société des Hommes – où cette logique des minorités actives peut s’appliquer à une nation, à une population donnée (par exemple les consommateurs… ou les chefs d’entreprise – voir l’initiative « 10% pour tout changer »lancée il y a quelques années par le Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale Christophe Itier), mais aussi à l’échelle des villes, des territoires… ou des entreprises.
Car celles-ci peinent aussi à changer – et c’est particulièrement le cas en ce moment. D’abord la RSE recule dans les priorités des dirigeants : pour mémoire, le rapport « The Visionary CEO’s Guide to Sustainability 2024 » du cabinet Bain & Company France a en effet montré une inquiétante baisse de près de 30 % de l’intérêt des dirigeants pour la durabilité par rapport à la période post-Covid, soit un véritable retour en arrière motivé par des préoccupations de court terme (inflation galopante, tensions géopolitiques, montée de l’intelligence artificielle…). Et ensuite, selon le Baromètre RSE 2024 de Kantar et VENDREDI, seules 17 % des entreprises françaises considèrent plus largement leurs équipes internes comme « motrices » de leur politique RSE. Plus de la moitié (soit 53%) estime même que seule une « petite partie » de leurs salariés, voire « très peu », sont impliqués. Pourtant, la transition repose avant tout sur des changements culturels et comportementaux profonds, au cœur de l’activité quotidienne et des métiers. Et l’animation « top-down » de communautés d’ambassadeurs est souvent aussi gourmande en énergie que peu efficace.

C’est dans ce contexte que des mouvements de fond, comme celui des collectifs de salariés pour l’écologie, qui trouvent en eux-mêmes et de manière autonomie leur motivation à agir, prennent une ampleur inédite. Nés dans les grandes entreprises, du siège d’EDF à une filiale de Michelin, ces collectifs rassemblent aujourd’hui plus de 120 groupes actifs qui veulent transformer leur organisation de l’intérieur, et inventent une nouvelle forme d’engagement. Le collectif Rhizome, chez EDF, réunit ainsi 1 700 salariés qui ont déployé des dizaines d’actions concrètes sur la mobilité, les déchets ou la gouvernance. D’autres collectifs conçoivent des fresques métiers, proposent des alternatives stratégiques, font office de shadow comex, ou obtiennent un droit de regard sur les investissements de leur entreprise.
Le mouvement, animé par l’association LES COLLECTIFS, s’étend doucement aux PME, au secteur public, et s’organise via des événements en présentiel ou en ligne, des formations, des réseaux d’entraide, des groupes thématiques inter-entreprises. Il met en lumière une idée essentielle : les salariés ne demandent qu’à s’engager — à condition qu’on leur laisse la place et le temps de le faire. Ces collectifs incarnent une des formes les plus vives du « corporate hacking » : une attitude rebelle et bienveillante à la fois, qui fait levier sur le système en corrigeant ses angles morts, en créant de la valeur pour l’entreprise et du sens pour les salariés.
Et il fait des petits puisque Fabrice Bonnifet, ex-Directeur Développement Durable du Groupe Bouygues et Président du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), vient de créer GenAct, une communauté de plus de 1800 professionnels issus de tous horizons qui agissent pour la transition écologique et veulent monter en compétences pour « devenir acteur(s) de la grande bascule », comme les y invite le site, en transformant leurs organisations.

LES ENTREPRISES ET LES MARQUES JOUENT AUSSI UN ROLE-CLEF DANS L’ACTIVATION DU POINT DE BASCULE SOCIETAL
On l’a dit, ce que la théorie du point de bascule nous enseigne, c’est que la transition est d’abord culturelle et collective… plutôt que dépendante de la responsabilité individuelle de chacun.e. Autrement dit : pour faire changer les individus, il faut d’abord changer les représentations, les imaginaires, les infrastructures qui permettent de faire les bons choix, mais aussi la reconnaissance sociale accordée aux comportements vertueux.
Ce changement culturel justifie, d’abord, la mobilisation essentielle des intellectuels, des scientifiques, des artistes et des institutions culturelles, mais aussi des médias et des communicants – qui sont des accélérateurs du changement en ce qu’ils façonnent les nouveaux imaginaires et orientent nos modes de vie. Or il est urgent, comme le dit Daniel Kaplan, fondateur du Plurality University Network, de « représenter ce que seraient des façons alternatives de vivre, hors renoncement et sacerdoces. Les auteurs de science-fiction, par exemple, savent situer une histoire dans un monde qui fonctionne, au moins pour partie, sur des règles différentes – et ne se contentent pas de dresser le constat que ça ne va pas, que ça ne peut plus durer… ».
Mais les entreprises et les marques ont aussi un rôle particulier à jouer – car elles peuvent mieux que personne faire changer les normes sociales, redéfinir ce qui est « cool » et ce qui ne l’est plus, nous proposer des scénarios alternatifs et des imaginaires collectifs désirables pour le futur… Car, insiste Erwan Lecoeur, elles sont aussi « des points de repère décisifs, proposant (par leurs produits, leur publicité et leur marketing) des façons de vivre au plus grand nombre et définissant les nouveaux imaginaires de la réussite sociale – notamment dans la mode ou le luxe ». Et la question-clef est bien de savoir comment se crée la nouvelle distinction sociale, qui ne passe plus par une Rolex à 50 ans, mais par des produits d’un nouveau genre – comme les aliments dont on connaît l’origine, le mode de production voire directement le producteur : ce passage de la « consommation ostentatoire » à la « production ostentatoire » est très bien décrit dans le livre d’Elizabeth Currid-Halket « The Sum of Small Things » (2017).
Mais, selon Daniel Kaplan, le point de bascule n’est toujours pas simple à passer comme le montre sans doute la période actuelle – « car plus s’exprime la nécessité d’une transformation radicale de notre modèle, plus durs aussi se font les points de blocage ». On assiste à un raidissement d’une partie de la population, comme en témoigne la violence des réactions face à Greta Thunberg, ou Anne Hidalgo, par exemple. Pour Kaplan, ce phénomène a été très bien décrit par Naomi Klein dans son livre « Tout peut changer » : « une partie des gens sont parfaitement conscients des enjeux mais comme ils jugent inacceptables les conséquences des actions nécessaires, notamment sur notre société de consommation, ils réfutent le fait initial… Et les tensions entre ces deux groupes se multiplient, avec plusieurs facteurs-clefs. D’abord, l’explosion des inégalités à l’échelle mondiale. En Occident, une partie de la population a vu sa situation et ses perspectives (voire son espérance de vie) se dégrader. Et ailleurs, on court après les niveaux de vie occidentaux. Dans un tel contexte, l’écologie peut être considérée comme un truc de riches, une manière pour ceux qui ne manquent de rien de faire la leçon aux autres. Choisir de ne pas prendre l’avion, c’est bien, mais ça signifie qu’on a les moyens de voyager… Et les démagogues, malheureusement de plus en plus souvent soutenus par des lobbies corporate, exploitent cette colère légitime pour la tourner en haine des élites et en un refus de principe de tout ce qui pourrait s’opposer à la croissance économique. »
Et le second blocage, point-clef pour que les comportements verts ne soient plus l’apanage de « l’élite », c’est quand même l’offre. Tant que les entreprises ne changent pas vraiment le cœur de leur modèle économique, et que celui-ci reste fondé sur la frénésie de consommation et l’obsolescence, la bascule ne peut être fondée que sur un renoncement (voire un sacerdoce). Or « tant que la structure économique et fiscale rendra, par exemple, l’avion moins cher que le train, le changement restera de l’ordre du sacrifice volontaire de ceux qui peuvent se le permettre. Il ne fera pas bascule » souligne Kaplan. Ce qui amène une autre responsabilité pour les entreprises : proposer rapidement des alternatives désirables et intégrables facilement au quotidien, des offres accessibles à des coûts raisonnables, venant de marques déjà installées ou de start-ups qui peuvent plus facilement perturber le modèle dominant.
CONCLUSION : MISER SUR LES MINORITES ACTIVES POUR ENCLENCHER LA BASCULE
Dans un monde incertain, saturé d’alertes, de complexité et d’inertie, les entreprises ont tout intérêt à abandonner l’illusion du consensus majoritaire… et cela tombe bien – car il n’est plus là, sur la RSE en tout cas. Ce ne sont ni les foules, ni les sondages, ni les moyennes qui enclenchent les bascules — ce sont les minorités actives : ces client·es pionniers, ces salarié·es engagés, ces influenceurs crédibles qui expérimentent d’abord, défendent des convictions fortes, défrichent des modes de vie innovants et embarquent progressivement les autres.
En interne, ces salariés moteurs — parfois isolés, souvent peu visibles — peuvent devenir des leviers puissants de transformation, à condition qu’on les repère, qu’on les écoute, qu’on les relie, et qu’on leur donne l’espace d’agir. En externe, les entreprises qui choisissent de s’adresser d’abord aux clients les plus exigeants, les plus engagés, plutôt qu’à la majorité tiède, peuvent créer un effet de halo bien plus puissant : elles rendent l’engagement désirable, contagieux, irrésistible.
Plus que jamais dans le contexte actuel, la stratégie la plus efficace n’est donc pas de convaincre tout le monde, mais de parier sur les premiers de cordée — ceux qui ouvrent les voies et précèdent le point de bascule. C’est en comprenant et en cultivant ces dynamiques de seuils et ces cercles d’entraînement que l’entreprise deviendra, elle aussi, un acteur de la transformation systémique.

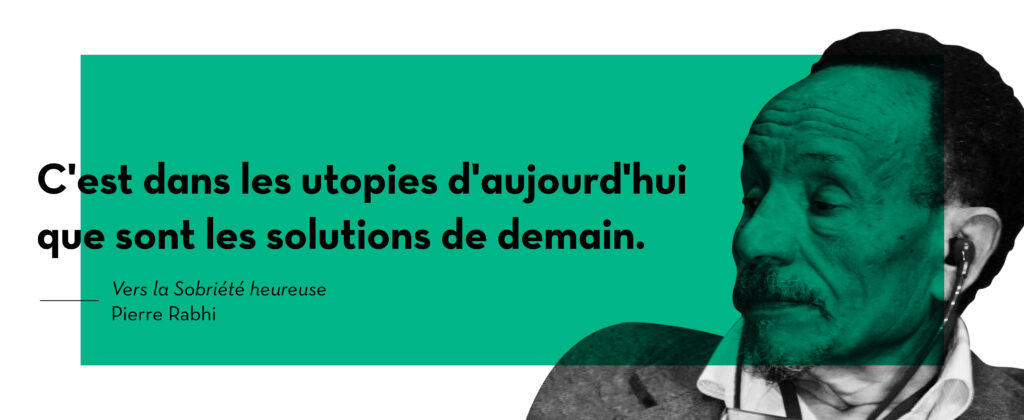
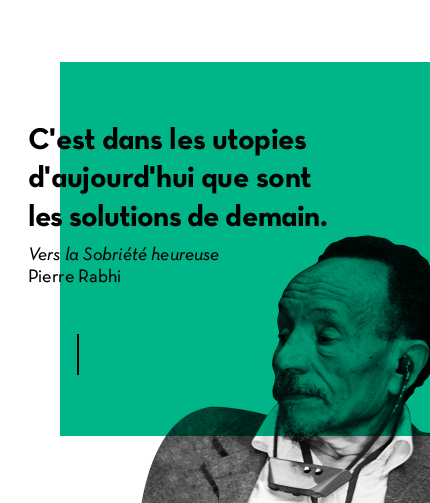
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire
UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent
* Champ obligatoire